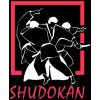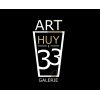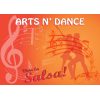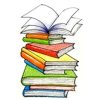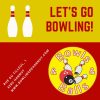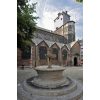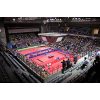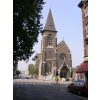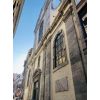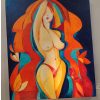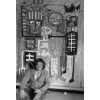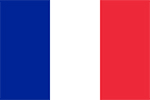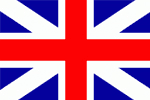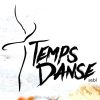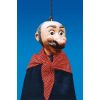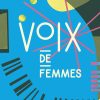Toutes les infos sont dispo ici : https://48fm.com/artistes/ 🎵

Page officielle 53Onze Challenge qui regroupe les organisateurs de randonnées VTT dans un challenge d’une vingtaine de randonnées toutes distances.

Page de A chacun son cinéma qui reprend certaines actualités liées à nos projets audiovisuels. Infos stages, nouveaux projets, etc.

L’abbaye de la Paix Notre-Dame de Liège est une abbaye bénédictine de Liège fondée en 1627 et située au no 52-54 du boulevard d’Avroy. Les religieuses fondatrices de la congrégation bénédictine de Paix Notre-Dame étaient en provenance de Namur1. L’établissement s’est maintenu au-delà d’une interruption de 45 années consécutive à la Révolution française1. L’abbaye fut construite d’après les plans d’une moniale montoise d’origine, Antoinette Desmoulins, de 1686 à 1690
Plus d’infos :
http://www.benedictinesliege.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_la_Paix_Notre-Dame_de_Li%C3%A8ge

L’abbaye de Stavelot était un monastère bénédictin situé à Stavelot, dans la province de Liège, en Région wallonne de Belgique. Fondé en 651, le monastère était associé à celui de Malmedy, c’est-à-dire qu’un même abbé présidait aux destinées des deux abbayes, l’ensemble étant qualifié de « monastère double ».
Au ixe siècle, l’abbaye joua un rôle culturel important en Lotharingie. Mais en 881 et 883, l’abbaye subit successivement deux invasions par les Normands et se retrouva en ruine. Après la périodes des comtes-abbés, en 962, l’abbaye de Stavelot devint impériale et, dès lors, ses abbés portèrent le titre de « Prince de l’Empire ». L’abbaye fut donc le siège d’une principauté ecclésiastique qui régna sur une grande partie de l’Ardenne, jusqu’à Logne.
Du xiie au xve siècle, l’abbaye de Stavelot connaitra un long déclin, puis une période de renouveau entre 1500 et 1650. Cependant, de 1793 à 1804, à la suite de la révolution française, les moines furent expulsés de leur abbaye, laquelle fut saccagée et pillée par les révolutionnaires. L’abbatiale fut vendue et démolie ; c’est la fin de la principauté de Stavelot-Malmedy.
Pour infos :
http://www.abbayedestavelot.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Stavelot

L’abbaye du Val-Dieu était un monastère de moines cisterciens situé à Aubel, dans le pays de Herve, en province de Liège (Belgique). Fondée aux environs de 1215 dans un lieu « inculte et inhabité » de la vallée de la Berwinne par des moines venus de Hocht, elle fut fermée en 1812 et devint un pensionnat. Rachetée en 1840, l’abbaye reprit vie grâce à des moines venus de Bornhem.
Pour plus d’infos :


Académie « Hubert Keldenich » de Welkenraedt
Etablissement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Musique
Danse
Arts de la parole

L’académie Grétry est un bâtiment situé boulevard de la Constitution à Liège et construit en 1905 pour servir de maternité de l’hôpital de Bavière. Il abrite depuis 1989 l’académie de musique.
Plus d’infos :

Ecole d’art plastique, visuel et de l’espace de la Ville de Verviers subventionnée par la fédération Wallonie-Bruxelles

Venez vous découvrir en ce lieu d’apprentissage et de création artistiques en phase avec notre société.

L’Académie royale des beaux-arts de Liège est une institution artistique créée en 1775 sous les auspices du prince-évêque de Liège François-Charles de Velbrück d’après une idée de Nicolas Henri Joseph de Fassin et Léonard Defrance.
Le bâtiment actuel, d’inspiration Renaissance italienne, sis 21 rue des Anglais, date de 1895 et est l’œuvre de l’architecte municipal Joseph Lousberg.
Pour plus d’infos :
http://www.academieroyaledesbeauxartsliege.be/indexSoir.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_des_beaux-arts_de_Li%C3%A8ge



Afterwork Signature🥂
Est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’art de la mixologie🍸 et au plaisir de se retrouver dans une ambiance élégante et conviviale. 🍾
Des créations de cocktails uniques, un cadre raffiné et une expérience inoubliable.🎉


Association liégeoise des théâtres amateurs créée en août 2011.

L’Aquarium-Muséum est un musée de l’université de Liège consacré à la fois au monde aquatique et au patrimoine des sciences naturelles. Fondé le 12 novembre 1962 au sein de l’institut de zoologie de Liège, qui abrite également la Maison de la science, il accueillit en 1991 son millionième visiteur1.
L’Aquarium-Muséum, intégré au pôle muséal « Embarcadère du Savoir »2, est également un outil de recherche et d’enseignement grâce à une reconstitution fidèle des milieux aquatiques. Il est membre de l’Union Européenne des Conservateurs d’Aquarium (EUAC) depuis 1972 et de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) depuis 1993.
Pour plus d’infos :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium-Mus%C3%A9um

L’Archéoforum de Liège est un musée archéologique inauguré en 2003. Situé en souterrain au cœur historique de Liège, il est le fruit des différentes campagnes de fouilles entreprises sur le site de l’ancienne Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert depuis 1907. Propriété de la Région wallonne, il est géré par l’agence wallonne du patrimoine (AWAP).
Sur une surface de 3 725 m2, l’Archéoforum emmène le visiteur à la redécouverte de l’histoire depuis le mésolithique jusqu’à nos jours en passant par toutes les grandes étapes qu’a connu le site. Et principalement les traces de :
- objets préhistoriques
- la villa gallo-romaine
- l’église mérovingienne
- la cathédrale carolingienne
- la cathédrale ottonienne
- la cathédrale gothique
Le site, à l’origine un petit plateau surplombant le confluent de la Légia avec la Meuse, témoigne en effet d’une occupation continue de plusieurs milliers d’années. Une présence sur le site est attestée depuis 50 000 à 100 000 ans, avec une occupation permanente depuis 9 000 ans dont témoignent les vestiges exposés1.
L’Archéoforum de Liège est situé place Saint-Lambert, au centre de Liège. Son entrée se trouve face au lieu de l’attentat survenu le 13 décembre 2011.

Maisons de vacances confortables, villas de luxe et chalets authentiques dans les Ardennes belges. La qualité est notre priorité absolue ! Réservez vos prochaines vacances dans les Ardennes sur http://www.Ardennes-Etape.com.



Cet article recense les principaux immeubles de style Art déco de la ville belge de Liège.
Historique
La ville de Liège compte plus de 200 immeubles construits entre la fin du xixe siècle et le début de la Première Guerre mondiale dans le style en vogue à cette époque : le style Art nouveau.
L’Art déco apparaît en Belgique immédiatement après la Première Guerre mondiale lorsque Victor Horta entame en 1919 la conception du palais des beaux-arts de Bruxelles. Ce style est contemporain du Modernisme. Plusieurs immeubles sont le résultat d’une influence entre ces deux styles. Les villes de Liège et de Charleroi deviennent les communes wallones comptant le plus de constructions du style Art déco.
Description et situation
À Liège, ce style apparaît sous la forme de maisons individuelles mais aussi d’immeubles à appartements ou de salles de spectacles. La commune de Liège possède une quarantaine de ces immeubles répertoriés à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de Wallonie et certains sont classés. La plus importante concentration d’immeubles Art déco se situe dans le quartier des Vennes, en rive droite de l’Ourthe juste avant sa confluence avec la Meuse. Les rues les plus représentatives de l’art déco dans ce quartier sont les rues de Chaudfontaine et de Paris. Parmi les grands immeubles à appartements de ce quartier des Vennes, certains ont été réalisés dans un style moderniste teinté d’éléments Art déco. Sur la rive opposée de l’Ourthe, on peut voir un ensemble homogène de 14 immeubles construits le long du quai du Condroz entre 1930 et 1935. Une petite dizaine de ces immeubles ont été réalisées par l’architecte Gabriel Debouny. Parmi les autres architectes liégeois actifs dans la réalisation de ces immeubles de style Art déco, on peut citer Louis Rahier, Marcel Chabot, A. Lobet, J. Bourguignon, L. Mottart, Ch. Falisse, P. Salée et Urbain Roloux.
Comme partout dans le monde, les constructions de style Art déco cessent avec le début de la Seconde Guerre mondiale.
Liste des immeubles Art déco
Liste non exhaustive des immeubles Art déco ou en comportant certains éléments.
Centre de Liège
- Boulevard d’Avroy no 7 et Rue Hazinelle no 10, immeuble de coin à appartements
- Rue de Campine nos 21, 74, 120 à 126 et 152
- Place Cockerill no 14 et Rue de l’Étuve no 22, immeuble de coin à appartements
- Féronstrée nos 75-77
- Rue Florimont no 6
- Rue Fond-Pirette no 169
- Rue Grandgagnage no 35, immeuble à appartements
- Rue Jonfosse nos 52-54-56, immeubles à appartements
- Passage Lemonnier, partie centrale
 Patrimoine classé
Patrimoine classé - Rue Lulay-des-Fèbvres no 6, salle Le Trocadero
- Rue Maghin nos 6, 8 et 10
- Rue Mathieu Laensberg no 6
- Rue du Mouton Blanc, salle Le Churchill
 Patrimoine classé
Patrimoine classé - Rue Nysten no 7 (1928) et no 32
- Rue Pont d’Avroy no 14, salle Le Forum (1921-1922)
 Patrimoine classé
Patrimoine classé - Rue Pont d’Avroy no 20
- Rue Pouplin nos 5 et 11
- Place Saint-Christophe no 17
- Rue Saint-Gilles nos 6 et 71
- Rue Sainte-Marie no 10 (1932)
- Place Vivegnis nos 6-8, ancien magasin de l’Union coopérative
-
Rue Fond-Pirette, 169
Quartier des Vennes
- Rue Adrien de Witte no 1, immeuble à appartements
- Rue de l’Amblève nos 1-3, immeuble à appartements
- Quai des Ardennes nos 42-43, immeuble à appartements
- Quai des Ardennes nos 63, 64, 68, 104, 112, 170 et 171
- Rue de Chaudfontaine nos 2, 8, 11, 21, 23 et 25
- Quai du Condroz nos 1 à 14
- Boulevard Émile de Laveleye nos 75, 82, 95, 97, 98, 99, 99A, 99B, 100, 133, 227 à 233
- Boulevard Émile de Laveleye nos 108 à 126, immeubles à appartements
- Boulevard Émile de Laveleye no 134 et Avenue Reine Élisabeth, immeuble de coin à appartements
- Quai Gloesener no 5, immeuble à appartements
- Rue de Londres nos 10, 11 et 18
- Avenue du Luxembourg nos 1 et 15, immeubles à appartements
- Avenue du Luxembourg no 92 et Boulevard Émile de Laveleye , immeuble de coin
- Quai Mativa nos 72 et 74
- Place des Nations Unies nos 1 à 14, immeubles à appartements
- Rue de Paris nos 1 à 22
- Avenue Reine Élisabeth nos 2 et 13
- Rue Saint-Vincent nos 42, 44 et 46
- Rue Stappers no 19
- Rue de Stavelot nos 2-4 et Avenue Reine Élisabeth, immeuble de coin à appartements
- Rue de Stavelot nos 17 et 19
- Rue des Vennes nos 157 et 204
- Rue de Verviers nos 25, 27, 33 et 37-39, , immeuble à appartements
-
Quai des Ardennes, 42-43
Outremeuse-Boverie
- Rue Adolphe Maréchal nos 1A/1B
- Quai du Barbou no 34
- Place du Congrès no 4 (1933)
- Rue des Bonnes-Villes nos 8, 56 et 68
- Quai de Gaulle no 23
- Quai de la Dérivation no 1 et place Théodore Gobert no 6, immeuble à appartements (café)
- Rue Dos-Fanchon no 6
- Boulevard de l’Est no 4
- Rue de la Justice nos 15/17
- Rue Léon Frédéricq no 29 et rue des Fories, immeuble de coin (hôtel)
- Quai Marcellis no 12
- Quai de l’Ourthe nos 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26 et 28
- Rue du Parc no 63
- Rue du Parlement no 16
- Rue Puits-en-Sock no 61
- Quai Sainte-Barbe no 20 (1930)
-
Boulevard de l’Est no 4
-
Quai de Gaulle no 23
-
Quai de l’Ourthe, no 3
Autres quartiers rive gauche
- Rue Ambiorix nos 87, 89, 91, 95, 97 et 99
- Rue Auguste Buisseret nos 29 et 31
- Rue Auguste Donnay nos 57, 103-105 et 130
- Rue Bois-l’Évêque no 11
- Rue des Buissons nos 54 à 60, 74 et 79
- Rue de Chestret no 12
- Rue des Églantiers no 24
- Rue de Fragnée no 39, 141 et 145
- Rue de Harlez nos 5, 7, 19, 29 et 45
- Rue Hézelon no 8
- Rue de Joie nos 49, 56, 58 (1927), 142, 144 et 150
- Rue du Laveu no 98
- Quai de Rome no 1, immeuble de coin à appartements Le Petit Paradis
- Rue Saint-Maur, tour du Mémorial Interallié (Cointe)
 Patrimoine classé
Patrimoine classé - Rue de Sclessin no 52
- Rue de Serbie no 11
- Rue des Wallons nos 168, 177, 179 et 218
-
Rue de Harlez, 19
-
Rue de Joie, 49
-
Tour du Mémorial Interallié
Autres quartiers rive droite
- Rue d’Amercœur no 54 et rue des Prébendiers nos 1-3-5, immeuble de coin à appartements (1930)
- Rue Auguste Javaux no 46 (1932)
- Rue Frédéric Nyst nos 18-20
- Rue Lamarche no 43
- Rue Justin Lenders nos 33, 35, 37 et 91
- Quai de Longdoz no 19
- Rue des Maraîchers no 25
- Quai Orban no 52, immeuble à appartements
- Rue de Robermont nos 114 à 120, 150 à 154
- Rue Sous-l’Eau no 45
- Rue Villette no 26
Autres sections
- Angleur :
- Rue Hector Denis no 36
- Rue Jules Verne no 2
- Rue Ovide Decroly nos 3, 9, 11, 13, 15, 40, 46, 69, 92, 102, 104, 106, 133, 137
- Rue Vaudrée no 87
- Bressoux :
- Rue de l’Armistice no 20
- Rue de Porto no 29
- Rue Raymond Geenen no 132
- Chênée :
- Boulevard de l’Ourthe no 41
- Grivegnée :
- Rue Belvaux no 157
- Rue du Bastion no 29
- Avenue des Coteaux nos 40 et 42
- Avenue de Péville nos 194 à 202, 205 à 209, 213, 215, 273

Art’n pepper Galerie partage ses coups de coeur artistiques depuis 2003
Séduite par la «matière» au sens large du terme, cette dernière est devenue le fil conducteur en ce qui concerne nos choix artistiques que nous défendons depuis 15 ans.
Notre Jardin
Sculptures extérieures sont à découvrir au bord de notre étangs de baignade, suspendues aux arbres ou mises en scène dans les massifs de fleurs et autres espaces verts.
Diverses installations comme les hôtels d’insecte, murs secs, potagers en hauteurs, étangs de baignade sont également de belles sources d’idées pour vos aménagements futurs.
Nous ouvrons le jardin et parc de sculptures au mois d’aout, tous les dimanches et le 15 août. Egalement tout le reste de l’année, en semaine ou week-end sur rendez-vous.

La Art Studio Gallery propose un regard jeune et audacieux sur la création artistique contemporaine belge et internationale.
La Art Studio gallery est un espace d’exposition de talents d’ici et d’ailleurs en matière d’arts plastiques, visuels et de l’espace.
Située au cœur de Liège, à deux pas de l’Académie des Beaux-Arts, du Musée de la Vie Wallonne et de la gare de Liège-Saint-Lambert, la Art Studio gallery propose un regard jeune et audacieux sur la création artistique contemporaine belge et internationale. Cet espace, abrité dans une accueillante maison du XVIIIe siècle, a pour raison d’être l’exposition et la promotion d’œuvres d’art actuelles.
La programmation de la galerie, représentative de tous les courants artistiques actuels, permet au public de découvrir de jeunes artistes et des artistes confirmés belges et internationaux.

Artbee, à Liège, c’est un atelier de conservation et de restauration pour vos œuvres d’art, peint

Nous sommes une ASBL (en constitution) qui promeut l’Art et la Culture, sous quelque forme qu’elle soit, en aidant principalement chaque être dans la pratique d’une activité dédiée.

Yawa est un studio de création de céramique et de sculpture.
Yawa présente des créations unique

Musée de la bière et du péket, caves à bières très spéciales, locations de salles, boutique du terroir et bien d’autres choses encore…

B3 – Centre de ressources et de créativité de la Province de Liège

Durée : +- 3h. Parcours de 10 km – niveau de difficulté : moyenne
P.A.F. : 3 €
Guide : Brigitte Piérart


Lieu culturel autogéré, l’asbl Barricade entend lutter contre les inégalités et violences produites par les systèmes et imaginaires de dominations, en faisant le pari de l’émancipation individuelle et collective comme outil de résistance.

La basilique Saint-Martin est un édifice religieux catholique sis sur le Publémont, à Liège, en Belgique. Un édifice roman du xe siècle, déjà connu comme collégiale Saint-Martin1, est remplacé par une nouvelle église de style gothique au xvie siècle. Elle est l’une des sept anciennes collégiales liégeoises.
Dans la première église fut célébrée pour la première fois, en 1246, la Fête-Dieu. Étant donnée l’importance historique de cet événement, encore aujourd’hui commémoré annuellement, la collégiale fut élevée au rang de basilique mineure en 1886.
Pour plus d’infos :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Martin_de_Li%C3%A8ge

Pays de Liège (bateau)
Le Pays de Liège est un bateau à passagers (ou bateau-promenade) qui propose des croisières de quelques heures à une journée, sur la Meuse et sur le canal Albert en province de Liège.
Embarquez pour une croisière au fil de l’eau
Le bateau « Le Pays de Liège », 208 places assises réparties sur 2 ponts couverts avec en plus un pont promenade, vous dévoile les charmes de la Meuse. En journée ou en soirée, avec ou sans repas, laissez-vous embarquer au fil de l’eau pour un moment de détente original…

La Bibliothèque de la gourmandise est la plus importante bibliothèque de gastronomie de Belgique, avec plus de 17000 livres de cuisine et plusieurs milliers d’autres documents ; c’est une des plus grandes d’Europe sur ce thème avec ses ouvrages concernant l’alimentation, les arts de la table et le tabac, principalement en Europe et particulièrement en Belgique : bibliographies, histoire, recettes de tous les temps, économie domestique, chimie alimentaire, publicités, iconographie, littérature, musique, etc.
Pour assurer la pérennité de ce fonds qui constitue un outil essentiel pour les chercheurs, notre asbl a choisi de le transférer à l’asbl Centre de gastronomie Historique qui lance un nouveau projet : la création d’un Pôle de Recherche en Histoire de l’Alimentation : le PRHAlim
Un crowdfunding est lancé pour réunir les fonds nécessaires à la reprise de la collection et à sa réinstallation en région bruxelloise. Votre participation, si minime soit-elle, est la très bienvenue sur
La bibliothèque contient également des ouvrages concernant les arts anciens, la poste et la danse. Un fonds est consacré aux archives locales et à la littérature dialectale :
Pour plus d’infos :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_et_mus%C3%A9e_de_la_Gourmandise

La bibliothèque communale est gérée par Madame Anne-Sophie Leroy, bibliothécaire-documentaliste graduée.
Elle fait partie du Réseau de la Lecture Publique de Hesbaye.
L’inscription et les emprunts sont gratuits jusqu’à 18 ans. Pour les lecteurs de plus de 18 ans, un droit d’inscription de 6 € par an est demandé, avec emprunts gratuits.
Chaque lecteur peut emprunter un maximum de 10 livres pour une période de 4 semaines, avec possibilité de prolongation des prêts.
Rendez-vous sur le site http://mabibli.be pour consulter la liste des titres disponibles, gérer votre compte, vérifier vos emprunts en cours ou prolonger vos prêts.

Les bibliothèques :
Lieux d’accueil, de rencontres, de partages et de découvertes, pour tous les âges et pour les rêves, pas moins de 8 bibliothèques sur le territoire des communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Hamoir et Ferrières vous invitent à la lecture. On peut y flâner, chercher soi-même ce que l’on désire, lire un magazine sans être importuné…
Les bibliothèques sont accessibles à tous et gratuites jusqu’à 18 ans. Si vous avez plus de 18 ans, un droit d’inscription de 6 € vous sera demandé et donne accès aux 8 entités du réseau pendant un an.
Depuis juillet 2023, dans le cadre du Réseau Pass Bibliothèques de la Province de Liège, l’inscription dans l’une de nos bibliothèques donne également l’accès à toutes les bibliothèques du Pass (150 bibliothèques en Province de Liège). Infos sur http://www.mabibli.be
Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 15 documents en même temps pour une période de 4 semaines. Vous êtes dans l’impossibilité de rendre vos livres à temps ? Un petit coup de fil ou un mail et une prolongation vous sera accordée ! Quatre services sont disponibles dans nos bibliothèques : libre-accès adulte, section jeunesse, salle de lecture, accès EPN. Nous disposons également d’un catalogue en ligne accessible pour tous les lecteurs à l’adresse suivante : http://www.mabibli.be
Les bibliothèques possèdent chacune des collections impressionnantes et très diversifiées qu’elles mettent à votre disposition : littérature générale, best-sellers, documentaires pour petits et grands, bandes dessinées, albums, encyclopédies et dictionnaires, revues… Les trois implantations d’Aywaille, Harzé et Sougné-Remouchamps proposent également une belle sélection de romans en grands caractères pour un meilleur confort de lecture.
Si vous êtes, temporairement ou de manière permanente, dans l’impossibilité de vous rendre à la bibliothèque pour y choisir des livres, contactez l’équipe de la bibliothèque ! Les bibliothécaires pourront vous sélectionner des lectures et porter les ouvrages à votre domicile dans les jours qui suivent.
Des animations régulières ou ponctuelles font aussi partie du service que nous souhaitons vous offrir et n’ont d’autre but que de vous satisfaire. Animations thématiques lecture-bricolage : pour les enfants de 3 à 10 ans à chacune des vacances scolaires. Heure du conte « bébés » : pour les bambins de 6 mois à 3 ans, durant les vacances scolaires.
Catherine JAMAGNE, bibliothécaire responsable
Héléna CANEVE, Gaëlle COMMAS, Marine DETRY, Sylvie HERLINVAUX, bibliothécaires
04 384 78 82

La bibliothèque de Baelen accueille avec plaisir les grands, les petits et les moyens. Notre équipe est toujours prête à faire de son mieux pour répondre à vos demandes.

La bibliothèque de Fléron vous propose une large collection de livres pour tout âge et tout public

Notre bibliothèque communale, filiale du RLPH, vous accueille à Hollogne-sur-Geer.

Besoin d’idées de lecture? Envie de découvrir un jeu? Nécessité d’obtenir une info ou curieux de connaître les coulisses de notre bibliothèque? Vous êtes au bon endroit ! N’hésitez pas à interagir sur cette page, c’est aussi la vôtre…

Bienvenue sur la page Facebook des Bibliothèques communales de Theux.

Venez découvrir des milliers de livres et de jeux à emprunter!

Bienvenue sur la page Facebook de la Bibliothèque Pierre Perret !
Au plaisir de vous faire découvrir nos actualités.

La Bibliothèque communale vous accueille dans un cadre clair et chaleureux. Elle vous propose un choix agréable et diversifié de livres pour enfants, adolescents et adultes : romans, BD, ouvrages techniques ou de vulgarisation… mais également les journaux (La Meuse et Le Soir).
Afin de toujours mieux vous satisfaire et rencontrer vos demandes, elle se renouvelle et accroît ses collections : ainsi chaque année +/- 700 nouveaux bouquins sont mis à votre disposition.
Elle participe également au prêt-interbibliothèques (elle emprunte à d’autres bibliothèques des ouvrages qu’elle ne possède pas afin de les prêter à ses lecteurs) et pratique les réservations.
Elle accueille également les classes des écoles de l’entité engissoise et réalise pour celles-ci des animations.
La bibliothèque est ouverte à tous sans distinction, habitants du territoire communal comme de l’extérieur.
Pour une cotisation de 6 euros/an (dont sont exemptés les mineurs d’âge, étudiants, chômeurs et minimexés), un maximum de 10 livres à la fois vous est prêté pour 1 mois.

La Bibliothèque vous invite à partager ses trésors des livres pour vous détendre, vous cultiver ou vous informer…
Entièrement rénovée en mai 2012, la bibliothèque est située dans l’ancien hôtel de ville de Boncelles, à l’étage.
Des milliers de volumes et de revues sont en libre accès.
Animations réalisées à la bibliothèque : visites de classes avec les écoles avoisinantes.

Établie depuis l’été 2012 dans les nouveaux bâtiments de l’administration communale, la bibliothèque vous propose :
– une section adulte
– une section jeunesse
– une salle de lecture

Bienvenue sur la page facebook de la Bibliothèque de Thimister-Clermont

Pour prolonger vos médias, merci d’envoyer un MAIL à bibli.salledelecture@verviers.be. Votre demande sera traitée dans de plus brefs délais que via Facebook.
HORAIRE
Lundi : fermé
Mardi, Jeudi et Samedi : 10h-14h
Mercredi et Vendredi : 10h-18h

La Bibliothèque de Viemme est une petite bibliothèque de village qui compte quelques milliers de livres. Chaque année, nous achetons environ 300 nouveautés

Centre de recherche, de formation, de conservation et de documentation de la Fédération Wallonie-Brux

Fondée en 1592, la bibliothèque du Séminaire de Liège est à l’heure actuelle une des plus anciennes bibliothèques en activité en Belgique.

ATTENTION !!!
Horaire du samedi :
LA LUDOTHEQUE ouvre de 10h à 13h
la bibliothèque ouvre de 9h à 15h

Venez vous perdre dans nos rayons et découvrir les merveilles qui s’y trouvent ou même participer aux animations proposées par une équipe dynamique. La bibli, pour vous, avec vous, à tout âge!

Le Réseau des bibliothèques communales de Chaudfontaine est réparti en 3 implantations : Embourg, Beaufays et Vaux-sous-Chèvremont.

Le réseau de la lecture publique de Dison se compose de 3 bibliothèques : Dison, Ottomont et Village (Andrimont)
Bibliothèque d’Ottomont
Contact
Adresse
Rue Maurice Duesberg 154821 AndrimontBelgique
Horaires
Bibliothèque du Village
Contact
Adresse
Avenue du Centre 2694821 AndrimontBelgique
Horaires

Les bibliothèques communales de Remicourt vous accueillent :
le JEUDI de 16h à 17h à HODEIGE (Rue Joseph Corrin, 16) ; le SAMEDI de 9h à 11h à REMICOURT (Rue Jules Mélotte, 15) et de 11h15 à 12h15 à MOMALLE (Rue Joseph Désir, 2)

Réseau des bibliothèques de la commune de Flémalle. Il se compose de la bibliothèque de Flémalle centre et du bibliobus

Bibliothèques de Wanze, de Braives, Burdinne et de Héron (Réseau Burdinale-Mehaigne)

Le réseau des bibliothèques de Herstal compte 5 bibliothèques situées dans les différents quartiers et villages qui composent la Ville.
6 bibliothécaires constituent l’équipe :
Amélie, Denis, Margaux, Olivier, Stéphanie & Sophie!



Blegny-Mine est le nom d’un ancien charbonnage situé à Trembleur au nord-est de la ville de Liège, en Belgique (Région wallonne). Ce charbonnage appartenant anciennement à la Société anonyme des Charbonnages d’Argenteau.
Sa concession se situait à l’est de Liège et en aval de la ville dans la vallée de la Meuse sous les territoires des anciennes communes d’Argenteau, Cheratte, Feneur, Saint-Remy, Trembleur, Mortier et Dalhem, rassemblées dorénavant sur Visé, Blegny et Dalhem1,2.
La concession se trouvait au nord de celle de la Société anonyme des Charbonnages du Hasard.
Ce charbonnage fut le dernier du bassin liégeois à fermer ses portes. Ses activités commerciales et industrielles cessèrent en 1980 pour laisser place à un espace touristique et culturel.
À sa fermeture, le site minier comprenait deux puits, le puits Marie (234 m. de profondeur) et le puits No 1 (760 m. de profondeur), afin d’assurer la mise à fruit du gisement, la circulation des hommes et de la production, sans oublier la ventilation des galeries qui se répartissaient sur 7 étages (le dernier se situant à 530 m de profondeur). À partir de ces galeries, l’exploitation se faisait par la méthode de la « taille chassante » qui consiste à avancer parallèlement à la ligne de la plus grande pente de la veine de charbon. Ces veines pouvaient être exploitées jusqu’à une épaisseur minimum de 30 cm.
Une visite de la mine est aujourd’hui possible. Des guides anciens mineurs ou des guides professionnels vous mènent à travers une exploration des galeries à -30 et -60 mètres. La descente et la remontée sont opérées par l’ascenseur toujours en fonction du puits no 1. La visite se conclut par la découverte des installations de recette et de triage des charbons.
Le site de Blegny-Mine héberge également le CLADIC (Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière), regroupant de la documentation et de nombreux fonds d’archives des charbonnages de la région.
Le site est accessible en transports en commun, depuis l’arrêt Route de Mortier à Trembleur, desservi quotidiennement par le bus 67 Liège – Visé.
L’endroit était associé à un train touristique, Li Trimbleu, dont l’exploitation a cessé après un accident mortel en 1991. A noter que le mot wallon «Trimbleu» ne signifie nullement «train bleu» comme l’imaginent certains touristes. «Trimbleu» est le mot wallon désignant le village de Trembleur.
Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012 lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial avec trois autres charbonnages de Wallonie comme sites miniers majeurs de Wallonie3. Il s’agit de l’unique site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO situé en province de Liège.
Des débuts jusqu’à la fin du xixe siècle
Une des galeries visitable de la mine, avec une ancienne motrice diesel. On reconnait notamment cette motrice et ses wagons dans le film Marina de Stijn Coninx, pour lequel la mine a notamment servi de décors
Dans la région de Mortier et de Trembleur, les premières traces d’exploitation de houille remonteraient au xvie siècle4, sous l’impulsion des moines de l’Abbaye du Val-Dieu5, bien que le charbon de terre y soit connu depuis bien avant6,7.
En effet, les terrains houillers du Pays de Herve, et de Blegny en particulier, ont la particularité de se trouver à très faible profondeur, voire en affleurement pour certaines veines.
Au début du xviie siècle déjà, l’exploitation houillère au ban de Trembleur semble florissante8 à connaître le nombre d’actes passés à l’époque mentionnant la présence de houille, dans le cas de dédommagements ou de contrats d’exploitation : on trouve ainsi la trace d’exploitations de houille au lieu-dit Goméfosse9, entre Cortils et Trembleur, à la limite du bois de Trembleur9, ou à La Waide10. De plus, plusieurs familles entrent en relations d’affaire avec l’abbé de Val Dieu afin d’exploiter des veines de houille sur les terres de l’abbaye11. Ses moines exploitent d’ailleurs au lieu-dit Leval, sur Saint Remy, dès 166012,13.
Le monastère s’associe aussi plusieurs fois avec des membres de la famille Defrongteaux14.
C’est cependant la famille Corbesier, et plus particulièrement son patriarche Gaspar, qui va développer l’activité houillère de la région et ce, dès la fin du xviiie siècle.
Elle exploite depuis deux générations des houillères sur le territoire des communes d’Argenteau, Mortier, Saint-Remy et Trembleur. Cette famille possède également des parts dans plusieurs autres sociétés charbonnières telles que celles de Bonne-Foi-Homvent-Hareng, Cheratte, Housse, Wandre ou Xhendelesse.
À sa mort en 1809, Gaspar laisse cinq enfants15 : quatre fils et une fille. Trois d’entre eux, Jean, Philippe et Urbain, reprennent une partie de l’héritage paternel dans les houillères de la région et poursuivent l’extraction. Ils introduisent même deux demandes en maintenue et en extension de concessions en 1810 et 1818. Les aléas des successions de régimes retardent l’octroi de celles-ci, nommées « Argenteau » et « Trembleur », qui ne seront finalement accordées qu’en 184816.
À l’époque, les Corbesier possèdent plusieurs puits de mines, notamment le puits des Trois Frères, sur la commune de Trembleur, le puits Urbain, sans oublier celui de Bouhouille, ces deux derniers étant situés sur Saint-Remy. L’exploitation parait s’y dérouler de manière aléatoire : les puits sont tantôt en activité, tantôt abandonnés, avant d’être à nouveau aménagés et rouverts à l’extraction.
L’exploitation erratique est ainsi mise en exergue par le Corps des mines qui relève aussi des difficultés internes à l’entreprise « Corbesier Frères ». Trop éloignée des voies de communication, affrontant des conditions de gisement difficiles et une abondance des eaux d’infiltration, usant de méthodes d’exploitation discutables, exploitant par un nombre de sièges trop important ce qui nécessite l’emploi d’un personnel trop nombreux, la question de la survie de la société est soulignée par l’ingénieur des mines Auguste Ransy : « nous pensons d’ailleurs que nous sommes bien loin de l’époque où il deviendra nécessaire d’asseoir un grand siège d’exploitation dans la région méridionale non seulement sur Bouhouille mais aussi sur Trembleur. En effet, la localité que nous considérons est dépourvue de grandes voies de communication et ne renferme pas assez de consommateurs pour acheter le charbon qu’il serait nécessaire de tirer au jour pour assurer un bénéfice à l’exploitant. La houillère des Trois frères qui, sous ces rapports, est dans de meilleures conditions, ne parvient même pas à écouler la faible extraction qu’elle produit. Le magasin considérable de houille qui encombre aujourd’hui et depuis longtemps cet établissement en est la preuve17. »
Cette conclusion pessimiste ne dissuade nullement les frères Corbesier d’entamer le creusement de ce qui deviendra le puits Marie dès le premier semestre 184918. Le puits est maçonné et les bâtiments abritant le puits et les machines sont terminés en décembre de la même année. Le 24 juillet 185019, ils reçoivent l’autorisation d’installer deux machines à vapeur de 30 et 16 CV avec trois chaudières destinées à l’épuisement des eaux et à l’extraction. La profondeur du puits est portée à 88 mètres et on y monte une première belle-fleur.
Mais dix ans plus tard, le siège Marie n’est toujours pas en activité. En 1863, d’ailleurs, le puits est encore en avaleresse. Cela peut, du moins en partie, s’expliquer par les disparitions successives de Philippe et Jean Corbesier, en 1853 et 1854, et par les difficultés à rassembler les capitaux nécessaires à la continuité des travaux qui en auraient résulté.
Ce n’est qu’en août 1864 que l’ingénieur Deschamps mentionne finalement l’avancement de deux tailles, à partir du puits Marie, dans la couche Grande Fontaine à -170 mètres. Le puits atteint sa profondeur maximale, 236 mètres, et l’entreprise pense même construire un chemin de fer à la surface pour relier l’axe Liège-Maastricht.
Malheureusement, la mort d’Urbain Corbesier qui survient en 1867 reporte le projet. Gaspard Corbesiera prend le contrôle de l’exploitation et tente de relancer l’entreprise familiale. Pourtant, les activités ralentissent avant d’être finalement interrompues. En 1872, la houillère Marie est à l’abandon avant d’être mise en réserve l’année suivante. L’épuisement des eaux s’effectue par un autre puits, probablement le puits de Saint Remy (ou puits Hayoulle), ouvert plus tard, car les pompes du puits Marie sont inactives.
La relance s’engage finalement le 23 février 188220, date à laquelle se constitue la Société anonyme des charbonnages d’Argenteau-Trembleur. Bien que l’actionnariat se diversifie, il reste en grande partie dans le giron de la famille Corbesier. Gaspard Corbesier, qui est également bourgmestre d’Argenteau, devient président du Conseil d’administration.
Gaspard Corbesier se dit très confiant dans l’entreprise lorsqu’il conclut son rapport à l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1882 : « nous marchons donc dans les conditions les plus rassurantes. Tout nous donne l’assurance que l’exercice prochain clôturera à notre entière satisfaction21. »
Comme pour confirmer ces propos, on agrandit une nouvelle fois le puits Marie en 1883, afin de pouvoir y installer deux chaudières neuves, un culbuteur ainsi qu’une machine d’extraction de 50 CV et une belle-fleur en provenance du charbonnage de Cheratte, où les travaux ont cessé depuis 1878.
L’année 1883 est aussi marquée par la réunion des deux concessions sous le nom d’Argenteau-Trembleur et par l’établissement de voies ferrées.
Malheureusement, la situation semble plus difficile que jamais : « l’exploitation y est tout à fait insignifiante22 » lit-on dans un rapport de l’ingénieur Van Scherpenzeel-Thim. La société ne se porte pas bien, même s’il est vrai qu’elle réalise des travaux d’aménagement très importants. En 1885, la démission du directeur, Dieudonné Dupont, entraîne la désignation de Gaspard Corbesier comme administrateur-délégué.
Quelques mois plus tard, le puits Marie est abandonné et, le 10 août 1887, la Société anonyme des charbonnages d’Argenteau-Trembleur est mise en liquidation.
Malgré un dernier sursaut en 1891 au cours duquel un ancien administrateur, Charles de Ponthière, rachète l’entreprise et tente vainement de remettre en route une activité viable, toute exploitation cesse à cause des eaux aux alentours de 1896 jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale.
Au xxe siècle
À l’issue de la Grande Guerre, l’exploitation houillère est arrêtée depuis près de vingt ans dans la région de Trembleur lorsque Charles de Ponthière, ancien administrateur de la S.A. des charbonnages d’Argenteau-Trembleur et propriétaire du charbonnage ainsi que de sa concession, s’associe avec Alexandre Ausselet, un entrepreneur carolorégien déjà propriétaire de deux autres charbonnages à Tamines et à Villers-le-Bouillet.
Le 27 octobre 1919, ces deux associés, rejoints par un groupe d’industriels « courageux et énergiques, portés par l’enthousiasme de la reconstruction des dommages de la guerre23» et « attirés par la qualité extraordinaire de l’anthracite qu’on trouve dans cette concession24 », fondent, à Bruxelles, la Société anonyme des Charbonnages d’Argenteau.
La relance de l’exploitation
Dès 1920, l’entreprise réalise d’importants travaux de premier établissement. Ces travaux comprennent entre autres la réfection du puits Marie, la création de nouveaux étages d’exploitation, la construction d’accrochages, d’écuries et de salles de machines, l’achat de terrains, la construction de bâtiments, l’achat de machines et de moteurs, l’établissement d’installations électriques, sans oublier la réalisation de sondages et de recherches dans la concession ainsi que le creusement du puits No 1.
De 1920 à 1940
Le puits No 1
Le puits No 1 est foncé à l’aube des années 1920 jusqu’à la profondeur de cent septante mètres. Le creusement est réalisé à l’aide de mines et d’explosifs et la paroi intérieure est revêtue d’une maçonnerie en briques. Après une interruption en 1923, le fonçage reprend l’année suivante mais il faut attendre 1929 pour atteindre le niveau de deux cent trente-quatre mètres.
À la fin du mois de décembre 1925, une importante crue frappe la région liégeoise provoquant l’inondation de la vallée mais également l’ennoyage du charbonnage d’Argenteau par suite de la coupure d’alimentation électrique en provenance de la centrale de Bressoux, propriété de la Société intercommunale belge d’électricité. Cet incident a d’importantes conséquences sur la production de l’année 1926 qui enregistre une chute de près de 10 000 tonnes par rapport à 1925 ! L’année suivante, la société connaît de nouveaux déboires de production : c’est une « grande grève25 » de deux mois qui en est à l’origine.
Le puits No 1 est équipé d’une machine d’extraction électrique, toujours en cours de montage en 1927 : « les travaux sont abandonnés depuis de nombreux mois. Les dispositifs de freinage ne sont pas encore installés26. » La garniture du puits se poursuit cependant : on l’équipe de garde-corps, d’un guidonnage, d’une passerelle et d’un escalier autour de la recette.
Étonnamment, la crise de 1929 ne ralentit pas la production. Ce succès est redevable à la qualité exceptionnelle du charbon produit par les veines dites des 7 poignées et des 15 poignées.
Malheureusement, l’entreprise perd la trace de ces deux veines peu de temps après, ce qui provoque une nouvelle diminution des résultats d’extraction. Comme la prospection n’offre aucune réserve nouvelle, un premier projet de fermeture voit le jour vers 1934-193725 .
Cependant, c’est sans compter le « flair du jeune ingénieur Jacques Ausselet23 », fils d’Alexandre Ausselet, et le hasard (« ne dit-on pas que son intuition fut confirmée par un pendule23»), conjugués aux recherches plus conventionnelles et aux études du gisement qui permettent finalement de retrouver des veines qui assureront l’exploitation jusqu’en 1980.
La paire
Les aménagements en surface ne se limitent pas au Puits No 1. Le terrain entourant l’orifice du bure fait lui aussi l’objet de lourds travaux. Entre 1922 et 1923, l’entreprise se lance dans une politique d’acquisition de parcelles en vue de l’installation de la nouvelle paire, de son nivellement et de l’agrandissement progressif du terril.
Les propriétaires du charbonnage décident d’utiliser « la terre et l’argile des morts terrains pour fabriquer des briques et construire tous les bâtiments23 ». Pour ce faire, ils obtiennent diverses autorisations d’établissement de briqueteries temporaires entre 1920 et 1923. De ces constructions, il subsiste encore le magasin, la forge (tous deux transformés en hall d’accueil et en vestiaires) et une partie des anciens bureaux, rachetés dès la fermeture par un particulier.
Le puits Marie
Le puits Marie est en travaux jusqu’en 1923. On y place entre autres les compresseurs en ligne Lebeau et François, que l’on peut toujours voir aujourd’hui. En attendant la mise en service du puits No 1, il est toujours utilisé comme puits d’entrée d’air et sert à la translation du personnel ainsi qu’à l’évacuation des produits grâce à une nouvelle machine d’extraction à vapeur fabriquée par les Établissements Beer de Jemeppe-sur-Meuse et installée en 1924. Le bâtiment subit plusieurs modifications consistant en des agrandissements successifs.
De 1940 à 1980
Le 10 mai 1940, l’extraction est brutalement arrêtée par la destruction de la tour d’extraction du puits No 1 par l’Armée Belge et le pilonnage des installations de surface lors des échanges d’artillerie entre Allemands et Belges. Seul le puits Marie en sort épargné.
« Nous sommes le seul charbonnage de Belgique où une telle destruction a été opérée par l’Armée. Nous n’en connaissons pas les raisons27. » L’armée belge craint que la tour d’extraction, située à trois kilomètres à vol d’oiseau du fort de Barchon, ne serve de point d’observation pour les Allemands. Elle procède alors à la destruction de la tour du charbonnage, « en faisant sauter de grosses charges d’explosifs placées contre les montants en béton de la tour28», et du clocher de l’église Sainte-Gertrude de Blegny.
La puissance des explosions au charbonnage est telle qu’elle touche irrémédiablement la plupart des installations de surface : triage, lavoir, lampisterie, ateliers, magasins, bains-douches, sous-station électrique, bureau, etc.
Faute d’alimentation électrique, les installations d’exhaure cessent de fonctionner et laissent les eaux envahir les chantiers souterrains, jusqu’au niveau de 170 mètres.
Après la destruction des infrastructures, le travail reprend durant les mois de juillet et août par le déblayage de la surface et l’enrayement de l’inondation des puits et des galeries.
La reconstruction proprement dite débute en juin 1942 par l’érection d’une nouvelle tour d’extraction et ce, malgré l’absence d’autorisation des Allemands et les nombreuses difficultés pour se procurer le matériel nécessaire.
Durant la réfection du puits No 1, on installe sur le puits d’aérage du puits Marie, un treuil d’extraction électrique qui permet de faire descendre deux cages au niveau 170 mètres. Cette installation sert à la translation des pompiers et à l’exécution de travaux de recarrage et d’entretien.
Cependant, l’extraction reste nulle. Les dirigeants choisissent la voie de la résistance économique. « S’ils avaient tout fait pour sauver l’outil, ils mirent autant d’ardeur à ne pas exploiter pour le compte de l’ennemi29 ! » C’est parce qu’il est finalement menacé de déportation que Jacques Ausselet se résigne à relancer la production en 1944, en la limitant toutefois entre 25 et 30 tonnes par jour, soit dix fois moins qu’avant-guerre. Une installation de triage manuel, toujours visible aujourd’hui, est placée sur la paire, dans l’attente de l’établissement d’un nouveau triage-lavoir.
Entretemps, Jean Ausselet, son frère, procède à l’engagement de personnel en nombre supérieur à celui nécessité par la production afin d’éviter les départs d’ouvriers vers les usines et fermes du Reich.
Après la seconde guerre mondiale, la grande reconstruction étant terminée, le charbonnage décide l’approfondissement du puits. Le 27 juillet 1956, le niveau bas de l’avaleresse atteint 459 mètres et, le 15 janvier 1960, le creusement atteint la cote maximale de 760 mètres. On exploite ainsi par les niveaux de 85, 170, 234, 300, 350, 430 et 530 mètres.
Le triage-lavoir et la recette
Parallèlement à l’érection de la nouvelle tour d’extraction, la reconstruction du triage débute en 1942. Les piliers en béton de la recette et du triage sont coulés entre septembre 1943 et mai 1944. L’étage de la recette est aménagé fin 1945.
Le nouveau triage-lavoir est opérationnel dès décembre 1946. Celui-ci est agrandi en 1948 et en 1955-1956, par la société Evence-Coppée de Bruxelles. Il fonctionne d’abord à l’argile, puis à l’eau lourde (eau + magnétite) à partir de 1956.
En 1972, l’étude d’un nouveau lavoir à poussier est entreprise et sa construction est réalisée en 1973 par l’entreprise Donnay de Blegny. En 1975, le lavoir est opérationnel.
Les terrils
Le premier terril, dit vieux terril ou ancien terril, est constitué après 1920. Christine Wirtgen précise qu’il est « né en 192530 » et « a été chargé jusque 1940 environ. Brûlé, il est recouvert d’une végétation partiellement naturelle, partiellement plantée par l’exploitant30 ».
Un abri pour le treuil de la mise à terril est construit en 1928. Une première mise à terril est placée en 1929 et des terrains sont achetés en vue de l’extension du terril en 1934.
Une nouvelle mise à terril est construite en 1943, équipée de skips. Elle permet la constitution du deuxième terril, alimenté jusqu’aux derniers jours de l’exploitation.
« Le nouveau terril déborde sur l’ancien. Sa forme tronquée est due à l’échéance de la fermeture qui plana sur le charbonnage à partir de 1975 et qui l’empêcha de se développer normalement. Effectivement, la machine de la mise à terril ne pouvait pas tirer les wagonnets sur une pente plus forte. Comme il n’était pas possible d’amortir une nouvelle installation en 5-6 ans, la direction choisit d’étaler le terril29.»
L’entrée
Le portique d’entrée remonte à 1954. Il est construit en moellons et en béton. Dessinés par l’architecte Cerfontaine, les plans prévoient initialement le placement de la guérite à droite du portique.
Dans les années 1970 (?), l’arc de béton coiffant la grille principale est coupé en raison de l’évolution de la taille des camions : il leur devenait en effet impossible de pouvoir passer sous le portique.
La laverie
Un arrêté royal du 3 mars 1975 impose aux industries extractives la généralisation de la fourniture de vêtements de travail pour chaque ouvrier. Pour s’y conformer, le charbonnage d’Argenteau envisage la construction d’un bâtiment « pour le stockage des vêtements de travail que nous devons distribuer à partir du 1er janvier 197631. »
Le charbonnage fait appel à l’entreprise Herman Palmans à Dalhem pour l’érection de la nouvelle bâtisse, parée à l’extérieur de dalles SIPOREX.
Reconversion
Dans les années 1960, le Ministère des affaires économiques mène des recherches de reconversion pour les sites industriels – y compris charbonniers – et pour le reclassement du personnel. Des brochures à destination d’investisseurs potentiels sont éditées et mettent en valeur les avantages que des sites désaffectés « offrent pour l’implantation d’industries nouvelles32 ». Malheureusement pour le charbonnage de Trembleur, son site n’est pas retenu dans l’édition qui sort de presse en 1970.
La loi sur l’expansion économique du 30 décembre 1970b donne une nouvelle chance au charbonnage de s’inscrire dans une démarche de reconversion, d’autant plus que les autorités semblent disposées à accorder « un préjugé favorable aux régions charbonnières33 ». Sans plus de succès.
Au niveau de la production, l’année 1970 représente un record pour la houillère de Trembleur. Cette performance arrive à point, au moment où les responsables politiques s’apprêtent à programmer de nouvelles fermetures. Grâce à sa production de 1970, le 13 février 1975, le Comité ministériel de coordination économique et sociale décide d’arrêter toute subvention au charbonnage à la date du 31 mars 1980. Il est ainsi le dernier siège du bassin de Liège à fermer ses portes.
Entretemps, des pistes de reconversion sont étudiées : exploitation du terril, utilisation du triage-lavoir, reconversion touristique. Jacques Ausselet s’adresse à l’ingénieur Modeste Petitjean de l’Administration des Mines afin qu’il étudie les solutions envisagées. L’étude conclut à des perspectives peu encourageantes. Jacques Ausselet se tourne alors vers Jean Defer, directeur des travaux, qui a déjà défendu l’idée d’une reconversion touristique. Et, de fait, depuis 1973, le charbonnage accueille un embryon d’activité touristique, connu sous le nom du Trimbleu, qui s’appuie sur l’exploitation de l’ancienne ligne vicinale Trembleur-Warsage. Jacques Ausselet charge Jean Defer de finaliser une reprise par la Province de Liège, sur base de la proposition formulée en 1976 par son Gouverneur de l’époque, Gilbert Mottard, de conserver un signe de l’attachement de la région à la houillerie.
Ce projet est avalisé par le Conseil provincial et la Députation permanente de la Province de Liège le 13 mars 1980 et ne s’arrête pas à la conservation du site charbonnier mais vise également à l’exploitation touristique des travaux souterrains.
Les premières visites se font aux étages « historiques » de 170 et 234 mètres. Mais l’affluence des eaux due à l’arrêt du pompage des charbonnages avoisinants et à la croissance des précipitations depuis 1977 pèse sur la santé financière du projet.
Le projet est revu dès 1981 et un nouveau circuit voit le jour deux années plus tard après quelques mois de fermeture de la mine au public. Il permet les visites aux étages de 30 et 60 mètres en empruntant toujours le puits No 1. Un nouveau puits d’aérage est aménagé derrière les anciens bureaux, entraînant la fermeture irrémédiable et le remblayage du Puits-Marie. Depuis les années 1990, le domaine touristique de Blegny-Mine s’est sans cesse amélioré et développé dans son offre touristique. En 2020, on peut citer: plusieurs visites guidées et quotidiennes de la mine, un vaste parking de 200 places, une boutique de souvenirs et cadeaux, un restaurant ouvert tous les jours, une terrasse en été, une grande plaine de jeux pour enfants, un tortillard pour promener les touristes à la découverte de la région, et un circuit de promenade pour piétons, cavaliers et cyclistes (parcours de l’ancien train touristique).


Une maison de culture contemporaine. Le mitoyen de l’atelier Mano, maison d’architecture. Un parcours où les deux maisons communiquent. Surtout un désir, une audace, une envie. L’envie de faire découvrir des artistes. Les artistes s’exprimeront dans douze pièces pour partager, faire comprendre, donner à voir…




Le « Val Mosan », bateau touristique de Huy (province de Liège), propose des croisières culturelles, navettes, croisières gourmandes,…

Pour toute demande ou information, merci de vous adresser à info@bucolique.be.

La montagne Bueren se fleurit durant quelques jours : faites la découverte magique du cœur historique de la Cité Ardente. Une biennale à ne pas manquer à Liège !
Nouvelle édition durant laquelle la Montagne de Bueren sera littéralement « envahie » par des milliers de fleurs. Tous les deux ans, les marches se voient parées d’une splendide et spectaculaire fresque florale.
Des escaliers chargés d’Histoire
Construit en 1875, l’escalier monumental de Bueren relie, pour rappel, le centre historique de Liège à sa citadelle et évoque la » bataille des 600 Franchimontois » qui, guidés par Vincent de Bueren, défendirent Liège contre Charles le Téméraire.
Les escaliers de Bueren, à Liège, ont été élus « escaliers les plus extrêmes du monde » par le magazine américain en ligne Huffington Post en septembre 2013, devant les célèbres temples d’Angkor , au Cambodge !
Bueren en fleurs…et en chiffres
Pas moins de 22.300 plantes annuelles (5.500 de plus que lors de la 1ère édition) réparties en 7.400 contenants seront nécessaires à la réalisation du tableau floral.
80 agents mobilisés durant les 2 jours de mise en place (6/6 et 7/6 de 8h30 à 16h).




Historique:
« La Bouch’rit » est un des cafés-théâtres liégeois. Il a été créé en 2001 par l’association de 3 personnes dont le directeur Christophe Locicero. En 15 ans d’existence, la popularité n’a pas diminué. Situé dans la rue commerçante Saint-Gilles, il est à la vue de nombreux passants et tire ainsi avantage de son emplacement.
Inspiré du concept français, c’est un petit théâtre où il est possible de boire un verre ou de manger un repas. Le prix du spectacle étant distinct de celui du repas, il n’est donc pas obligatoire de consommer.
Composée de 100 places réparties en 4 petites rangées proches, la salle procure un cadre assez restreint qui les oblige à s’adapter. C’est pourquoi les moyens techniques et le nombre d’acteurs sur scène sont très limités.


Cathédrale Saint-Paul de Liège
La cathédrale Saint-Paul de Liège fait partie du patrimoine religieux de Liège. Fondée au xe siècle, elle est reconstruite du xiiie au xve siècle et restaurée au milieu du xixe siècle. Elle devient cathédrale au xixe siècle en raison de la destruction de la cathédrale Saint-Lambert en 1795. Une nouvelle restauration est entamée durant les années 2010.
Historique
La légende

L’intérieur, chef d’œuvre du gothique mosan, est tout en lignes pures et d’une grande légèreté. L’élégante sobriété de la pierre bleue de Meuse est rehaussée au niveau des arcs par le tuffeau jaune d’or de Maastricht et le calcaire jaune de Lorraine. Les voutains sont peints de somptueux rinceaux du xvie siècle. L’église apparaît ainsi comme une « enluminure de pierre »1.
L’évêque Éracle venait de jeter les fondements de l’église Saint-Martin, lorsqu’il conçut le projet d’en élever en même temps une autre, dédiée à saint Paul. Seulement il était fort embarrassé de savoir le lieu le plus convenable à ses desseins, lorsque l’apôtre vint heureusement à son aide.
C’était pendant une belle nuit du mois de juillet; il avait fait une chaleur étouffante, et l’évêque, plongé dans un profond sommeil, se reposait des fatigues de la journée, lorsque, tout à coup, il eut une vision — on sait qu’Éracle en eut plus d’une en sa vie —, saint Paul se dressa devant lui, et, le regardant d’un air bienveillant : « Demain, lui dit-il, demain, mon fils, tu reconnaîtras facilement la place où je désire voir bâtir une église en mon honneur… ». Puis il disparut !
En effet, assure la tradition, le lendemain une neige épaisse couvrait la terre ; un espace de terrain d’une certaine étendue, et situé dans l’Isle, délimité par le bras de la Meuse appelé Sauvenière, en était seul exempt. Au milieu de la place désignée par saint Paul s’élevait une chapelle dédiée au pape Calixte Ier et qui datait des premiers temps de la Cité de Liège ; l’évêque traça aussitôt l’enceinte du nouveau sanctuaire, et y enferma la chapelle2.
Origine et érections
Chapelle Saint-Germain
En 967, l’évêque Éracle construisit cette église sur l’emplacement de l’église Saint-Germain bâtie en 833 par l’évêque Pirard à l’endroit où se trouvait une chapelle primitivement dédiée à saint Germain et fondée en 785 par Radulphe des Prez3. La basilique n’était élevée que jusqu’aux fenêtres lorsque Éracle mourut.
Éracle4,5 institua un collège de vingt chanoines auxquels Notger, qui acheva le bâtiment commencé par son prédécesseur, en ajouta dix autres.
Chapelle Saint-Calixte
Le hameau formé sur l’île s’était rapidement agrandi, à tel point qu’on dut construire une seconde chapelle à peu de distance de la première6: elle fut dédiée à Calixte Ier, pape et martyr. Les chroniqueurs attribuent sa fondation à Pirard 36e évêque de Liège et ajoutent qu’il y établit douze Bénédictins, seul ordre existant alors dans le pays de Liège7,8.
Collégiale Saint-Paul
Ce fut à son retour de Cologne, où il avait assisté aux obsèques de Brunon, archevêque de cette ville et vicaire de l’empire, qu’Éracle conçut le projet de construire une église en l’honneur de saint Paul9.
Premières dotations
Très peu d’informations subsistent quant aux biens dont Éracle dota le collège de vingt chanoines qu’il avait créé10. Il paraît cependant que l’évêque donne les dîmes de l’église de Lixhe (canton de Glons): ce qui est certain, c’est que la collation de cette église, qui fut érigée en paroisse vers l’an 1200, appartint au chapitre de Saint-Paul jusqu’à sa suppression par les Français, le 27 novembre 1797.
Notger consacra solennellement cette église le 7 mai 972 : deux autels y furent dédiés à Saint-Germain et à Saint-Calixte, en souvenir du culte rendu auparavant à ces deux saints, dans les chapelles qui leur avaient été vouées. Notger ayant pris la forteresse de Chèvremont, le 21 avril 980, la détruisit de fond en comble et démolit les églises qui s’y trouvaient. L’une d’entre elles, dédiée à saint Capraise, possédait un collège de dix prêtres ; l’évêque les réunit aux vingt chanoines de Saint-Paul et porta ainsi leur nombre à trente. Tous les biens, les rentes et les dîmes de Saint-Capraise furent transférés à la nouvelle collégiale, à laquelle Notger donna la cloche appelée Dardar, provenant également de Chèvremontnote 1.
Le comte Frédelon, cède l’église de Hamal dont l’anniversaire avait lieu le 27 août.
Bervesende, une veuve, donna l’église de Jodoigne ; son anniversaire se célébrait le 30 août.
Premiers prévôts et doyens connus
Godescalc[modifier | modifier le code]
La première mention authentique d’un Doyen et d’un Prévôt de Saint-Paul se rencontre dans une pièce de l’an 1083, extraite du cartulaire de cette Collégiale11. Il y est question de dommages causés dans l’alleu de Nandrin, propriété du chapitre, par Giselbert, comte de Clermont, et son complice Frédelon. L’évêque Henri de Verdun embrassa la défense des droits de l’Église ; et afin de les sauvegarder à l’avenir, l’avouerie de l’alleu de Nandrin fut confiée à un seigneur appelé Conon. Cette cérémonie eut lieu dans le temple même, le jour de la fête de Saint-Paul12.
Une pièce de l’année suivante atteste l’existence d’un cloître à cette époque et que les confrères de Saint-Paul portaient le nom de chanoines13.
En 1086, Godescalc institua plusieurs bénéfices (Eleemosynœ ou Prebetidulœ). Ils furent longtemps connus sous le titre de prébendes de Wouteringhen ou Wohange. Cette année encore, il fonda l’autel des saints Jean-Baptiste et Nicolas et de sainte Marie-Madeleine. C’est le plus ancien établissement d’un bénéfice simple qui nous soit parvenunote 2.
En 1101, le doyen Godescalc fut élevé à la dignité d’archidiacre de Liège, et décéda peu de temps après.
Waselin[modifier | modifier le code]
La collégiale voit, en 1106, s’adjoindre à ses propriétés une partie du territoire de Fragnée, acquis et partagé par Obert entre les églises du clergé secondaire14. Pour fonder son anniversaire, le 24 mars 1113, Wazelin fit donation à Saint-Paul de sa demeure avec toutes ses dépendances note 3.
Ce dernier loua les dîmes de l’église de Wendeshem moyennant une rente de 5 marcs de bon argent payable à Liègenote 4.
Nouvelles donations
Godefroid, comte de Louvain, en 1135, céda généreusement au chapitre de la collégiale les dîmes de la ville de Weert et de son territoire inculte ou cultivénote 5.
En 1182, le doyen Henri fait don de l’église paroissiale de Laminne au chapitre qui en conservera la collation jusqu’à sa suppression par la convention nationale le 20 mars 1797. Il lègue ensuite à la collégiale la terre d’Hodimont15
Ebalus devient doyen en 1185: la même année, une lettre parle de la cession de l’église de Hermalle-sous-Huy, faite à l’abbaye de Flônenote 6. Il donne à la collégiale l’église de Lavoir, consacrée à saint Hubert, dont le chapitre de Saint-Paul garda la collation jusqu’en 1797note 7.
Le pape Célestin III, par un diplôme (s) donné à Rome, le 14 avril 1188, confirme à l’église de Liége toutes ses possessions16.
Le doyen Jonas donne à la collégiale l’église de Saint-Georges et celle de Verlaine dédiée à saint Remy dès 1198.
Fondation du Val-Benoit et du Val des écoliers
Othon Des Prez, élu doyen va fonder, en 1220, sur la rive gauche de la Meuse, à une demi-lieue de la ville, le couvent du Sart, qui, cinq ans plus tard, perdra ce nom pour prendre celui du Val-Benoît, lorsque le cardinal-légat Conrad, évêque de Porto, en consacra l’église, le jour de la Pentecôte17.Il érigea ensuite à Liège le prieuré du Val-Notre-Dame, dans un endroit appelé alors Gravière, (aujourd’hui La Gravioule) et à Saint-Martin-en-Ile, il élève et dote, de ses propres deniers, un autel en l’honneur de saint Thomas de Cantorbérynote 8.
Nouvelle collégiale
Entravée probablement par la pénurie de fonds, l’érection du nouveau bâtiment ne progressait qu’avec lenteur. La tour paraît avoir été finie la première ; en 1275 le doyen Guillaume de Fraynoir y fait suspendre deux grosses cloches données par lui : l’une, en l’honneur du saint Patron de l’église, reçut le nom de Paula, l’autre celui de Concordia, nom de la mère de cet apôtre. Coulées au mois de juin 127518, elles annonçaient les offices célébrés par le doyen. La seconde de ces cloches, Concordia, sonnait toujours au xixe siècle ; elle sonne le ré des orgues et portait une inscription en lettres gothiques.
Consécration

Gravure de la collégiale Saint-Paul dans les années 1730 (par Remacle Le Loup).
Tout nous porte à croire que la reconstruction de la collégiale était fort avancée en 1289 ; en effet, le 11 avril, eurent lieu à la fois la consécration de l’église et la bénédiction des autels ; solennités célébrées par les deux suffragants de Liège, Edmont, évêque de Courlande en Livonie, et le frère Bonaventure, de l’ordre de Citeaux, évêque de Céanote 9.
Inondations, incendies et tremblement de terre
Inondations
Les charbonnages entourant Liège depuis le haut Moyen Âge, malgré l’interdiction de creuser sous la ville qui ne fut pas toujours respectée, creusant en aval et en amont ont eu pour conséquence de faire de Liège une cuvette et plus tard une digue. Malgré les remparts, les inondations se succédèrent de siècle en siècle.
Le 4 janvier 1374, la Meuse grossit tellement que le quartier de l’île fut envahi par les eaux et la collégiale Saint-Paul entièrement inondée au point qu’on ne pouvait y pénétrer qu’en bateau.
Le 28 janvier 1408, une inondation détériora aussi les livres et les bijoux dans la crypte, une partie des chartes, les livres, les ornements de la collégiale conservés dans la trésorerie, pour éviter de semblables désastres le sol de la nouvelle librairie est exhaussé et l’on y entre depuis par quelques marches.
Une forte inondation eut lieu en 1464. La neige était tombée en abondance durant plusieurs jours avant la fête de saint Capraise, les pluies qui suivirent amenèrent une telle crue que le lendemain de la fête de sainte Élisabeth, les flots gonflés de la Meuse menaçaient d’envahir la collégiale. Les chanoines n’eurent que le temps de faire boucher la porte à l’aide d’une sorte de digue et durent acheter un bateau pour aller aux matines. Ils usèrent du même moyen pour assister aux heures jusqu’au 23 novembre date à partir de laquelle ils purent se rendre à pied sec aux offices.
Le 7 février 1571 par suite d’une inondation l’eau s’éleva à une hauteur de 6,40 mètre. Le souvenir de ce débordement est conservé par le chronogramme suivant gravé sur le pilier droit du fond de la collégiale à côté du jubé. Le trait indiquant la hauteur de l’eau est à 0,84 cm du niveau actuel du pavé.
- aLto Mosa LoCo CresCens hVC appVLIt VsqVe
Le 15 janvier 1643, l’inondation qui emporta le Pont des Arches couvrit le quartier de l’Île et causa d’immenses dégâts. Les eaux de la Meuse s’élevèrent dans l’église Saint-Paul à 1,35 mètre au-dessus du pavé actuel Le souvenir de cet événement est rappelé par le chronogramme suivant gravé sur le pilier qui soutient la tour à droite du jubé.
- aLtIVs eXpanso fLVMIne DVXIt aqVas
Une plaque métallique datée de 1926 se trouve à droite de l’entrée de la cathédrale signalant la hauteur de l’eau lors de la dernière inondation. Depuis l’installation du démergement récupérant l’eau des araines et des égouts en aval et en amont, plus aucune inondation ne s’est produite.
Incendies[modifier | modifier le code]
Pendant la nuit du 6 avril 1456, un incendie éclata dans la chambre où couchait le recteur des écoles. Il fut heureusement sans conséquences.
Tremblement de terre
Le 24 décembre 1755 vers 4 heures de l’après dîner, on ressentit à Liège des secousses de tremblement de terre qui se répétèrent un quart d’heure avant minuit puis quelques minutes plus tardnote 10. Le tremblement de terre de 1983 a fait bouger les pinacles, certains ont dû être attachés19.
Nouvelles acquisitions
En 1460, le chapitre acquit certains immeubles de l’abbaye du Val-Saint-Lambert situés dans les villages de Ramet et d’Yvoz moyennant 100 muids d’épeautre à fournir annuellement. En outre il s’engageait à servir une rente à l’église de Saint-Servais de Maastricht en acquittement d’un droit de relief.
Fin des travaux et peintures de Lambert Lombart

Jean Del Cour : statue en tilleul de Saint-Jean Baptiste, datée de 1682, provenant de l’église Saint-Jean Baptiste en Féronstrée
Lambert Lombart[modifier | modifier le code]
En 1528 et 1529, on exécuta plusieurs travaux entre autres des peintures qui d’après un manuscrit sont l’ouvrage de Lambert Lombard et de ses élèves.
Verrière
En 1530 par la munificence de Léon d’Oultres la collégiale s’enrichit de la grande verrière éclairant au midi le bras gauche du transept. Cette fenêtre échappa aux ravages de la révolution française. Celle qui lui faisait face fut au contraire complètement détruite en 179420,21.
Fenêtres
En 1557 et 1558, de grands travaux furent encore exécutés sur l’église. Ainsi on trouve la première date sur la fenêtre centrale du côté Sud et sur la voûte en face de la grande nef; elle indique probablement l’époque de la construction ou de la réparation des fenêtres de ce côté. La seconde est sur la fenêtre correspondante du côté Nordnote 11.
Portail ouest
La construction du portail ouest sous la tour est attribuée au doyen Thomas Stouten (1556 à 1564): le fronton de ce portail est décoré des armes de Corneille de Berg qui succéda à Erard de La Marck mort le 16 février 1538 et de Robert qui régna de 1557 à 1564.
Imprimerie
Le nom du doyen Jean Stouten (1566-1604) se rattache à l’introduction de l’imprimerie à Liége. Le premier livre édité dans la Cité est le Breviarium in usum venerabilis ecclesiœ collegiatœ Sti Pauli Leodiensis sorti des presses de Gautier Morberius, premier imprimeur liégeoisnote 12.
L’église actuelle commencée en 1289, reconstruite en 1528 et achevée en 1557.
Le Christ de Del Cour
Après la destruction de la dardanelle élevée sur le Pont des Arches en 1790, le Christ qui se trouvait au-dessus de cette tour depuis 1663, œuvre de Jean Del Cour y fut transféré. Il surmonte depuis 1861 la porte d’entrée intérieure.
Révolution française
Après la bataille de Jemmapes, les Français poursuivirent l’armée impériale et entrèrent à Liège. La collégiale Saint-Paul est choisi pour servir d’écurie et d’abattoir et est donc presque complètement dévastée. Le chapitre de Saint-Paul subit le sort réservé aux autres édifices du culte par les vandales révolutionnaires : après avoir pillé le bâtiment, enlevé tous les métaux, détruit les principales verrières dont le plomb servit à fondre des balles, vendu à l’encan le mobilier, ils y installèrent une boucherie à leur usage ; les cloîtres étaient changés en étables22
Le calme rétabli par le triomphe des Impériaux ne fut pas de longue durée. Le 17 juillet 1794, les armées de la convention rentrent à Liège et la principauté fut annexée à la France. Le 10 décembre suivant, le Directoire exécutif décréta un emprunt de 600 millions pour faire face aux frais de la guerrenote 13.
De la Collégiale à la Cathédrale
Elle était à l’origine une des sept collégiales liégeoises (Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy).
En 180223, l’ancienne collégiale fut érigée en cathédrale et en 1805, on y transporte les orgues de l’ancienne collégiale Saint-Pierre et la plupart des trésors de Saint-Lambert.
Retour des reliques
Le 30 décembre 1803, l’Évêque écrivit au ministre des cultes Portalis pour demander que le gouvernement payât les frais et es indemnités dues pour les caisses rapportées de Hambourgnote 14. Ces caisses au nombre de six contenaient les reliques des Saints et les débris du trésor de Saint-Lambert restitués à la nouvelle cathédralenote 15. Un mois après, le 30 janvier 1804, Portalis répondit que le gouvernement avait décidé que le montant des objets livrés à Hambourg pour le service de la marine serait remboursé mais que ce service étant extrêmement surchargé par les circonstances présentes on ne peut prévoir le moment où il lui sera passible de payer les effets qui lui ont été cédés. Le trésor de Saint-Lambert saisi à Hambourg par les commissaires de la République qui accompagnaient les armées fut vendu en grande partie d’après les ordres du 1er Consul par le commissaire Lachevadière. La vente produisit près d’un million et demi qui fut appliqué aux besoins de la marine.
Indemnisation
Après la signature du Concordat en 1801 et le rétablissement du culte, Bonaparte fit délivrer à la Cathédrale une reconnaissance d’un million à payer sur le trésor de l’État mais cette dette ne fut pas acquittée pendant la période impérialenote 16.
Restitution
En 1805, conformément à ses promesses le gouvernement impérial par un décret du 6 mars suivant attribua aux fabriques des églises leurs biens non aliénés ni vendus. Ce décret permit à la nouvelle Cathédrale de rentrer en possession d’une partie des biens et des rentes qu’elle possédait avant la révolution et le 16 septembre la Cathédrale fut mise en possession d’une partie des biens et rentes provenant de Saint-Lambert.
Translation de Saint-Lambert
En exécution du mandement de l’évêque Zaepffel, la cérémonie de la translation du buste de Saint Lambert et des reliques des Saints eut lieu le 1er janvier 1804note 17. Elle avait été annoncée la veille par le son des cloches de toutes les églises. Elles avaient été entreposée à Saint-Nicolas Au-Trez.
Érection du clocher

Cathédrale Saint-Paul (milieu du xixe siècle )
Aquarelle de J. Fussell
La collégiale n’avait anciennement qu’un petit clocher dont on peut voir encore le dessin dans Les Délices du Pays de Liège; le chapitre souhaitait construire une flèche, cherchant à reproduire la forme de celle de Saint-Lambert. Le chapitre cathédral se rassembla le 28 juin 1810, pour délibérer sur l’érection d’une tournote 18. Le lendemain 29 juin, le chapitre décida de construire la tournote 19 d’acquérir à cet effet la flèche de la tour de l’abbaye de Saint-Trond. Mais ce n’est qu’en 1812, à la suite d’une demande de Napoléon Bonaparte, que la tour, avec ses fenêtres ogivales, sera élevée d’un étage et que le clocher sera installé. La face tournée du côté de l’ouest est percée d’une immense fenêtre à meneaux flamboyants. La partie qui s’élève au-dessus de celle-ci et qui contient les cloches est bâtie en pierres de sable provenant des tours carrées de l’ancienne cathédrale de Saint-Lambert. Sur chacun de ses trois côtés libres on a ménagé deux grandes fenêtres garnies d’abat-son. Sa construction fut terminée à la fin du mois d’octobre de l’année 1811, elle remplaça la charpente de la tour primitive qui jusqu’à cette époque ne s’élevait qu’à la hauteur du toit et qui fut démolie au mois de mai de la même année. La flèche en charpente qui termine la tour s’élève à une hauteur de 90 mètres elle a été commencée aussitôt après l’achèvement de la partie précédente et finie vers la fin du mois d’août 1812. La croix qui la domine fut placée le 1er octobre suivant.
Le carillon
On y place le carillon de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert dont le gouvernement impérial avait fait don à la nouvelle cathédrale en 1804note 20.
Restaurations
xixe siècle
Dans les années 1850, la cathédrale subit une profonde rénovation effectuée par l’architecte Jean-Charles Delsaux avec l’ajout d’un décor néo-gothique au style roman d’origine24,25.
xxie siècle
La restauration de l’aile ouest du cloître, occupée par le trésor de la cathédrale et visible depuis la place Saint-Paul, s’est terminée en décembre 2012 pour un coût d’environ 2,6 millions d’euros25.
En préparation depuis 2011, une restauration est entamée fin 2016 pour une durée de 5 ans, avec une fin prévue au plus tôt en 2021 et un coût de 8 millions d’euros26,27,28. Principale partie concernée, l’extérieur (toiture, façade et charpentes) devrait s’approcher de son aspect originel du xiiie siècle (tuffeau et gris du calcaire). La restauration permettra de réinstaller le vitrail de Léon d’Oultres, datant de 1530 et démonté vers 1990 pour le préserver19. Une restauration des orgues, des peintures des voûtes et des vitraux modernes est également prévue19.
Description
Les trois nefs
La collégiale Saint-Paul a la forme d’une croix latine de 84,50 mètres de longueur sur 33,60 mètres de largeur et 24 mètres de hauteur sous clef Le transept a une longueur de 33 mètres sur 11,60 mètres de largeur. Le vaisseau est partagé en 3 nefs, 2 bas côtés et un chœur sans collatéraux. Son architecte est inconnu.
L’abside construite au xive siècle en style rayonnant est de forme pentagonale. Le chœur, le transept, la grande nef et les nefs latérales datent du xiiie siècle et présentent tous les caractères du gothique primaire. Le gothique secondaire se retrouve dans les fenestrages du transept, les hautes fenêtres du vaisseau, les chapelles latérales et la tour. La galerie supérieure, surchargée de pinacles à crochets, est moderne, comme l’étage à fenêtres ogivales et la flèche du clocher, accostée de quatre clochetons. Le linteau du portail porte une inscription qui figurait jadis sur le sceau de la ville : Sancta Legia Ecclesiae Romanae Filia (Liège sainte, fille de l’Église romaine). Tous les marbres rouges qui se trouvent à Saint-Paul viennent de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort, les marbres noirs de Dinant et les blancs d’Italie provenant de Carrare.
Le cloître
L’ancien cloître chapitral de la collégiale se compose de trois galeries communiquant librement entre elles et s’ouvrant dans l’église par deux portes, l’une placée au fond du bâtiment l’autre contiguë au bras gauche du transept. Avant la construction des chapelles des bas côtés pour ajouter à la solidité au bâtiment et pour son embellissement le cloître était carré, on peut en voir les vestiges dans les greniers au-dessus de ces chapelles. Ces galeries construites à des époques différentes datent de la fin du xve siècle et du commencement du xvie siècle29. La première partie du cloître fut posée le 6 juin 1445 par Daniel de Blochem. Elles forment les trois côtés d’un carré long orientés à l’est au midi et à l’ouest la quatrième galerie est remplacée parle bas côté gauche de la collégiale. Elles circonscrivent un préau et diffèrent l’une de l’autre. La galerie ouest est plus ancienne que les autres et son ornementation est aussi plus soignée. Longue de 17,50 sur 4,75 mètres de largeur, elle communique avec la collégiale par une porte surmontée d’un grand Christ en bois fort ancien30.
Entrée du cloître
À côté de la porte qui donne entrée dans l’église à l’extrémité nord de cette galerie une seconde porte s’ouvre sur un beau portail situé au pied de la tour donnant sur la place Saint-Paul. Ce porche charmant est remarquable par ses profondes voussures chargées d’ornements et sa curieuse décoration en partie ogivale est de la Renaissance. Ce portail fermé par une grille de fer et orné d’un médaillon central en pierre encadrant un haut relief représentant la Conversion de Paul placé entre deux bas reliefs et les arabesques des panneaux inférieurs encadrent deux petits bas reliefs, l’un à droite figurant la Nativité, l’autre à gauche figurant la Résurrection du Sauveur. Une série de douze bas-reliefs représentent huit têtes encadrées et des ornements fantastiques. Sept niches sont restées veuves de leurs statues. Le pignon qui le surmonte porte les armes de Corneille de Berghes, prince-évêque de Liège de 1538 à 1544.
Salle du chapitre
On entre par les cloîtres du côté de l’est dans la chapelle de la salle du chapitre. La porte extérieure provient de l’église de l’ancien couvent des Récollets situé dans le quartier d’Outremeuse, elle fermait l’entrée du chœur où elle était placée entre deux autels. Cette porte en bois de chêne richement sculpté est à deux vantaux la côte représente le perron liégeois sur les panneaux supérieurs sculptés à jour et élégamment ouvragés figurent les deux lettrés LG.

Association qui vise à la relocalisation, démocratisation et décarbonation de notre alimentation

Le château de Sclessin est situé à Sclessin, une entité de la ville de Liège. Le Château est occupé par deux ASBL : Le théâtre de l’Aléna et Le Centre Antoine Vitez
Historique
Les seigneurs de Berlo
Depuis le milieu du xiiie siècle et pendant près de six siècles, les propriétaires du château de Sclessin furent les seigneurs de Berlo, seigneurs de Sclessin et avoués héréditaires d’Ougrée. C’est Gérard de Berloz, grand maréchal et général de Henri de Gueldre, qui acquit la charge d’avoué de Sclessin vers 1250.
L’avoué est le seigneur chargé de défendre les intérêts du prince, en l’occurrence, le prince-abbé de Stavelot-Malmédy à Sclessin et Ougnée. Il fait exécuter les sentences de la Cour de Justice, dont le perron (ou pierre de Justice) se dressait en « Lairesse ». Il percevait aussi les redevances et protégeait le domaine contre toute incursion, pillage ou autres dommages. En retour, il percevait le tiers des amendes.
Les avoueries de Sclessin et d’Ougnée étaient un fief du comté de Looz.
En 1253, Gérard de Berloz, harcela maintes fois les Liégeois qui, sous la conduite du tribun Henri de Dinant, s’étaient révoltés contre leur prince-évêque. Ils en tirèrent vengeance « en prenant prise sur ses terres » et, après avoir « ravagé et jardins et tous les dehors, ils pillèrent et démolirent sa tour, son château de Sclessin ».
Gérard de Berloz fils se met du parti des Waroux. Avec ceux de Sclessin, il se distingue à la bataille de Loncin. Le plus jeune des frères de Flémalle, du clan des Awans, fut tué en 1298 par Warnier du lignage de Sclessin…
Raes de Berlo fit le relief de l’avouerie et du château en 1371.
Guillaume et Libert sont tués au siège de Gand en 1381.
Le 27 novembre 1400, l’abbé de Stavelot céda en accense perpétuelle la seigneurie de Sclessin et d’Ougnée à Jean de Berlo dit de Brust qui en était déjà l’avoué, moyennant une rente annuelle de 47 muids (115 d’épeautre). Il ajoutait ce titre à ceux qu’il possédait déjà : seigneur de Brus (lez Glons), de Saive et de Julémont. Cette seigneurie resta dans cette famille jusqu’à la Révolution.
Parmi les aînés, la lignée des de Berlo compta plusieurs bourgmestres de Liège, deux évêques de Namur et de grands généraux tels Gérard, Grand Maréchal de Henri de Gueldre (déjà cité) et Guillaume, à qui fut confié l’étendard de Saint-Lambert en 1467, lors de la bataille de Brustem.
En 1568, le château est incendié par les troupes du Taciturne.
Plus tard, sous l’Espagne et l’Empire d’Autriche, plusieurs de Berlo trouvèrent encore la mort sur les champs de bataille : Melchior devant Mons, Arnould à Brisach et Hubert, en 1646, au siège de Dunkerque.
Au xviie siècle : Incendie du château et modifications
Gravure de Remacle Le Loup
Le château et ses dépendances furent ravagés par un incendie en 1681 et il subit des modifications successives réalisées par ses différents propriétaires.
Ce château fut réédifié par François-Ferdinand de Berlo, comte de Berlo, seigneur de Sclessin, grand-mayeur de Liège, mort en 1713 « sans l’avoir conduit à la perfection ».
En 1717, le comte de Berlo, seigneur de Sclessin, voulut obliger la Cour de Justice de l’endroit à tenir ses réunions en son château. Les échevins refusèrent de se soumettre à ces exigences. Alors le comte résolut d’employer la force. Le 12 janvier, il fit cerner le local ordinaire de la Cour par des paysans armés. Quand le greffier, appelé Montfort, sortit, on le saisit par le collet et on l’emmena prisonnier au château. Le conseil privé du prince-évêque ayant été informé de cette arrestation arbitraire envoya à Sclessin un détachement de troupes avec ordre d’assiéger le château, si le comte de Berlo refusait de remettre immédiatement son prisonnier en liberté.
Le 14 janvier, le sieur Richard qui commandait le détachement, arriva à Sclessin et fit entourer le château. Il se rendit ensuite auprès du comte et lui exposa l’objet de sa mission. Le comte voyant bien qu’il ne pouvait résister se soumit et rendit la liberté au greffier Montfort.
En 1731, un Gérard de Berloz périt à la bataille de Basse-Wilve (Wassweiler) près de Justiers.
Une gravure de Remacle Le Loup dans « Les Délices du Pays de Liège » de 1735 nous montre l’aspect du château à cette époque. Dans cet ouvrage, Saumery en donne une description :
« Situé au bord de la Rivière qui baigne les murs de son enceinte, et dont il a les agréments sans être exposé à ses incommodités, il offre à la vue deux gros pavillons flanqués de deux Tours quarrées, qui malgré leur structure rustique ne laissent pas d’être de bon goût. Un superbe Donjon surmonté de plusieurs lanternes placées par étages, s’élève à l’entrée de la Cour, entre deux corps de logis très bien bâtis, qui faisant face aux deux Pavillons dont je viens de parler, forment un coup d’oeil qui plait par sa régularité.
On y voit avec plaisir une large Terrasse soutenue d’un mur de pierre, qui entoure un beau Jardin. Les agréables Charmilles dont elle est ornée dans toute son étendue, sont des mieux entretenues. De ce lieu charmant on découvre de près tout ce qui se passe sur la Rivière, & sur ses deux rives, & la vue après s’être arrêtée sur différents objets, à des distances proportionnées, se perd dans des lointains très variés. Le Village du même nom, l’Eglise qui est assez belle, & plusieurs Maisons de plaisance paraissent être placés pour la perspective de ce château, qui considéré dans toutes ses parties peut être mis au rang des belles Maisons de campagne. »
Pendant la Révolution française
En 1789, la Révolution bouleverse la France. On instaure le nouveau régime fin 1795 en Belgique. Tous les droits seigneuriaux séculaires ont vécu. La souveraineté de la noblesse disparaît. Les de Berloz ne sont plus rien. Le dernier seigneur de Sclessin fut Marie-Léopold-Joseph de Berlo de Suys.
Il fut exclu de l’État Noble en janvier 1791 par le prince-évêque Hoensbroeck pour avoir soutenu le mouvement patriotique pendant la révolution liégeoise.
« Cour, château, maison, étang, jardin, prés, bois, terres hérules, tenure et assise… Chaque génération ajoutait quelque chose…
Écuries, étables (stâ), bergerie (bièdj’rèye), un fenil (sina), une porcherie (ran d’poûrcès), un chartil (tchèrî), une grange (heûre), un four (forni), une brasserie (brèssène), une chambre pour domestiques…
… Ce qui forma un ensemble plutôt disparate et vieillissant, en partie vétuste, ce qui amène Arnould de Berlo et son épouse Marie de Cottereau, à construire un nouveau château en 1813. »
Pendant le xixe siècle : château dit hanté
Les de Sauvage sont cités comme propriétaires du château dès 18081. Les de Sauvage achètent le manoir mais non la seigneurie. Le temps est révolu des souverainetés locales. Les droits seigneuriaux, avec tout ce qui avait rapport au système féodal, ont été abolis sans indemnité quelconque dans la nuit du 4 août 1789. Le nouveau régime a été rendu applicable en Belgique en novembre 1795.
Quelques acquéreurs de châteaux s’y sont trompés. Et ils ont réclamé le bénéfice des revenus de certains droits supprimés. Mais les pouvoirs nouveaux, émanés de la nation, qui ne s’y méprenaient pas, eux, étaient prompts à rappeler la déchéance de la souveraineté nobiliaire.
En 1846, un conflit ayant éclaté entre la commune d’Ougrée et de Loets de Trixhe et sa femme née de Sauvage au sujet de la propriété du chemin de l’Espinette, l’administration communale termine l’exposé de ses moyens de défense par cette phrase : « Comment les de Sauvage se réclameraient-ils des titres des comtes de Berloz, les droits seigneuriaux ayant été abolis ».
À la fin du siècle, des revers de fortune accablent la famille de Sauvage. Et c’est l’abandon du château qui se délabre. On doit cependant à la famille de Sauvage l’aménagement de la partie centrale, joignant les deux pavillons.
Bientôt, on le dit hanté et on l’appelle le « château du diable » : « … Et l’homme courageux qui y pénètre seul, la nuit de la Saint-Sylvestre, et qui y inscrit, à minuit, son nom avec son sang verra sa fortune assurée!… »
Le 18 mai 1889, le Conseil communal charge le collège de demander à Madame de Sauvage-Vercour, l’autorisation d’ériger provisoirement en « succursale » la chapelle du château de Sclessin, à laquelle serait attaché en permanence un prêtre desservant.
C’est à Sclessin, dans l’enceinte du château, que le Football Club Liégeois a décidé de s’installer dès les premiers mois de sa création en 1893.
Au xxe siècle[
L’administration communale achète le château en 1913 (pour 100 000 francs). Elle se proposait d’y aménager des classes, le groupe scolaire du Perron ayant été exproprié par le département des chemins de fer de l’État (ligne Kinkempois–Fexhe-le-Haut-Clocher), moyennant une indemnité de 294 400 francs. Ce qui fut fait dès 1914.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné par les Allemands et servira de bureau au IIIème Reich. Il ne subira aucune dégradation durant la guerre. Toutefois, l’école et la bibliothèque conserveront des salles.
Des années 1950 aux années 1970, il fut encore utilisé par l’administration communale et comme annexe d’école.
Dans les années 1970 et 1980, d’importantes rénovations ont lieu. Tout ce qui était précieux – escalier monumental, poutres, moulures, portes, volets, parquets de chêne, cheminées – ont disparu au profit d’une décoration « cité administrative » (lambris, néons et lino). Arrivée de la police dans une aile ainsi qu’un groupement associatif local. Le bâtiment nécessitant des travaux de restauration et une réactualisation par rapport aux nouvelles normes incendie, la ville de Liège, propriétaire depuis la fusion de communes, décida, sous la pression de son échevin des Finances, de désaffecter le château et de le démolir.
Au xxie siècle
En 1995, le Centre Antoine Vitez, avec l’accord de la ville de Liège, prenait ses quartiers au château de Sclessin, le sauvant alors d’une démolition certaine. Chaque année, ce sont 200 élèves qui viennent suivre les cours (théâtre, chant, danse, photo, etc.) que le Centre dispense.
En 2000, le Théâtre de l’Aléna prend place dans l’ancienne salle de bal du château de Sclessin. Il est reconnu Théâtre Professionnel par la fédération Wallonie-Bruxelles. Le Théâtre de l’Aléna a dirigé la création de plus de 70 spectacles.
Le pigeonnier, datant de 1646, devient un lieu où l’imaginaire du metteur en scène peut prendre sa place.
Une vente de briques du château est organisé par les ASBL afin de restaurer le château.


L’association a pour objet, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le développement culturel.


PRÉSENTATION
Bienvenue sur le site du Centre culturel de Hannut, lieu d’actions culturelles.
Le Centre Culturel de Hannut est une association sans but lucratif.
Il comprend donc une Assemblée générale, un Conseil d’Administration conformes à cette législation et un Conseil d’Orientation.
Le fonctionnement journalier du Centre culturel est confié à Alain Bronckart, animateur-directeur, entouré d’Adrienne Quairiat, Isabelle Simon, animatrices culturelles et Sylviane Van Eldom, secrétaire. Damien Dupont, ingénieur du son, intervient lors de certains concerts ou spectacles.
Le Centre culturel soutient les initiatives émergentes et les pratiques culturelles actuelles.
Il développe la majorité de ses actions sur le territoire hannutois. Ouvert sur sa ville et ses villages, le Centre culturel s’adresse à tous les habitants en favorisant les énergies locales et les initiatives interculturelles, artistiques et citoyennes.
Il accorde une grande importance à l’implication et à la participation de ses habitants dans son projet d’action culturelle.
Le Centre culturel assure un rôle dans l’accès aux productions et créations.
Le Centre culturel de Hannut c’est aussi …
Des projets citoyens, une programmation culturelle riche et variée, des moments de rencontres et d’échanges, une invitation à créer, imaginer, réaliser…


Le Centre culturel de Liège « Les Chiroux » est un centre culturel faisant partie du complexe des Chiroux situé dans le centre de Liège. Le Centre fait partie des centres culturels reconnus par la Communauté française de Belgique.
Étymologie
Le nom de Chiroux est d’origine wallonne. C’est une francisation de tchirou « bergeronnette grise »1 ou hirondelle des fenêtres »2. Son usage politique remonte au xviie siècle. Il désignait de jeunes volontaires issus de la bourgeoisie qui maintenaient l’ordre dans la ville de Liège. Leur habillement spécifique — habit noir et bas de chausse blancs — leur a valu ce sobriquet d’« petit oiseau noir au derrière blanc ».
Ils eurent de nombreux démêlés avec la faction populaire des Grignoux (changement de suffixe de grigneus « grincheux » en wallon, par imitation du suffixe de tchirou)3.
« Les Chiroux », comme « Les Grignoux », sont devenus des sites culturels de la vie liégeoise.
Historique
L’ASBL « Les Chiroux » est créée en 1976 et est reconnue comme Centre culturel agréé par la Communauté française en 19861.
Complexe
Le complexe des Chiroux, selon les plans des architectes Jean Poskin et Henri Bonhomme, est érigé entre 1967 et 1970 sur un terrain vague situé entre la rue André Dumont et la rue des Croisiers à la suite de la construction du pont Kennedy. Les autorités communales avaient accepté de céder et accepter le projet du promoteur à condition que l’ensemble immobilier comprenne des bureaux, une nouvelle bibliothèque et un centre culturel avec salles de spectacles et d’expositions.
Depuis 1970, le complexe des Chiroux accueille donc une grande bibliothèque dont les ouvrages proviennent du rassemblement de fonds divers en provenance de bibliothèques jadis dispersées dans la province de Liège ; il offre également un espace théâtral polyvalent pour une audience sélectionnée.
Sous un aspect urbanistique, le complexe des Chiroux est un socle adapté aux fluides des circulations urbaines qui est surmonté par une grande tour de logements (Tour Kennedy) et par un ensemble de bureaux.
Rue des Chiroux
La construction du pont Kennedy et du complexe a entrainé la disparition de la rue des Chiroux dans les années 1960–1970. Cette rue reliait la rue du Méry à la rue des Croisiers.

Le Centre culturel de Marchin, c’est une petite équipe attentive aux bruissements, aux tressaillements, au rythme des cœurs et des envies.
Présentation
À Marchin, le centre culturel existe depuis 1981, situé dans l’environnement champêtre de l’ancienne école du village. Le centre culturel de Marchin décline les missions décrétales en les colorant comme suit.
Articulant le soutien à la création artistique contemporaine et la complicité avec la dynamique citoyenne, les « petits feux » y brûlent tantôt dans les salles d’exposition, tantôt hors les murs (chez l’habitant, à l’Athénée, au Bistro des associations).
À l’occasion de la biennale de photographie en Condroz, les plasticiens travaillent le plus souvent au départ des réalités vécues par les Marchinois qui les accueillent.
La diversité des sensibilités culturelles est exprimée à travers des projets portés directement par la société civile : Marchin Blues Night, Afriquement dingue,…
Convaincu que l’expression de la jeunesse est à prendre en compte en urgence pour une transformation future de l’organisation de la vie sociale, le centre culturel de Marchin développe des pratiques d’animation visant à permettre aux jeunes d’occuper l’espace publique.
À travers les projets « Culture-enseignement » et « Infana Tempo », les pédagogues, les animateurs et les artistes font converger leur énergie pour la culture de l’imaginaire dès l’enfance.
La pratique artistique amateure rythme le quotidien : accordéon, conversation anglaise, percussion, gravure, chant du monde, danse, éveil musical permettent aux gens d’ici et d’ailleurs de trouver des espaces collectifs de création, de rencontre.
Le lieu
La place et son kiosque
Le Chapiteau-théâtre de la Famille Decrollier
Marc Decrollier et Bruno Renson se sont inspirés des structures auto-portantes du début du 20e siècle pour réaliser un chapiteau-théâtre contemporain et mobile. Un rapport direct entre le public et les artistes a été la ligne directrice de leur travail. Ils ont bâti un lieu avec ambiance intimiste et cossue.
Les salles d’exposition
Depuis 1995, date de son installation au site de Grand-Marchin, le centre culturel s’est engagé dans un travail de promotion de l’art d’aujourd’hui. Il dispose à cet effet d’un espace d’exposition de bonne dimension (deux classes d’une ancienne école), sobre, à très belle lumière, fort apprécié des artistes.
Le Bistro
Puces et brocantes sillonnées par des chineurs du coin, et voilà le Bistro : objets insolites, désuets, kitchs retrouvent une nouvelle vie pour cet espace d’accueil chatoyant de décontracté.
La cure
Ancien presbytère, la cure sera prochainement réaménagée et comptera une salle de réunion, une salle d’ateliers et un espace de résidence pour accueillir en hébergement des participants aux projets culturels et associatifs, des plasticiens, des musiciens, des écrivains,… en travail de création.
L’Aube
Petit kiosque de dialogue qui peut être monté n’importe où et n’importe quand, l’Aube va à la rencontre des gens en se déplaçant au gré des événements : cours de récré, places publiques… Conçue pour la récolte de « vos essentiels », la conversation s’échange entre un animateur du centre culturel et vous.
Chez l’habitant
Un habitant ouvre la porte de sa maison à la culture, aux autres. Il accueille pour une soirée un artiste qui s’adapte au lieu, à la proximité du public et le centre culturel qui débarque avec son bar. C’est une ambiance, une atmosphère à chaque fois particulière et une intimité qui fait que l’on vit au plus fort ce moment de poésie, d’échange.

Centre culturel local agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles, situé à Remicourt, en Hesbaye liégeoise, entre Liège et Waremme. « Il faut opposer à la démocratisation de la culture, la démocratie culturelle. Il s’agit non pas seulement d’avoir accès à un patrimoine tout fait ou en train de se faire par d’autres mais de participer à la création de ce patrimoine » Marcel Hicter

Histoire de la commune de Saint Georges sur Meuse
Paléolithique moyen (~ – 50.000)
Campement installé au lieu-dit « La Vallée » Saint-Georges.
Mésolithique (- 5.500 – 5.200)
Sites importants à Stockay et La Mallieue. ===Néolithique (- 4.000===) Gros villages omaliens vivant de l’agriculture à Dommartin.
Age du Bronze et du Fer (- 1.500 à – 50)
Habitations à Dommartin, Warfée et Saint-Georges.
Période Romaine (I au IVe siècle)
Nombreuses habitations, villas et tombes gallo-romaines à St.Georges, Stockay, Yernawe, Dommartin et Warfée.
Époque Mérovingienne (IV au VIIe siècle)
Habitations et tombes à St.Georges et Warfée. Au milieu du VIIe siècle, Sainte Ode, princesse mérovingienne érige le premier oratoire chrétien dédié à Saint-Georges – origine du nom du village actuel et de la future commune.
Moyen Age et Ancien Régime
À la fin du XIe siècle, l’alleu de Yernawe possède une superficie d’environ 100 bonniers. Il est une dépendance de l’église Saint-Lambert de Liège. Entre 1145 et 1248 l’Abbaye de Saint-Jacques construit à Yernawe une chapelle citée par le pape Innocent IV.
En 1651, les troupes lorraines pillent l’alleu de Yernawe. La restauration est faite par Gilles de Geer en 1663.
En 1691, le village Saint-Georges est dévasté à son tour. En 1693-1694 le duc de luxembourg ravage le village de Dommartin.
En 1703, une armée de Hollandais et d’Anglais commandée par le duc de Marlborough campe à nouveau à Saint-Georges. Les autrichiens puis les troupes françaises laissent également de bien mauvais souvenirs lors de leur passage en 1746, 1748, 1749 et 1792.
En 1797, les révolutionnaires confisquent les biens de l’Abbaye de Yernawe. Ils sont vendus en grande partie à Arnold de Lexhy.
Au cours des XVII et XVIIIe siècles, la commune de Saint-Georges a souffert du passage des différentes armées dans la région réquisitions, meurtres, incendies, vols et viols ont durement frappé les populations et plus spécialement les villages d’Yernawe et de Sur-les-Bois qui furent saccagés par les troupes lorraines en 1651.
La légende de Saint Georges
Un jour, Georges arriva dans une ville de la Libye nommée Silène(Silcha). Or, dans un étang voisin de la ville vivait un dragon redoutable qui, maintes fois, avait mis en déroute les armées envoyées contre lui. Parfois, il s’approchait des murs de la ville et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée.
Afin d’apaiser la fureur du monstre et l’empêcher d’anéantir la ville entière, les habitants convinrent de lui offrir chaque jour deux brebis. Bientôt, les brebis vinrent à manquer et les habitants durent se contraindre à les remplacer par des jeunes gens tirés au sort. Aucune famille ne fut exemptée du tirage et le jour de l’arrivée de saint Georges, le sort désigna pour victime, la fille unique du roi.
Historique du Centre culturel
En 1993, les autorités communales de la commune de Saint Georges sur Meuse décident de la création de l’asbl « Foyer culturel de Saint Georges-s/Meuse » qui est alors un centre culturel communal. Dès 1998, l’asbl sera reconnue par la Communauté française de Belgique et la Province de Liège comme centre culturel local de catégorie 4. En 2001, elle obtient la reconnaissance comme centre culturel local de catégorie 3. En 2003, le nom de l’asbl « Foyer Culturel de Saint Georgs-s/Meuse » est modifié en « Centre culturel de Saint Georges-s/Meuse » pour finalement obtenir en 2010 la reconnaissance comme centre culturel local de catégorie 2.
Présidents
- 1993-1994 Jules Servais
- 1994-2001 Robert Engelman
- 2001-2010 Jules Gonda
- 2010-2013 Robert Van de Winjgaert
Directrice/eurs
- 1994-2004 Kathy Masciarelli
- 2004-2010 Michel Schoonbroodt
- Depuis 2010 Thierry Guerin
Activités
Le Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse a développé depuis plusieurs années 3 festivals qui permettent de mettre en valeurs des artistes belges et étrangers et ce pour des publics variés :
- Guitar Event (festival de guitares en collaboration avec GHA Records et Homerecords. Les éditions précédentes ont accueillis Jacques Stotzem, Peter Finger, Odaïr Assad, Alki Guitare Trio, Roland Dyens, Résonances, Roberto Aussel, Thibault Cauvin, Roman, Karim Baggili, Michel Haumont, Les Doigts de l’Homme, Fabien Degryse, An evening about Neil, Fabian Brognia, Intermezzi…
- Dragon’s Rock Festival (il s’agit avant tout d’un festival rock tremplin à destination des groupés émergents)
- Lézard Rock Festival (festival de rock en chanson française pour enfants à partir de 6 ans… parents admis)
Le Centre culturel de Saint Georges sur Meuse a par ailleurs des activités de diffusion et d’éducation permanente :
- cinéma enfants
- chanson.s (chanson française)
- classique-opérettes
- conférence-exposition
- dimanche en famille
- musique du monde
- jazz
- noël au théâtre
- scolaire
- théâtre
Missions
Le secteur a été institué par arrêté royal en 1970 et les missions des Centres culturels telles que définies par décret du Gouvernement de la Communauté française en 1992 :
- création et créativité : offrir des possibilités de création, d’expression et de communication.
- éducation permanente : fournir des informations, formations, documentations qui concourent à une démarche d’éducation permanente.
- diffusion artistique et mise en valeur du patrimoine : organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone.
- soutien à la vie associative : organiser des services destinés aux personnes et aux associations qui favorisent la réalisation des objectifs du Centre.


LE CENTRE CULTUREL DE VERVIERS
Opérationnel depuis septembre 2004, l’ « Espace Duesberg » dont le Centre culturel de Verviers assure la gestion peut recevoir 264 spectateurs. Cet espace dispose également d’un foyer et d’une petite salle annexe de 60 places pour réunions, répétitions, petits spectacles et ateliers créatifs.
Dans le respect des objectifs fondamentaux comme la démocratisation culturelle ou citoyenneté active, le Centre culturel de Verviers se prête particulièrement bien aux initiatives associatives, de par son architecture, sa convivialité et son équipement.
Initialement orienté vers les arts de la scène, le Centre culturel a également vu se développer avec bonheur d’autres facettes de l’activité culturelle, avec notamment une dynamique très importante au niveau des arts plastiques et du septième art.

Présentation
L’ASBL Centre culturel de Wanze est un des 118 Centres culturels agréé par la Communauté française de Belgique. Reconnu depuis 1988, le Centre culturel de Wanze répond ainsi depuis près de 30 ans aux missions déterminées par le décret fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des Centres culturels en Communauté française.
Quatre principes de base sont à respecter dans le cadre de cette reconnaissance et déterminent le fonctionnement de l’association sans but lucratif Centre culturel de Wanze :
- La parité puisque l’association doit être composée paritairement d’associations de droit privé et de droit public;
- Le pluralisme grâce au respect du Pacte culturel garantissant le respect de toutes les tendances idéologiques et philosophiques;
- La participation des gens au projet de l’association, via, notamment, le Conseil culturel;
- La polyvalence.
Le Centre culturel de Wanze doit assurer le développement socio-culturel du territoire communal. Les activités doivent, notamment, tendre à :
- offrir des possibilités de création, d’expression et de communication;
- fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche d’éducation permanente;
- organiser des manifestations mettant en valeur les oeuvres du patrimoine culturel local, régional, communautaire, européen, international et francophone;
- organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la réalisation des objectifs du centre.
Depuis quelques années, avec la rénovation de la salle polyvalente (rebaptisée Jacques Brel) et de la salle Jean-Pierre Catoul, le Centre culturel de Wanze dispose d’une infrastructure qui a permis, ces dernières années, d’étoffer l’offre culturelle wanzoise. Un plus pour les amateurs de théâtre et de concerts de tous âges, puisque le Centre culturel s’attache à satisfaire aussi bien les aînés que le jeune public. Outre le soutien à la vie associative de la localité, les animateurs du Centre culturel oeuvrent au développement du Théâtre à l’Ecole et à celui des ateliers créatifs, sans oublier l’ouverture sur l’art contemporain, l’aide à la création et la formation.
Les évènements
- Spectacles Jeune public
- Concerts chanson française, rock, pop, jazz
- Théâtre
- Rencontres-débats en partenariat avec diverses associations locales
- Expositions : Biennale d’art contemporain, Parcours d’artistes et d’artisans, l’art est dans la place …
- Mais aussi : des petits déjeuners philo, des tables de conversation, des ateliers d’écriture, CordialCité, un jardin collectif, un Repair Café, des tables de conversation …
Les ateliers du CEC Le Grain d’art
Un Centre d’Expression et de Créativité est un lieu où se croisent des enjeux sociaux, culturels et artistiques. Le principe est d’offrir à des publics très diversifiés (âge, origine, contexte social…), un cadre où s’exprimer, se révéler à soi-même en se confrontant aux processus de création. Aucun bagage artistique préalable n’est requis puisque le but est de procurer des moyens d’expression nouveaux en priorité aux personnes qui n’y ont pas accès. Cela implique des apprentissages techniques mais aussi une sensibilisation à l’art d’aujourd’hui, un éveil des sens, l’élaboration de points de vue individuels et collectifs. Le souci est d’inciter les participants, par leurs réalisations, à produire du sens, à construire un propos, à renouveler le regard porté sur les choses et sur le monde.
Le Grain d’art propose :
- des ateliers hebdomadaires
- des stages pendant les vacances scolaires
- des évènements
- une Fête des Ateliers
pour les enfants, les ados, les adultes.



Rejoignez la page du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont afin d’être informé de nos manifestations.

Lieu exceptionnel d’exposition, mais aussi un lieu de rencontre, d’expressions artistiques : musique, danse, lecture, débats, etc…Un lieu de convivialité et d’échanges.


Depuis 1988, nous proposons aux jeunes et moins jeunes des cours d’instrument individuels ou collectifs dans diverses disciplines telles que guitare, batterie, basse, chant, clavier,violon, des stages et des concerts d’élèves.

Formathé vous propose des formations gratuites de qualité !
🖥️ Informatique
🎯Coaching emploi
🪧Orientation professionnelle
✏️ FLE / Citoyenneté
Nous avons forcément ce qu’il vous faut, alors contactez-nous pour booster votre carrière ! 🚀
LE CENTRE FORMATHÉ À SERAING
Créé en 2001 et agréé par la Région wallonne en tant que Centre d’insertion SocioProfessionnelle (CISP), et également Agence d’outplacement, le Centre de formation Formathé à Seraing vous propose des formations de qualité.

Le Centre Franco Basaglia est un dispositif d’analyses et de propositions qui interrogent les liens entre la psychiatrie, l’homme et la société.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le service d’Éducation Permanente.


Le Centre Multimédia offre à tous plusieurs services : Bibliothèque publique, Espace Public Numérique, Ludothèque – CEC, animations, cours de français et de citoyenneté …

Centre nature de Botrange
La Maison du Parc – Botrange (en allemand : Naturparkzentrum Botrange) est un centre d’accueil, un musée (exposition permanente Fania) et le siège du Parc naturel Hautes-Fagnes – Eifel. Il se situe au sud du signal de Botrange dans la commune de Waimes en province de Liège (Belgique).
Historique, situation et description
Autrefois appelée « Centre nature », la Maison du parc – Botrange a été construite en 1984 sur le plateau des Hautes Fagnes à environ 1 km au sud du signal de Botrange, le point culminant de Belgique (altitude 694 m) et à quelques dizaines de mètres à l’ouest de la route nationale 676 Mont Rigi–Sourbrodt. La maison du Parc se trouve à l’altitude 655 m. Cet imposant bâtiment se compose de deux pavillons principaux bâtis en moellons de grès et recouverts d’une toiture en ardoises.
La partie allemande, le parc naturel Nordeifel, est gérée par une équipe allemande basée à Nettersheim.
Fonctions
Le Centre nature de Botrange qui est la maison du parc naturel Hautes-Fagnes – Eifel promeut un tourisme doux, conciliant la protection du milieu (déboisement de résineux, nettoyage de berges1) et l’aménagement d’une infrastructure adaptée au tourisme :
- L’exposition Fania montre d’une manière originale, informative, interactive, ludique et esthétique les différents visages du plateau des Hautes Fagnes par des panneaux explicatifs et des photographies ; elle comprend aussi un tunnel sensoriel faisant appel à tous les sens du visiteur.
- Le centre est le départ de nombreuses randonnées à ski ou à pied comme le parcours didactique vers la Fagne de Neûr Lowé.
- Des promenades guidées avec guide agréé permettent aux randonneurs de pénétrer en zone C des Hautes Fagnes.
- Des locations de skis et de vélos électriques sont possibles suivant la saison.
- Une randonnée de 18 km est possible en char à bancs tiré par un tracteur de la fin mars au début novembre.
- Des activités éco-pédagogiques sont organisées pour des groupes scolaires.
- Le bâtiment dispose de plusieurs salles pouvant servir à plusieurs usages.
- Un grand parking, une plaine de jeux, une boutique verte et une cafétéria accueillent les visiteurs.

Verlaine-Sports a été créé en 2015 pour répondre à l’évolution du sport sur le territoire de la commune de Verlaine. Cette structure est un soutien pour tous les clubs de l’entité.
Afin d’accentuer la dynamique sportive déjà bien présente sur la commune, la cellule « Verlaine Sports » du Comité culturel et sportif ASBL a mis en place un système de subvention pour l’organisation d’activités sportives ponctuelles.

🐑 • Parcours permanent Laine & Mode • Expositions temporaires • Patrimoine verviétois • 🧶

Heures d’ouverture:
Durant les expositions, le Centre est accessible de 14h à 18h, sauf le mardi de 14h à 17h.
Il est fermé le lundi, jeudi et jours fériés.
Contact:
Marie-Hélène JOIRET
0476/324 614

Cercle ouvert – Centre d’Instruction sur la Culture et l’Histoire de l’Afrique subsaharienne et des Antilles.

Le Cercle Royal Saint-Jean Baptiste est la salle des fêtes du village de Mont-Dison.

Salle pour réunions, repas, fêtes de famille
Stages et animations pour enfants
Je Cours Pour Ma Forme


Dans l’axe dynamique de Liège, se trouve votre plaine de jeux où les plus petits Chevaliers et Princesses sont particulièrement gâtés par un vaste espace de psychomotricité. Mais les plus grands sont mis aux défis par les Chevaliers animateurs : courses, épreuves de force et de courage…tout y est pour devenir un valeureux Chevalier !

Château de Harzé
Le château de Harzé est un château de style Renaissance mosane situé à Harzé dans la commune d’Aywaille en Belgique.
Histoire
Si les origines d’un château remontent probablement au ixe ou xe siècle, l’édifice actuel est l’œuvre du comte Ernest de Suys de Lynden qui fit aménager, dans les années 1632 à 1645, l’ancien fenil transformé en une vaste salle des comtes. Ses armoiries ainsi que celles de son épouse surmontent le porche d’entrée donnant accès à la grande cour du château. Elles sont datées de 16471.
La façade du château, restaurée entre 1909 et 1924 sous la direction de l’architecte Camille Bourgault2, constitue un exemple remarquable du style Renaissance mosane, avec ses arcades en plein cintre sur colonnes toscanes et ses fenêtres à triples meneaux.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille des Ardennes, le château fut réquisitionné par l’armée américaine qui y installa un état major dirigé par le général Matthew Ridgway. Ce dernier y reçut le Field Marshall Bernard Montgomery le 24 décembre 1944 et le général Dwight Eisenhower le 28 décembre 1944. Une plaque commémorative placée dans le porche d’entrée relate ces événements.
Activités actuelles
Propriété de la province de Liège depuis 1973, le château est devenu un centre de séminaires résidentiels, de réception de mariage et d’hébergement pour groupes et individuels ainsi qu’une auberge. Ses anciennes dépendances abritent le musée de la Meunerie et de la Boulangerie.
Le dernier week-end d’août, le site du château accueille la fête du fromage dont la 39e édition a eu lieu en 2018

Le château de Jehay, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un site emblématique et l’un des hauts lieux touristiques de la Province de Liège. Il se situe sur le territoire de la commune d’Amay.
Le château de Jehay, dans son état actuel, date, pour sa partie la plus ancienne, du milieu du xvie siècle. Il a été modifié au fil du temps et des différentes familles qui en furent propriétaires. Aujourd’hui, il appartient à la Province de Liège. Le bâtiment bénéficie d’une vaste campagne de restauration qui s’étend sur plusieurs années. Sa célèbre architecture dite « en damier » n’est actuellement pas visible et son intérieur n’est pas accessible.
Cependant, le domaine reste ouvert et de nombreuses animations y sont organisées
Histoire
L’origine de la seigneurie de Jehay semble remonter au xiie siècle, mais c’est à partir du xve siècle que la destinée de ce territoire est la mieux connue. Bien que certains documents antérieurs au xvie siècle signalent la présence d’une forteresse implantée dans la seigneurie de Jehay, son emplacement exact n’a pu jusqu’à présent être déterminé avec certitude2.
Confisquée à Wathieu Datin en 14333, la terre de Jehay passe entre les mains des familles Goessuin de Beyne4, de Thuin5 et de Sart6 par successions.
En 1537, Jehan Helman de Sart, époux de Marguerite de la Falloise, hérite du domaine et entreprend assez rapidement la reconstruction d’un nouveau château. Mais c’est surtout le mariage de sa fille, Jeanne, avec Arnould de Merode qui stabilisera la seigneurie dans cette dernière famille durant près de deux siècles.
En 1720, la seigneurie est achetée par Lambert van den Steen7, seigneur de Saive en Hesbaye et conseiller du Prince-évêque. La famille van den Steen restera propriétaire du domaine durant 280 ans.
Le dernier propriétaire privé des lieux, le comte Guy van den Steen de Jehay, vend en 1978, en viager, le château, le domaine et une partie de la collection d’œuvres d’art à la Province de Liège.
xvie siècle – Famille de Sart
Ide de Thuin épouse en secondes noces Helman de Sart. Celui-ci relève la seigneurie de Jehay en 1498, et une deuxième fois le 19 septembre 15068. Ide de Thuin meurt le 17 septembre 1512, sans avoir eu d’enfants. Helman de Sart se remarie alors avec Jenne d’Alsterenne de Hamale. De cette union naquirent Guillaume, Jean Helman et Jenne Helman de Sart9.
Jean Helman de Sart hérite finalement de la seigneurie de Jehay. Il en fait le relief le 17 mars 1537 et le 13 octobre 15389. C’est à Jean Helman de Sart et son épouse Marguerite del Falloise que nous devons la construction du château, vers 1550.
xvie et xviie siècles – Famille de Merode
Jeanne de Sart (fille de Jean Helman de Sart et de Marguerite del Falloise) épouse Arnould de Merode. Le domaine de Jehay restera dans cette famille jusqu’en 1720.
La maison princière de Merode est une ancienne famille faisant partie de la haute noblesse belge10.
xviiie, xixe et xxe siècles – Famille van den Steen
En décembre 1720, Joachim Joseph de Merode11 décide de vendre le domaine, les titres, prérogatives, cens et rentes de Jehay à Lambert van den Steen, seigneur de Saive, échevin de Liège et conseiller du prince-évêque, Joseph Clément de Bavière. Cette acquisition ouvre à nouveau les portes à plus de deux siècles et demi de possession ininterrompue du domaine par une seule et même famille. Très active dans l’entourage des derniers princes-évêques de Liège, elle prendra également une place de choix dans l’aristocratie de la toute jeune Belgique12. De la charge d’échevin de Liège tenu par Pierre Lambert et Lambert au xviiie siècle, à celle de Gouverneur de la Province de Liège tenue par Charles Amand, premier comte van den Steen de Jehay à titre posthume, en passant par les missions d’envoyé extraordinaire auprès du Saint-Siège ou d’ambassadeur de Belgique, la famille a traversé toutes les époques en conservant une influence considérable.
Au début du xxe siècle, le château est loué à la famille de Liedekerke – dont Pierre de Liedekerke de Pailhe fut bourgmestre de Jehay-Bodegnée de 1903 à 1926 et représentant politique de la région jusqu’en 1936.
Durant la Seconde Guerre mondiale, de 1942 à 1950, la société nationale des chemins de fer belges occupe le domaine et transforme le château en home pour les enfants de cheminots flamands.
Le comte Guy van den Steen de Jehay hérite du domaine et décide de s’y installer, en 1950, avec son épouse née Lady Moyra Butler13. Le comte prend la décision de vendre le château, le domaine et une partie de la collection d’œuvres d’art, en 1978, à la Province de liège.
La Province de Liège est pleinement propriétaire des lieux depuis le 1er janvier 2000.
Description
Le château
Si l’histoire du château et du domaine de Jehay est, grâce aux sources historiques et archéologiques, relativement claire entre la première moitié du xvie siècle et le XXe siècle, il n’en est malheureusement pas de même pour les périodes antérieures. Si quelques auteurs légendaires, quelques textes, chartes ou échanges font mention des seigneurs et « de la forteresse » de Jehay, il est très compliqué d’en retracer une évolution correcte et complète par manque de preuves aujourd’hui connues. À ce jour, cette première forteresse n’a pas été identifiée ni localisée. Tout au plus, la toponymie actuelle et ancienne peut nous indiquer qu’il devait exister une « motte » plusieurs fois mentionnée dans les documents anciens14.
Le bâtiment originel semble avoir été construit au milieu du xvie siècle et il est en tout cas clairement décrit comme un « beau neuff chasteau » [sic] dans un document d’archive daté de 158015. Le château est alors composé d’un corps de logis accompagné de deux tours circulaires. C’est déjà à cette époque qu’est mise en œuvre la stylistique générale du bâtiment qui dominera les siècles à venir. Le mode constructif donnant au château de Jehay son esthétique si particulière se développe sur les façades extérieures, vers les douves. Composé d’un damier alternant des pierres brunes (les grès) et des pierres blanches (les calcaires), il possède plusieurs éléments caractéristiques hérités de la période médiévale. Le second style du château se présente, quant à lui, uniquement sur la façade intérieure. Caractéristique de l’ouverture au monde développée à la Renaissance, celle-ci est exclusivement réalisée en pierres calcaires de grandes dimensions, bien équarries et disposées en lignes horizontales. Cette façade, contemporaine du « damier », est dotée de grandes ouvertures et s’ouvre complètement vers l’extérieur en permettant un apport maximum de lumière dans le bâtiment16.
Rapidement, de nombreux ajouts sont faits à ce château originel qui voit sa superficie s’agrandir considérablement, atteignant son apogée dans la seconde moitié du xviiie siècle.
À la suite de grands travaux réalisés sous la direction d’Alphonse Balat, architecte au service du roi Léopold II, le château prend sa forme actuelle. Le XIXe siècle est ainsi marqué par la destruction de nombreuses annexes ainsi que par la création de la cage d’escalier d’honneur et de la galerie d’entrée.
Malgré l’évolution des goûts et des styles, il conservera cet aspect original qui en fait aujourd’hui un des plus beaux châteaux de Wallonie.
Les dépendances
Le bâtiment des dépendances tel que nous pouvons l’admirer aujourd’hui doit sa forme aux grands travaux effectués au XIXe siècle. C’est en effet sous l’impulsion d’Amand François Charles van den Steen de Jehay17 que leur aspect, vers la cour, est totalement modifié.
Stylistiquement, elle fait la part belle à la brique, utilisée comme matériau majoritaire agrémenté de chaînages et encadrement de calcaire18.
Autrefois utilisées comme étables, écuries, grange, etc., les dépendances abritent aujourd’hui la boutique/billetterie, les zones d’expositions ainsi que les bureaux du personnel.
Le bâtiment des dépendances a été restauré par la Province de Liège en 2006.
Le porche
Aujourd’hui détachée des autres bâtiments composant les dépendances, la tour-porche a conservé, en partie, son état du XVIIe siècle.
Elle est marquée par une toiture en bulbe surmontée d’un soleil dardant ses rayons et d’une girouette prévenant de l’arrivée du vent par la mention « Le voilà ». Elle montre encore, sur sa façade extérieure, les vestiges des glissières servant à manipuler le pont-levis19.
Les jardins et le potager
Le domaine s’étend sur 22 hectares, dont 7 environ sont actuellement accessibles aux visiteurs, répartis entre les jardins d’agrément, le jardin potager, les zones boisées et les prairies.
Les plus anciennes illustrations connues de ce parc sont des œuvres du XVIIIe siècle réalisées par Remacle Leloup, un artiste liégeois célèbre pour ses dessins et gravures de monuments et sites de la région liégeoise. De cette époque subsistent quelques charmilles et drèves de châtaigniers. Les jardins furent entièrement redessinés par le dernier résident du château, le comte Guy van den Steen de Jehay, au milieu du XXe siècle20.
Le jardin potager, dont l’emplacement actuel remonte au XIXe siècle, s’étend sur une superficie d’un hectare. Son enceinte a pour but de protéger les cultures des nuisibles, des pillards et du vent. Les murs réfléchissent les rayons du soleil et permettent ainsi de conserver une température plus clémente qu’alentour21. Le jardin potager a été réhabilité il y a quelques années par la Province de liège. On y trouve un verger de variétés anciennes, des petits fruits, des plantes médicinales, de nombreux légumes et fleurs comestibles. La production est utilisée principalement par la Conserverie Solidaire de la Province de Liège [archive] à des fins de formation ou d’animation.
La collection d’œuvres d’art
La glacière

Château de Modave
Le château de Modave appelé aussi château des Comtes de Marchin est un château de la commune belge de Modave situé au sud de Huy et de la vallée de la Meuse en province de Liège.
Histoire
C’est en surplomb du Hoyoux, un affluent de la Meuse, que s’élève le château de Modave, un des rares exemples dans la région liégeoise d’un style qui évoque parfaitement l’architecture française du xviie siècle.
La famille de Modave, originaire de la terre dont elle porte le nom, a possédé la terre et la forteresse du xiiie siècle au milieu du xvie siècle. Par héritage, la seigneurie passa dans les mains de la famille de Saint-Fontaine qui, le 20 janvier 1642, la vendit au comte Jean de Marchin pour son fils Jean-Gaspard.
À l’époque, le château, dont la première construction remonte au xiiie siècle, avait déjà perdu un peu l’aspect féodal que lui donnait un vaste donjon protégé par des fossés, des murs d’enceinte et des tours. À partir de 1655 mais surtout de 1657, Jean-Gaspard le restaura et entreprit une reconstruction qui s’inspirait de la grande architecture française du début du règne de Louis XIV.
Plus tard, le château devint propriété du prince-évêque Maximilien-Henri de Bavière, qui le céda au cardinal Guillaume-Egon de Furstenberg.
Ensuite Arnold de Ville en prit possession. Par sa fille le château fut transmis à Anne Léon Ier de Montmorency-Fosseux, chef de nom et d’armes de l’illustre famille française des Montmorency.
Après la noblesse d’épée et de goupillon, ce sont les capitaines d’industrie liégeois (les Lamarche et les Braconier) qui ont occupé Modave. Aujourd’hui, le château appartient à la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) qui exploite en sous-sol des captages d’eau mais valorise parfaitement ce patrimoine exceptionnel et en permet l’accès au public.
Description
Lorsqu’on arrive à Modave, on se trouve devant une muraille qui évoque bien l’enceinte d’une ancienne place forte. Mais des fenêtres ont été percées, les deux ponts-levis et le donjon ont disparu. Au-dessus du portail, on peut voir, entourant le barbeau que l’on retrouve sur toutes les armes des de Marchin, la devise bien britannique « Honni soit qui mal y pense » : Jean-Gaspard Ferdinand de Marchin avait été fait chevalier de l’Ordre de la Jarretière par le roi Charles II.
Une fois franchi le portail, on découvre un superbe château du xviie siècle précédé d’une cour d’honneur avec bassin et jets d’eau. Par un petit pont qui enjambe les fossés, on entre dans une demeure toujours parfaitement décorée et bien meublée. La grande salle des gardes est stupéfiante. Au plafond, tout l’arbre généalogique du comte Jean-Gaspard de Marchin est établi en relief sur cinq générations. Le comte et trois autres chevaliers sont représentés à cheval, avec armure, bouclier, armes, heaume et panache grandeur quasi nature, en ronde-bosse, vus de profil. La visite est passionnante. On découvre les traces du grand siècle, qui fut celui du comte Jean-Gaspard de Marchin et celles de la Révolution industrielle des xviiie et xixe siècles. On passe du salon d’Hercule dans la grande salle à manger avec le magnifique service en porcelaine de Gien qui compte plus de 1 130 pièces, le salon des gobelins, le fumoir qui témoigne du mode de vie des grands bourgeois liégeois, les chambres dont celle du baron de Montmorency qui, faisant fi de toute modestie, avait voulu lui donner une allure royale avec le lit dans une alcôve surélevée et séparée du reste de la chambre par une balustrade. Et puis la petite salle de bain dont la baignoire baptisée « le trou » a été percée à même le rocher sur lequel le château est bâti. Dans la chapelle reconstruite après la Révolution, on célèbre aujourd’hui, assez régulièrement, le mariage de couples d’étrangers (en particulier des Japonais) qui veulent s’offrir des souvenirs à la manière occidentale. Et dans les sous-sols, des caves à vin ont été aménagées dans les anciens cachots.
Machine de Modave
Une première machine destinée à remonter l’eau du Hoyoux pour les besoins du château et les fontaines du jardin fut construite vers 1668 lors de la restauration du château par Jean Gaspard de Marchin après l’incendie de 1651. Elle est attribuée au charpentier liégeois Rennequin Sualem et a inspiré la Machine de Marly à Versailles. Elle élevait les eaux du Hoyoux sur une cinquantaine de mètres, ce qui était une performance à l’époque. Elle comprenait une seule roue, deux manivelles et deux fois quatre pompes. L’unique conduite étant vraisemblablement en bois, elle avait déjà disparu lorsqu’elle fut reconstruite entre 1706 et 1720 par le baron Arnold de Ville. Il existe encore aujourd’hui une machine datant du xixe siècle, dont le piston est mu par un roue à aubes de près de 6 mètres de diamètre et 1,80 mètre de large. Cette installation fonctionnait encore en 1935 et propulsait 2 litres d’eau par seconde 70 mètres plus haut en consommant plus de 6 mètres cubes par seconde pour faire tourner le moulin. On y installa également une petite centrale électrique. Actuellement, ce sont des pompes électriques qui amènent l’eau du Hoyoux pour les besoins du château (potager, etc.)1,2.
Bibliographie
- Anne Royen et Francis Tourneur, « Travaux au château de Modave par le cardinal de Fürstenberg et par le duc de Montmorency », Bulletin de l’institut archéologique liégeois, Liège, t. CXXII, 2018, p. 115-171

Château de Waroux
Le château de Waroux est un château situé rue de Waroux à Alleur (commune d’Ans, dans la province de Liège, Belgique).
Histoire
Le nom de Waroux évoque la terrible guerre des Awans et des Waroux qui divisa la noblesse hesbignone de 1298 à 1335.
L’édifice actuel est d’origine médiévale comme en attestent le donjon à base carrée et la muraille circulaire de silex. L’entrée est à l’opposé du donjon et la cour intérieure de forme polygonale marie la brique et la pierre de taille. Waroux est un des rares châteaux belges de forme circulaire.
La terre de Waroux, seigneurie dépendante du comté de Looz au xiiie siècle, appartint à la famille de Waroux avant de passer par mariage en 1525 à Richard de Merode (+ 1539) qui épousa Agnès de Warfusée, dame de Waroux. Leur fils Guillaume, puis son fils Jean — devenu comte de Waroux en 1623 —, et un autre Jean (fils du premier) se succédèrent. Le dernier Jean étant décédé sans descendance, la propriété passa à Itel ou Eitel-Frédéric de Merode — comte de Merode de Waroux, vicomte de Villers-sur-Lesse & Icherenne, etc. — puis à son fils Alexandre qui n’eut que trois filles. D’après des briques datées de 1696 et décorées des armoiries Clercx, on suppose que les trois sœurs Merode vendirent Waroux à Michel Clercx durant la dernière décennie du xviie siècle.
La famille de Clercx de Waroux, qui occupa le château jusqu’en 1925 vendit le bien à Francis Everard de Harzir qui décéda en 1940 ; les héritiers de la veuve de Francis Everard de Harzir (Adèle de Harenne décédée en 1982) se défirent du château qui fut acquis en 1986 par le docteur Léon Janssis. Ce dernier le revendit en janvier 2005 à la commune d’Ans. Parmi les enfants du couple citons Alain Everard de Harzir, Lieutenant au 1er Régiment de Guides mort durant les combats de Passendale le 27 mai 1940 et Philippe Everard de Harzir, officier de l’Armée Secrète et abattu par l’occupant à Alleur le 4 septembre 1944.
Le château est actuellement occupé par des bureaux et des salles de réunions; on y organise aussi des événements culturels : exposition d’artistes (exposition Folon en avril et mai 2006, exposition Félicien Rops en 2008) ou sur des faits de société exposition sur la franc-maçonnerie en 2008). En avril, mai et juin 2007, une exposition a rendu hommage au sculpteur Auguste Rodin dont on célébrait le 90e anniversaire de la mort : sculptures, bronzes, moulages et dessins originaux de l’artiste émaillaient la visite. En l’an 2009, à l’automne, une exposition y fut consacrée au peintre
Les 8 et 9 septembre 2007, à l’occasion des journées du Patrimoine militaire, le parc du château a accueilli un bivouac napoléonien : de l’infanterie, de l’artillerie et de la cavalerie ont permis au public de remonter 200 ans en arrière lorsque nos contrées vivaient sous le régime français.
Le château et sa ferme attenante ont été classés le 25 octobre 1977.



Musée Vivant d’Archéologie Industrielle Minier et Carrier.
Le Chemin de Fer de Sprimont est établi sur une partie de l’assiette de l’ancienne ligne vicinale Poulseur – Sprimont – Trooz. Véritable musée d’archéologie industrielle ferroviaire à voie de 600 mm, le CFS a rassemblé, depuis 1981, toute une collection de matériel ancien dont une vingtaine de locomotives et environ 70 wagonnets. Un autobus parisien à plateforme datant des années 30 effectue les navettes entre le site du CFS et le Centre d’Interprétation de la Pierre qui est installé dans les bâtiments de l’ancienne centrale électrique de la carrière de Sprimont. Datant de 1976, le bus vicinal permet d’organiser des circuits découverte vers divers sites muséaux de la région. Différentes formules d’excursions invitent à la découverte des musées traitant d’autres moyens de transport dans la région ainsi que des musées communaux. Labelisation : Wallonie Destination Qualité Bus 62, 65, 727 arrêt Fond Leval Les chiens sont admis en laisse et les poussettes sont acceptées.

2 salles tout confort rénovées en 2019, projection et son numérique, prix démocratiques de 7€

Le CNCD-11.11.11. est une coupole d’ONG et un mouvement citoyen pour un monde juste et durable.

L’association a pour but de favoriser les échanges intergénérationnels, le soutien à l’enfance maltraitée mais aussi de favoriser l’intégration sociale des personnes à particularités (handicapées).

Dynamique et vivante, la Collection Uhoda évolue au gré des rencontres et des nouvelles acquisitions.

Le « Comité Culturel et Sportif de Verlaine » a pour mission d’apporter aide et soutien aux différentes associations villageoises. Il se veut le coordinateur des manifestations verlainoises.

L’asbl organise ou accueille des événements culturels dans l’église St Remacle à Verviers

Notre association a pour but de défendre les intérêts des habitants du quartier, servir d’intermédiaire avec les autorités, informer les riverains des projets qui les concernent, contribuer à l’animation du quartier, créer des liens entre les habitants.

Page officielle de l’Administration communale de Fléron. Vous trouverez ici les dernières actualités et activités de la commune.

Le Conservatoire royal de Liège est une école supérieure des arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles


Toute l’actu de nos activités mise à jour quotidiennement! Pour plus d’infos: n’hésitez pas à consulter notre site http://www.cpcr.be

Crafty est un espace créatif convivial qui met l’artisanat à l’honneur. Crafty propose des ateliers, des expositions, une boutique d’art handmade et un atelier de céramique. Créer et Partager avec amour, telle est notre philosophie!

Le Créahm de Liège est une association qui œuvre depuis 40 ans à développer les talents artistiques d
Centre Régional d’Intégration pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère de Liège (numéro d’entreprise : 0465562188)

Organisation de diverses manifestations (expositions, concerts, spectacles et manifestations culture


D’une Certaine Gaieté (D1CG) est un foyer contre-culturel itinérant qui a comme ambition de dénicher ce qui grouille en-dessous des radars, ce qui vit dans les arges et fomente du dissensus.

D’une Certaine Gaieté (D1CG) est un foyer contre-culturel itinérant qui a comme ambition de dénicher ce qui grouille en-dessous des radars, ce qui vit dans les marges et fomente du dissensus.
Dance4You school propose des cours de salsa cubaine, bachata, kizomba, west coast swing et Boogie


Un nouveau lieu d’hospitalité, de rencontres, de cultures, initié par Revers asbl et les Expériences du Cheval Bleu au cœur du quartier Saint-Léonard, au 73 de la rue Maghin.

Deux Ours héberge une asbl
La salle et le Pub : 2 Place Georges Hubin – 4577 Vierset-Barse

PARC, PISCINE et BBQ accessible uniquement sur réservation (règles COVID) via le site https://www.provincedeliege.be/wegimont/ .

Manifestations sportives et culturelles à Seraing

Projet
Ce centre comporte trois parties distinctes : une exposition permanente, un lieu destiné à accueillir des activités didactiques et/ou artisanales pour tous les publics et prochainement, un espace dédié à des expositions temporaires. -L’exposition permanente est disposée sous forme d’un parcours chronologique. Elle présente l’évolution de l’homme dans son milieu, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, en prenant comme exemple illustratif la terre de Beaufort. Pour chaque époque, les mêmes grands thèmes sont abordés (ressources, habitat, techniques, organisation sociale,…) et illustrés de pièces archéologiques et de reconstitutions.
L’espace extérieur a été mis à profit pour créer un jardin historique. Y sont cultivées des plantes illustrant les espèces présentes à chaque époque dans nos régions, les conséquences de la sélection de celles-ci par l’homme et l’arrivée de plantes exotiques à divers moments de notre histoire. De l’espace d’accueil partent des activités praticables en extérieur comme des balades en milieu naturel et des visites guidées à thèmes mais ce lieu accueille également des animations et ateliers pédagogiques divers (stages, cours, conférences,…). Durant les horaires d’ouverture du musée, cet espace accueille également une cafétéria.
Dans l’espace dédié aux événements temporaires, groupes scolaires et visiteurs individuels pourront découvrir les thèmes proposés par des expositions ponctuelles.
Compte tenu des enjeux environnementaux actuels, les travaux d’aménagement des bâtiments ont été réalisés – dans la mesure où cela était possible – en écoconstruction. Les lieux sont gérés au quotidien dans une optique de développement durable (matériaux recyclés, sensibilisation au tri des déchets, produits du commerce équitable pour la cafétéria, etc.).
Informations pratiques
- L’entrée de l’Ecomusée ainsi que la plupart des activités programmées sont gratuites.
- Des boissons chaudes et froides sont en vente sur place et une salle intérieure (30 places) peut vous accueillir pour vos pique-niques. En saison, il est également possible de s’installer dans le jardin.
- Nous ne disposons pas de lecteur Bancontact, les activités payantes seront donc réglées à l’avance par virement (nous contacter) ou en liquide sur place le jour même.
Horaires
D’avril à octobre : tous les dimanches de 14.00 à 18.00 En juillet et en août : du mardi au dimanche de 14.00 à 18.00 Toute l’année (même pour les individuels) sur simple demande au 085/21.13.78
Contact
Coordinatrice : Virginie Karikese Hougardy
avenue de Beaufort, 65 4500 Huy (Ben-Ahin) +32-(0)85-21.13.78
adresse courriel :info.ecomusee@Skynet.be



Un Espace Public Numérique (EPN) est une structure de proximité ouverte à tous équipée de matériel informatique et connectée à Internet.

Bienvenue à Esneux, une commune à découvrir et ressentir, nichée dans la vallée de l’Ourthe.

Espace 251 Nord est un centre d’art contemporain se situant à Liège, dans le quartier Saint Léonard, et créé en 1983.
L’association a pour but de promouvoir les artistes
En savoir plus :
e2n.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_251_Nord
L’Arvô – Art et Histoire
Ancienne justice de paix et bâtiment classé, l’Arvo est le centre névralgique de nos activités touristiques et culturelles à Limbourg.
Vous y trouverez toutes les informations touristiques souhaitées, vous pourrez y acquérir la documentation recherchée. C’est également dans ce superbe bâtiment, que nous accueillons, tout au long de l’année, différentes expositions artistiques. Cet espace est aussi un lieu de rencontre ouvert aux jeunes talents qui souhaitent se lancer dans l’aventure d’une première exposition.
Dans l’ancien hôtel de ville construit en 1681, vous trouverez :
• au rez-de-chaussée, une salle historique avec une grande maquette de Limbourg en 1632. Vous pourrez également voir une documentation sur l’histoire du Duché, sur les « wasserburg » (châteaux fortifiés de la région) et quelques pièces de musée.
• au premier étage, un espace galerie qui vous permettra de découvrir des expositions d’art plastique durant tout l’été.
L’Espace Arvô est ouvert de mai à octobre, du mercredi au dimanche inclus ainsi que les jours fériés de 14h00 à 18h00.
L’entrée est gratuite

Flux News est un trimestriel d’art contemporain basé à Liège, en Belgique.

L’Espace Georges Truffaut est un lieu d’accueil, d’échanges, de créativité et de découvertes culturelles qui propose des actions de rencontres entre citoyens d’âges, d’origines et de cultures différentes. C’est aussi un lieu de diffusion.

Centre culturel reconnu par la FWB actif sur les communes de Braives et Burdinne


L’EsTiRire organise des manifestations qui auront toujours un rapport avec l’humour. Sa manifestation principale s’articulera autour du Festival du 1 mai



Evazio, c’est votre espace artistique de référence à Liège, une vitrine créative pour les artistes multidisciplinaires belges et internationaux. Une galerie d’art différente qui offre une parenthèse artistique et festive à tous.

Votre partenaire pour tous vos évènements privés et professionnels, spécialiste du jeu géant en bois


La ferme castrale de Hermalle-sous-Huy, située en Belgique dans le village de Hermalle-sous-Huy ([ʔɛʁmalsuɥi]), section de la commune d’Engis, dans la vallée de la Meuse en province de Liège, est l’ancienne ferme du château de Hermalle dont l’origine remonte au xiie siècle.
Naissance et évolution des bâtiments
Au xviie siècle, le comte du Saint-Empire romain Conrard d’Ursel, propriétaire du château de Hermalle, fait rénover et agrandir son bien.
Il le dote notamment d’une tour-porche d’entrée, avec un portail cintré que surmonte une bretèche en tuffeau ornée d’un cartouche daté 1642 ; on y accède en passant sur un pont à trois arches surplombant les douves, puis en franchissant un pont-levis.
L’entrée débouche sur un vaste espace clôturé d’un mur d’enceinte marqué de tours cornières à trois niveaux.
À l’intérieur de cette enceinte, côté est, le comte fait édifier un corps de bâtiment comprenant une habitation pour le fermier et son personnel ainsi que des locaux à vocation d’étables, porcheries, etc., surmontés d’un vaste fenil.
Toujours dans l’enceinte, à l’angle sud-est, une porte charretière cintrée s’ouvre sur une vaste grange « en large ». Dans son prolongement sud, deux écuries sont bâties, avec voutes sur croisées d’ogives et doubleaux retombant sur des piliers monolithes carrés à chapiteaux creusés en cavet.
Au xviiie siècle, par la construction d’une aile supplémentaire qui sépare la basse-cour de l’avant-cour du château, les bâtiments agricoles deviennent une « ferme en carré » — structure traditionnelle des fermes de Hesbaye et du Condroz —.
Au milieu du xixe siècle, vers 1856, la ferme, malgré son importante superficie, se révèle trop petite et nécessite un agrandissement qu’entreprend son nouveau propriétaire, le baron Charles Marie Louis de Potesta d’Engismont, un espace est récupéré dans la grange par la construction d’un étage pour constituer au rez-de-chaussée une étable supplémentaire.
D’autre part, l’aile est est doublée en largeur, au-delà du mur d’enceinte, sur toute sa longueur, sauf à l’emplacement d’une petite parcelle cadastrée cimetière où se trouve le tombeau de Charles Eugène Joseph de Warzée d’Hermalle et où l’on édifie plus tard une grotte de Lourdes. La façade de l’agrandissement met particulièrement ce tombeau en valeur ; dans les années 1960, elle est amputée de presque un tiers de sa hauteur1.
La ferme est définitivement isolée de l’avant-cour du château par la construction d’une demi-tourelle et d’un muret au bout de l’aile Ouest.
Caractéristiques architecturales
Les murs extérieurs sont en briques sur un soubassement biseauté de moellons de grès et calcaire.
Les encadrements des baies, en pierre de taille, diffèrent selon les époques de construction ; en outre, certains linteaux de porte ont été modifiés au xixe siècle par souci d’esthétisme.
La toiture en ardoise, à croupe et bâtières est plantée, sur les versants du côté cour, de lucarnes à pennes.
Les façades visibles depuis la voie publique sont toutes différentes :
- au nord, rue Gerée, la façade présente des éléments du xviie siècle — notamment la feuillure du tablier du pont-levis, le portail aux montants harpés à bossages et la bretèche — du xviiie siècle et du xixe siècle pour les baies ;
- à l’est, ruelle de l’église Saint-Martin, elle relève, à la suite de l’agrandissement du bâtiment, de l’architecture industrielle ;
- au sud, chaussée Freddy Terwagne, elle est partiellement dissimulée par un mur de clôture élevé au xixe siècle. Son unique porte par où rentre le public, est faite d’une récupération au cintre posé sur harpes avec Clef d’arc centrale datée 1641 et sculptée aux armes du comte d’Ursel.
La façade extérieure du xviiie siècle de l’aile Ouest, donnant sur l’avant-cour du château (privé) n’est pas accessible ; elle a été masquée au xixe siècle par l’édification d’un mur en trompe-l’œil.
Nouvelle affectation
Dans le dernier quart du xxe siècle, à la suite de l’arrêt de l’activité agricole, la ferme est laissée à l’abandon et finalement vendue par ses propriétaires de l’époque, la famille de Potesta qui a peu à peu démembré le domaine seigneurial.
Achetée fin 1990 par une coopérative de particuliers, elle connait le début d’une rénovation non encore achevée.
En septembre 1991, la grange qui possède l’une des plus belles charpentes de la province, est ouverte pour la première fois au public lors des Journées du Patrimoine. Le lieu ainsi que l’exposition qui y est présentée, « Patrimoine culinaire ancien dans les collections privées », reçoivent un tel accueil du public que cela va influencer sur le devenir du bâtiment. Ainsi une association sans but lucratif est créée deux ans plus tard et y développe au fil des ans, tout en aidant à la restauration architecturale, un projet culturel et touristique.
Dans la Ferme castrale se trouvent aujourd’hui les bibliothèque et musée de la Gourmandise, le musée Postes restantes, le syndicat d’initiative local et une bouquinerie. L’ancien corps de logis constitue une habitation privée et la vieille fumière est devenue un petit jardin d’agrément.
Patrimoine naturel
La Ferme castrale est située en zone d’intérêt paysager.
Deux arbres sont répertoriés par la région wallonne sur le site :
- un séquoia géant (Sequoiadendron giganteum), dans la drève de la ferme (anciennes douves comblées) qui s’étend le long du mur de l’ancien cimetière de Hermalle ;
- un érable sycomore (Acer pseudoplatanus), dit « arbre du pendu-noyé », au bord des douves, entre la ferme et le château.
Classement comme monument historique
Le classement du bâtiment par le Gouvernement wallon a été refusé en 2006 mais une nouvelle demande a été faite au début de l’été 2008 accompagnée d’une pétition de soutien ouverte le 31 juillet 2008.
La pétition a réuni 1 118 signatures, dont 146 par internet émanant de la région wallonne mais aussi de la région de Bruxelles-Capitale, de la région flamande, de France, d’Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, des États-Unis. D’autres signataires se sont rendus sur place car la presse avait relayé l’information.
Le 7 octobre 2008, le conseil communal d’Engis a voté à l’unanimité la demande de classement à la région wallonne et la demande d’inscription du bâtiment sur la liste de sauvegarde.
La Ferme a été inscrite le 27 avril 2009 sur la liste de sauvegarde de la région wallonne. Le ministre Benoît Lutgen a confirmé au conseil communal d’Engis, le 6 octobre 2010, le classement comme monument intervenu en avril 2009, mais en s’appuyant sur une formulation erronée de l’administration du patrimoine2. La Ferme n’est donc toujours pas classée au 20 octobre 2010.
Une enquête publique est annoncée le 23 février 2012 par publication légale dans les journaux ; traditionnellement d’une durée de 15 jours, elle doit se clore le 5 mars suivant3.





Festival international du film de comédie de Liège
Le Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) a été créé en 2016. Il a lieu au coeur de la Cité Ardente dans différents lieux bien connus tels que le Forum de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie ou encore la Cité Miroir. Le festival est organisé chaque année et propose une compétition officielle de longs et courts métrages nationaux et internationaux. Un panel d’activités est également proposé aux visiteurs : des conférences avec les invités, des débats, des leçons de cinéma, des masterclass, des séances de dédicaces, des castings de figurants, des hommages… Le FIFCL est l’unique festival en Belgique à récompenser la comédie au sens large, l’objectif est de la récompenser mais aussi de la faire découvrir ou redécouvrir dans une dimension internationale. Depuis la première édition, ce sont une trentaine de pays qui ont été représentés durant le festival.
Histoire
Cérémonie d’ouverture au Forum de Liège – édition 2019
Le Festival International du Film de Comédie de Liège a été créé en 2016.
Bien qu’étant un jeune festival, il marque de grandes évolutions de son concept mais aussi une croissance de son nombre de visiteurs d’année en année.
Le FIFCL est soutenu par une équipe d’une trentaine de personnes, toutes spécialisées dans un domaine.
Cette équipe est chapeautée par quatre personnes : Adrien François le délégué général, Nicolas Vandenckerckhoven le directeur financier, Samuel Danas le directeur opérationnel et Julien Delaunois le chef de projet.
Organisation
Clovis Cornillac – édition 2019
Le Festival International du Film de Comédie de Liège est un événement qui regroupe non seulement les amateurs du septième art, toutes générations confondues, mais également les professionnels.
La volonté du FIFCL, en parallèle à la découverte de la comédie internationale, est également de rapprocher les comédiens, les réalisateurs, les producteurs et les distributeurs afin de favoriser les échanges internationaux au sein de l’industrie du cinéma.
La mise en place de rencontres professionnelles pour la cinquième édition va renforcer cette volonté d’échange.
Programme
- Compétition officielle de longs et de courts métrages, en présence des jurys dans les salles.
- Conférences et rencontres avec les personnalités invitées.
- Leçons de cinéma.
- Masterclass.
- Séances scolaires.
- Séances de dédicaces.
- Hommages.
- Castings de figurants.
Comité de sélection
Le Comité de sélection du Festival International du Film de Comédie de Liège est composé de quatre personnes :
- Pierre de Gardebosc
- Dany Habran
- Edouard Montoute
- Adrien François
Prix
The Crystal Comedy Award : prix symbolique remis pour la carrière d’un acteur lors des cérémonies.
- Grand Prix du Festival : prix du jury longs-métrages.
- Prix de la Critique : prix du jury de la critique (depuis l’édition 2018).
- Prix Spécial du Jury : prix spécial remis à un long-métrage.
- Prix du Court-métrage.
- Prix UPCB (union de la presse cinématographique belge) (depuis l’édition 2019).
- Prix de la Province de Liège (depuis l’édition 2019)
Remise du Crystal Comedy Award à Thierry Lhermitte par Gérard Jugnot
Crystal Comedy Award
- Edition 2016 : Daniel Prévost
- Edition 2017 : Gérard Darmon
- Edition 2018 : Josiane Balasko, Alex Lutz et Jean-Marie Poiré
- Edition 2019 : Elie Semoun, Thierry Lhermitte et Clovis Cornillac
Le chapiteau
Il est installé sur la place Cathédrale en plein centre de la Cité Ardente, non loin du cinéma Kinepolis – Le Palace et du Forum de Liège.
La chapiteau est ouvert tous les jours durant le festival, en entrée libre. Vous y retrouvez un bar, un espace nourriture, un vestiaire, des concerts, des interviews sur le plateau TV, vous pouvez également y rencontrer l’équipe du festival ainsi que les invités.
Le plateau TV
Plateau TV du FIFCL avec Elie Semoun et Mylène Demongeot
Nouveauté pour la quatrième édition, le chapiteau a vu naitre le plateau TV du FIFCL permettant à Manuel Houssais et Sandy Louis, journalistes pour le FIFCL de réaliser les interviews des invités.
Ces interviews étaient retransmises en direct à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du chapiteau sur écrans géants, elles étaient également diffusées en direct sur les réseaux sociaux.
il y a quatre directs par jour d’une durée de vingt minutes ainsi que des directs spéciaux d’une quarantaine de minutes avant les cérémonies d’ouverture et de clôture.
Les dalles en pierre bleue
C’est également une nouveauté de l’édition de 2019, dix dalles en pierre bleue gravées aux noms des invités d’honneur ont été placées le long de la rue Pont d’Avroy à Liège. Les dalles ont été réalisées par Jozia Gozdz. Les invités présents lors du festival ont pu les inaugurer et repartir avec un souvenir, toujours un taureau, symbole liégeois, mais cette fois pas en cristal.
Les dix noms gravés sont :
- Stéphane Guillon,
- Josiane Balasko,
- Thierry Lhermitte,
- Gérard Jugnot,
- Mylène Demongeot,
- Elie Semoun,
- Eric Judor,
- Clovis Cornillac,
- Gérard Darmon,
- Daniel Prévost
La Comédie
La bière La Comédie, bière officielle du FIFCL
L’équipe de Lucky De Bruyn a mis notre Festival en bouteille. C’est une bière blonde artisanale surmontée d’une mousse blanche, fine et crémeuse, qui vous ravira le palais par son goût riche en agrume.
Pour se faire, l’équipe de brasseurs utilise une technique particulière : l’ajout de houblon à froid. Cette dernière permet à la bière de développer un nez complexe et fruité. Tout comme l’emploi d’une levure anglaise pour des notes fleuries et un corps délicat titrant 4.5% d’alcool. Avec l’utilisation d’un malt belge de haute qualité et d’un houblon allemand de très haute qualité.
Une bière que vous pourrez déguster pendant toute la période du festival, mais également dans différents points de vente en plein cœur de la ville.
La Comédie c’est également l’occasion pour nous de donner encore un peu plus de rires, aux enfants cette fois. En effet, pour chaque bière vendue le festival reverse une partie de la somme à l’association « Rire à l’Hôpital ».
Palmarès
Palmarès 2016
Le jury longs métrages
Éric Judor (Président), Daniel Prévost, Stéphane Bissot, Dominique Pinon, Guy Lecluyse et Olivier Bronckart
Le jury courts métrages
Renaud Rutten, Gérard Chaillou, Isabelle de Hertogh, Mourade Zeguendi
Les prix
- Grand prix du festival : Going to Brazil de Patrick Mille
- Prix spécial du jury : Banana d’Andréa Jublin
- Prix du meilleur court-métrage : La méthode Greenberry de Baptiste Bertheuil
Palmarès 2017
Le jury longs métrages
Gérard Darmon (Président), Catherine Jacob, Frédéric Diefenthal, Tania Garbarski, Patrick Mille et Pauline Lefèvre
Le jury courts métrages
Edouard Montoute, Anouchka Delon, Nicolas George, Jean-Baptiste Shelmerdine, Catherine Benguigui
Les prix
- Grand prix du festival : Tout mais pas ça d’Edoardo Falcone
- Prix spécial du Jury : Je vais mieux de Jean-Pierre Améris
- Prix d’interprétation : Valérie Bonneton
- Prix du meilleur court-métrage : Timing de Marie Gillain
- Prix du meilleur scénario : Deux dollars de Emmanuel Tenenbaum
- Coup de cœur du festival : Kapitalistis de Pablo Muno Gomez
Palmarès 2018
Le jury longs métrages
Stéphane Guillon (Président), Élise Larnicol, Laurent Brochand, Philippe Duquesne, Vincent Lannoo et Yvan Le Bolloc’h
Le jury courts métrages
Nicolas Benamou, Jean-Jacques Rausin, Pablo Andres, Sophie Maréchal, Hector Langevin
Le jury de la critique
Aurore Engelen, Edouard Montoute, Frédéric Vandecasserie, Mathieu matthis, Nicky Depasse
Les prix
- Grand prix du festival : Tel Aviv On Fire de Sameh Zoabi
- Prix de la critique : Tel Aviv On Fire de Sameh Zoabi
- Coup de cœur du festival : Mauvaise Herbes de Kheiron
- Prix d’interprétation : Renaud Rutten et Damien Gillard
- Prix du meilleur court-métrage : État d’alerte sa mère de Sébastien Petretti
- Prix du meilleur scénario court-métrage : On récolte ce que l’on sème de Barta Tom
- Coup de cœur du festival court-métrage : May Day de Olivier Magis et Fedrik De Beul
- Coup de cœur du festival court-métrage : On n’est pas des bêtes de Guillaume Sento
Palmarès 2019
Le jury longs métrages
Mylène Demongeot (présidente), Bruno Solo, Alysson Paradis, Antoine Duléry, Xin Wang, Nabil Ben Yadir
Le jury courts métrages
Solange Cicurel, Kody, Emmanuelle Galabru, Marc Riso
Le jury de la critique
Raphael Mezrahi, Vanessa Le Reste, Manuel Houssais, Catherine Habib
Le jury UPCB
David Hainaut, Elli Mastorou, Eric Russon
Le jury de la Province de Liège
Les prix
- Grand prix du festival : Docteur ? De Tristan Séguéla
- Prix de la critique : Music Hole de David Mutznmacher et Gaetan Liekens
- Prix du meilleur réalisateur : Elia Suleiman pour It Must Be Heaven
- Prix d’interprétation : Hakim Jemili pour Docteur ?
- Prix d’interprétation : Alexane Jamieson pour Jeune Juliette
- Prix du meilleur court-métrage : Burqa city de Fabrice Bracq
- Prix du meilleur scénario : Pile Poil de Lauriane Escarffre et Yvonnick Muller
- Coup de cœur : Ma Dame au Camélia de Edouard Montoute
- Prix du jury UPCB : Pile Poil de Lauriane Escarffre et Yvonnick Muller
- Prix du jury de la Province de Liège : Jeune Juliette de Anne Emond


Les Ardentes
Les Ardentes est le nom d’un festival de musique qui se déroule début juillet à Liège. Au départ sous-titré électro–rock, le festival s’ouvre rapidement à toutes les musiques pop, rock, musiques électroniques, chanson française mais aussi hip-hop et même jazz avant de devenir essentiellement un festival de Hip Hop et de musiques urbaines à partir de 20181. Il devient l’un des rendez-vous incontournables de l’été pour les festivaliers dans l’Euregio
De 2006 à 2019, le festival se déroulait dans le parc Reine Astrid à l’est du centre-ville de Liège, tout près de la ville de Herstal. Mais l’événement se voit contraint de déménager à cause du projet de la construction d’un écoquartier et devrait normalement s’installer rue de la Tonne à Rocourt, sur les hauteurs de Liège près de la commune d’Ans, pour l’édition 2020, reporté finalement en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.
Historique
2006-2019 : Les Ardentes à Coronmeuse
Fondé en 2006, le festival se veut tout d’abord électro–rock puis décide de s’ouvrir tout doucement aux autres musiques que ça soit de la pop, du rock, de la musiques électroniques, de la chanson française mais aussi hip-hop et même jazz.
Au tout début, le festival était composé de trois scènes, la principale, Le Parc’,’ situé dans le parc Reine Astrid, et les deux autres situés dans le Halles des Foires de Coronmeuse, la FIL et l’ Aquarium. Lors de cette première édition, la tête d’affiche du festival était Indochine.
Avec 25000 festivaliers, Les Ardentes décident de passer de trois à quatre jours en 2007 et bat le record de l’année précédente avec 43000 festivaliers. En 2008, un festival parallèle a lieu en janvier Les Transardentes qui se veut essentiellement electro. Pour ce qui est du festival à proprement parler, celui-ci décide, pour rendre hommage à la fermeture haut-fourneau 6 dans à Seraing dans le bassin sidérurgique liégeois donc, de renommer la FIL, la HF6. Cette troisième édition voit notamment comme tête d’affiche Puggy et Arno. Le festival passe à 56 000 personnes et continue son ascension.
Lors de la quatrième édition, le Festival passe à 57 000 festivaliers et Le Parc est renommé Open Air Park mais qui redeviendra Le Parc l’année suivante en 2010. Cette cinquième édition passe à 60 000 festivaliers et accueille le groupe N.E.R.D. avec Pharrell Williams.
La sixième édition rassemble plus de 70 000 personnes2. Les journées de vendredi et du dimanche étaient à guichets fermés, et les pass 4 jours étaient tous vendus. La scène HF6 est installée dans un chapiteau à la suite de l’incendie survenu plus tôt dans l’année aux Halles des Foires de Liège3. Une quatrième scène Red Bull Elektropedia est ouverte les vendredi et samedi tandis que Le Parc se renomme pour cette édition Open Air. Pour célébrer ses cinq ans, le festival propose le camping gratuitement4.
En 2012, le festival tombe à 67 000 festivaliers. La scène HF6 réintègre les Halles des Foires reconstruites aux côtés des scènes Aquarium et Red Bull Elektropedia. Cette édition est marquée notamment par la venue du rappeur 50 Cent. En 2013, Les Ardentes repassent à trois scènes en supprimant l’ Aquarium. Le festival accueille 60 000 festivalier et reçoit des artistes tels que -M-, dEUS, Mika, Kaiser Chiefs, NAS ou encore Steve Aoki.
La neuvième édition lors de l’année 2014 bat tous les records d’affluence établit précédemment par le festival avec 70 000 festivaliers et des artistes tels que Placebo, Massive Attack, M.I.A., Shaka Ponk, Selah Sue, Wiz Khalifa, Method Man et Redman, IAM, Vitalic Vtlzr, T.I., Mobb Deep, Nneka mais surtout Stromae qui rassemble 20 000 spectateurs pour son concert au Parc. Cette édition voit aussi le retour de l’ Aquarium qui avait été réclamés par les festivaliers.
La dixième édition représente en quelque sorte un tournant pour le festival, celui-ci commence tout doucement à se spécialiser dans la musique Hip hop. D’ailleurs, il arrive à attirer l’artiste de l’année Kendrick Lamar et une affiche saluée comme la meilleure de l’histoire de l’événement5. Le festival conforte sa notoriété à l’étranger mais connaît une baisse de fréquentation de son public local avec 64 000 festivaliers6.
En 2016, pour fêter ses dix ans, le festival ajoute un cinquième jour et accueille le groupe Indochine dix ans après le passage du groupe à la première édition. Pharrell Williams est également de retour après sa prestation avec N.E.R.D en 2010. Le festival se positionne comme un des événements majeurs en Europe pour les amateurs de hip-hop et de musiques urbaines. La scène Aquarium est ouverte pour la première fois du jeudi au dimanche. Cette édition voit aussi la venue de Tyler The Creator, PNL, Nekfeu, Bigflo & Oli ou encore des Casseurs Flowters.
Lors de l’édition 2017, les deux scènes intérieurs, à savoir l’ Aquarium et le HF6 qui se trouvaient dans le Hall des Foires sont supprimés. Deux nouvelles scènes font leur apparition à savoir La Rambla d’une capacité de 2.000 personnes pour remplacer l’ Aquarium et la Wallifornia Beach d’une capacité de 8000 personnes pour remplacer la HF67. Les têtes d’affiches de cette édition sont Booba, DJ Snake, Sean Paul, Young Thug, Julien Doré, Damso ou encore Roméo Elvis.
En 2018, le festival bat son record d’affluence en passant la barre symbolique des 100 000 festivaliers avec une affiche composée entre autres d’Orelsan, 6ix9ine, Damso, Wiz Khalifa, MC Solaar, Suprême NTM, Lorenzo, Vald, Angèle, Playboi Carti, Rilès, Prime ou encore de Massive Attack.
L’édition 2019, soit la dernière édition passée à Coronmeuse revoit le festival réédité les 100 000 festivaliers. Une édition qui voit venir comme tête d’affiche Black Eyed Peas mais aussi des artistes tels que Koba LaD, Booba, Roméo Elvis, Petit Biscuit, Sofiane, Heuss l’Enfoiré, Gringe, Rick Ross, Aya Nakamura, Lomepal, Lacrim ou encore Dadju. La dernière édition à Coronmeuse a été jugé globalement positive car, il a vu de nombreuses annulation d’artistes et même de leurs remplaçants. En effet ce fut le cas de Maes mais surtout de la journée de dimanche avec l’annulation des trois rappeurs US Kodak Black, Lil Uzi Vert ainsi, qu’à la dernière minute, de Young Thug. Les deux premiers sont remplacés par Offset qui se voit également contraint d’être annulé et sera remplacés par deux rappeurs français Vald et Niska.
2020 : un avenir encore flou
La friche située à proximité de l’ancien siège de la Société anonyme des Charbonnages d’Ans et de Rocourt est envisagée pour héberger le festival musical à partir de juillet 20208.
Mais cela n’a pas plu aux deux agriculteurs auxquels la société wallone du logement prêtait précédemment le terrain (gratuitement); ils sont revenus avec plusieurs tracteurs et ont labouré le terrain, détruisant les 25 hectares de pelouse que les organisateurs du festival avaient semé au prix de 30 000 €. Les organisateurs ont obtenu du juge des référés que ces agriculteurs « vandales » soient interdits d’accès au terrain, et ceux-ci sont allés en justice pour contester cette « expulsion »9. Finalement, à l’issue d’un accord, le festival pourra organiser son festival à Rocourt sans craindre de nouvelles actions des agriculteurs10.
Mobilité
Le festival est facilement accessible : des navettes spéciales TEC permettent aux festivaliers de faire un aller-retour entre le site et la gare des Guillemins en passant par le centre ville. Grâce à sa situation, le festival organise un camping situé le long de la Meuse à une centaine de mètres du site des concerts.
Contestation
Un mouvement appelé « les Barbantes » s’est créé entre 2009 et 2015 pour mettre en valeur les lieux alternatifs et underground liégeois. Il porte une critique radicale du modèle des Ardentes et des festivals belges en général.
Notes et références
- dh.be, « Les Ardentes, urbaines, jeunes et pratiquement sold out » [archive], sur dh.be (consulté le 19 juillet 2019)
- « 70 000 festivaliers aux Ardentes à Liège » [archive], sur RTBF Info, 10 juillet 2011 (consulté le 2 mai 2016)
- « Violent incendie aux Halles des foires de Coronmeuse » [archive], sur http://www.lavenir.net (consulté le 2 mai 2016)
- « Ardentes 2011 : camping gratuit » [archive], sur http://www.rtc.be (consulté le 2 mai 2016)
- « Le parcours de Moustique aux Ardentes 2015 » [archive], sur Moustique.be (consulté le 2 mai 2016)
- « Pour conclure les Ardentes 2015… | frontstage/ » [archive], sur blog.lesoir.be (consulté le 2 mai 2016)
- « Dour ou Les Ardentes? » [archive], sur https://fr.newsmonkey.be/ [archive] (consulté le 19 juillet 2019)
- Les Ardentes 2020 sur le site de Rocour [archive]
- Des agriculteurs déclarent la guerre aux organisateurs du festival les Ardentes [archive], rtbf.be, publié le 22 janvier 2020 (consulté le 23 janvier 2020).
- [1] [archive], todayinliege.be, publié le 11 mars 2020 (consulté le 29 mai 2020).
- « Drake ne viendra pas aux Ardentes » [archive], sur 7s7 (consulté le2 mai 2016)



03 > 13/06/21 | Herve, Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège

Le Festival Vacances Théâtre Stavelot se déroule chaque année au début du mois de juillet et propose des spectacles riches et variés, pour petits et grands, dans le cadre enchanteur de l’ancienne Abbaye de Stavelot

Le Festival FiestaCity c’est 3 jours de musique, 4 scènes et plus de 50 concerts gratuits à Verviers



Fonts baptismaux de Saint-Barthélemy
Les fonts baptismaux de Notre-Dame1 de la collégiale Saint-Barthélemy à Liège sont un chef-d’œuvre d’art mosan, tant sur le plan esthétique que sur le plan technique. Les passionnés de l’art mosan2 les présentent comme « une des sept merveilles de Belgique ».
Histoire
Premières installations
Les fonts baptismaux proviennent de l’église Notre-Dame-aux-Fonts, érigée sous Notger, premier prince-évêque de Liège, vers la fin du xe siècle, mais il n’est pas impossible que les fonts étaient primitivement dans la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège. Cette petite église se trouvait sur son flanc Sud-Est. Elle était la seule à pouvoir conférer le baptême et resta la paroisse mère de Liège jusqu’à la fin de la Principauté de Liège.
Attribution à Renier de Huy
Selon les sources des vieux historiens deux traditions s’opposent, c’est au début du xiie siècle, que l’abbé Helin, Hillin ou Helinus, décédé en 1118, fils du duc de Souabe et prévôt de Saint-Lambert en 1095, abbé-curé et décimateur de Notre-Dame-aux-Fonts et fondateur de l’hôpital Saint-Mathieu à la Chaîne sous le règne d’Otbert les auraient fait réaliser. L’autre tradition voit Albéron II, évêque de Liège de 1135 à 1145 qui serait le donneur d’ordres des fonts pour le baptistère. Pour établir cette attribution, les historiens se basent sur un texte liégeois, le Chronicon Rythmicum Leodiense, qui précise que l’abbé Hellin « fit faire » (fecit) les fonts ce qui daterait la cuve de son abbatiat, au début du xiie siècle.
Sur base de témoignages de ces chroniqueurs3 qui vont décrire les Fonts comme exceptionnels mais ne vont rien dire quant à leur provenance et d’historiens versificateurs comme Jean d’Outremeuse qui aimait à magnifier les principautaires mais donne trois versions différentes4, l’œuvre est attribuée à un orfèvre hutois Renier de Huy5,6 et située entre 1107 et 1118. Mais d’autres sources, comme Louis Abry, précisaient que « les fonts ont été razziés au-delà des monts ».
Une attribution contestée
Il est difficile de contredire les spécialistes qui précisent qu’au xiie siècle ce type de fondeur capable de couler des pièces complexes et de grande dimension ne se trouvait pas à Liège7. Il y avait d’excellents orfèvres à Liège mais ce n’est pas la même chose de fabriquer un encensoir ou même une cloche et une pièce aussi parfaite. Les historiens actuels semblent plutôt croire qu’il s’agit d’une rapine de l’empereur Henri IV du Saint-Empire, trésor rapporté et donné en remerciement à l’évêque Otbert pour son aide avec les chevaliers hesbignons lors de la prise de Milan en 1112. D’autres chercheurs proposant que ces fonts, de par leur influence byzantine — le baptême faisant partie du cycle de l’iconographie byzantine — proviendrait de Saint-Jean de Latran et suggérant plutôt l’an mille comme date de fabrique. Il est toutefois possible que l’abbé Hellin soit le donneur d’ordre d’un des bœufs8. Mais on peut objecter que la tradition carolingienne reçoit une inspiration de Byzance9.
Un oubli de quatre siècles
Entre le xive et le xviie siècle, plusieurs visiteurs viennent à Liège et, plus ou moins prolixes, ils décrivent Liège, mais seul Francesco Guicciardini évoque Notre-Dame-aux-Fonts, comme une des trois églises paroissiale de la cathédrale10. Il faut attendre Saumery, dans le premier tome de ses Délices, relatif à la cité mosane, qui va consacrer quelques lignes à son histoire et ses œuvres d’art. Mais plus un mot sur cet art médiéval qui est déjà considéré comme archaïque. C’est peut-être ce peu d’intérêt qui sauva la « sainte cuve » à la Révolution.
Installation dans la collégiale en 1803

Les fonts baptismaux de Furnaux, également inspiré par la théologie de Rupert de Deutz
Pendant la Révolution française, Notre-Dame-aux-Fonts est détruite ainsi que la cathédrale. De 1796 à 1803, la cuve est cachée chez des particuliers, puis amenée à l’église Saint-Barthélemy qui avait perdu son chapitre et était convertie en église paroissiale. Les Fonts sont remis en service en février 180411. Deux bœufs de la base originale et le couvercle ne furent pas retrouvés. On suppose que le couvercle était en laiton, comme la cuve, et qu’il portait les figures des apôtres et des prophètes de l’Ancien Testament. Selon une étude, ce couvercle serait dans les combles du Victoria and Albert Museum à Londres[réf. nécessaire].
Le village de Furnaux possède des fonts baptismaux en pierre qui, sans être la réplique de ceux de Liège, sont inspirés par la même théologie, celle de Rupert de Deutz.
Description
Matériau espagnol et sarde
Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est le matériau principal des fonts dont les pourcentages sont de 77 % et 17 %12 Le cuivre, dans l’Empire, ne se trouve que dans le Harz, (Goslar). Au Moyen Âge, le zinc ne s’obtient pas à l’état métallique mais à partir du carbonate de zinc que l’on trouve en pays mosan, à La Calamine par exemple. On trouve également un peu de plomb dont l’analyse isotopique démontre qu’il n’est pas d’origine locale et sûrement pas de la vallée de la Vesdre ni du Harz. Cette analyse démontre une provenance espagnole ou sarde. En comparaison les fonts de Tirlemont sont réalisés avec du plomb local en 1149. Enfin le grain de l’alliage des fonts de Liège ne correspond pas au grain qui caractérise toutes les œuvres en laiton produite dans la région aux environs du xiie siècle. Ces éléments tendrait à croire que les fondeurs de cette œuvre aient utilisé une méthode de fonte unique à Liège, alors qu’ils maîtrisaient mieux les leurs13.
Le socle, en pierre, fut taillé lors de la mise en plan en 1804.
Iconographie
Les douze bœufs
Les bœufs — douze à l’origine — correspondent à un symbole repris dans l’Ancien Testament.
En effet, dans le Livre des Rois, on nous dit que Salomon a commandé une « Mer d’airain » supportée par 12 bœufs, pour le parvis d’un temple. Mais il se peut aussi que les douze bœufs de la mer d’Airain représentent les douze pasteurs, les douze apôtres.14 Dès lors, les bœufs, orientés par trois vers les quatre points cardinaux pourraient symboliser la mission confiée par le Christ aux douze apôtres : « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les ».

Le baptême de Corneille
La prédication de saint-Jean-Baptiste
Le groupe face au saint est un condensé de la foule qui devait écouter ce précurseur ; les émotions éprouvées par ce groupe apparaissaient très bien sur les visages. Entre Saint-Jean-Baptiste et le groupe, il y a un vide pour montrer le fossé qui existait entre les nouvelles conceptions et les anciennes. Un bras de Saint-Jean-Baptiste se tend pour tenter de combler ce fossé. Le Précurseur, qui porte le manteau des ermites du désert, appelle à la pénitence des publicains vêtus à la façon des riches marchands et un homme d’armes : cotte de mailles, casque de type bassinet, bouclier normand suspendu au dos.
Le baptême du Christ dans le Jourdain
La scène principale est le baptême du Christ. Saint Jean-Baptiste est vêtu d’une mélotte, le vêtement des ermites du désert ; il fait preuve de beaucoup de respect et d’humilité face au Christ.
Le Christ est plongé nu-corps dans le Jourdain ; il est le seul personnage de face de la cuve. Avec sa main droite, il fait le signe de la Trinité. Au-dessus de lui, Dieu est représenté par une tête de vieillard nimbée, inclinée vers Jésus et entourée d’un nuage figuré par une moulure semi-circulaire d’où surgissent des rayons. En signe de respect, les anges se cachent les mains sous un linge qu’ils tendent au Christ.
Le baptême du centurion Corneille
Le baptême de Corneille par saint Pierre. Corneille, centurion romain, devait entendre parler du Christ et de son enseignement.
II fit appeler saint Pierre afin d’obtenir des éclaircissements ; celui-ci, selon la loi hébraïque, ne pouvait partager le toit d’un païen. Finalement, il entendit Dieu en rêve et se rendit chez Corneille où il le baptisa avec sa suite.
Le baptême du philosophe Craton par saint Jean l’Évangéliste
La scène adjacente est le baptême de Craton. Ce philosophe grec, qui préconisait le mépris de la richesse, fut converti et baptisé par saint Jean l’Évangéliste, reconnaissable au livre qu’il tient à la main.
Ces deux scènes font preuve d’une grande unité. D’abord dans les sujets mais aussi dans la composition ; normalement, un arbre stylisé sépare les scènes, ici, il est absent.
Le baptême des néophytes ou baptême de pénitence
Jean baptise deux jeunes gens entrés jusqu’aux genoux dans le Jourdain. Je vous baptise avec l’eau, mais vient après moi celui qui vous baptisera dans l’Esprit-Saint. Deux disciples de Jean montrent par leur attitude qu’ils se tournent vers celui qui vient après Jean. À gauche de la scène principale, le baptême des néophytes. Saint Jean-Baptiste est penché sur les jeunes gens dans une attitude très douce, très humaine. Les néophytes ont des corps souples, parfaitement modelés, presque en ronde-bosse. Les deux personnages de droite quittent vraisemblablement ce baptême pour se diriger vers le Christ ; la position de leurs pieds permet cette supposition.
Influences
La cuve est le point de rencontre des influences grecque, byzantine et mosane. On remarque que les êtres purificateurs et précurseurs sont d’une taille supérieure ; les personnages sont au nombre de 20 et représentés selon le procédé de la frise romaine telle qu’on la retrouve sur la colonne de Trajan, à Rome.
Les attitudes sont naturelles : corps souples, modèle excellent et proportions respectées, ce qui est une véritable exception au xiie siècle.
Technique
La technique employée est celle de la fonte à la cire perdue qui consiste à sculpter en relief, dans la cire, une ébauche de la cuve sur laquelle on applique une gangue de terre percée de canaux. Ensuite, on retourne le tout et on l’entoure de briques réfractaires pour faire fondre la cire ; le laiton en fusion est coulé dans le moule. Lorsque le métal est refroidi, on le polit au sable fin et on applique une mince pellicule d’or.
Étude par l’archéométrie
Certains chercheurs15 contestent depuis longtemps l’attribution mosane, suggérant une origine byzantine, carolingienne mais manifestement pas mosane16. Les études PIXE, analyses isotopiques des composants métalliques apportent de nouvelles précisions sur les caractéristiques métalliques de la cuve17.
Le cuivre
Une première étude montre qu’au xiie siècle, le cuivre utilisé dans la région mosane vient de l’Allemagne proche : le massif du Harz. L’analyse statistique comparée des abondances relatives des impuretés de la cuve par rapport aux pièces de références, démontre que le cuivre de la cuve ne vient pas du Harz, ce qui conteste leur appartenance au bassin de l’espace Meuse–Rhin18.
Les alliages
Une autre étude démontre ensuite que les techniques mises en œuvre pour la préparation de l’alliage et pour effectuer la coulée devaient être inconnues en région mosane au xiie siècle19. C’est confirmé par la concentration en zinc qui est un marqueur chronologique du début du second millénaire où les laitons européens ne dépassent pas dix pour cent de zinc.
Le zinc
La même recherche est ensuite développée pour vérifier si le zinc de l’Est de la Belgique ou des collines de la Meuse a bien été utilisé. Le zinc métallique n’est pas connu à l’époque ; seuls les gisements locaux sont exploités dans le procédé calaminaire. Deux impuretés associées au minerai de zinc, le cadmium et l’indium démontrent que le zinc de la cuve n’est pas d’origine locale comparé à un corpus de références proposées par les Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles excluant à nouveau la cuve de l’art mosan20.
Le plomb
L’analyse isotopique du plomb de l’alliage de la cuve démontre l’origine géographique du plomb, car au xiie siècle, le plomb est aussi extrait de l’Est de la Belgique et des collines de la Meuse. Dès lors, ce devrait être ce plomb que l’on doit découvrir dans les productions mosanes. Les résultats analysés sont tout à fait contradictoires : le plomb a été extrait d’un gîte métallifère dans la région de Cordoue et Grenade alors que c’est bien le plomb local que l’on trouve dans les pièces de comparaison du corpus mosan. Selon ce dernier critère, la cuve de Liège ne correspond définitivement pas aux échantillons mosans. Toutefois, si tous les résultats démontrent une provenance des fonts radicalement différente, c’est sans pouvoir en préciser la provenance exacte car le plomb espagnol était déjà largement diffusé dans le bassin méditerranéen19.
Datation au début du xve siècle
La cuve des fonts proviendrait sans aucun doute d’une région du bassin méditerranéen où ils ont été réalisés par un atelier tardif ayant gardé le savoir-faire technique des Romains pour la fabrication de laitons à haute teneur en zinc qui est compatible avec les caractéristiques inhabituelles du cuivre et du zinc par rapport au corpus mosan. L’hypothèse byzantine n’est donc pas à exclure, quoique la présence d’une edelweiss pose une autre énigme15. Les métallurgistes mosans ne seront pas capables de réaliser l’alliage de la cuve avant la fin du xive siècle ou, plus certainement, la première moitié du xve siècle, quand le procédé décrit par Théophile aura été perfectionné en plusieurs étapes. L’abbé Hellin n’a donc pas pu faire faire les fonts : il manquait encore trois siècles de progrès technologiques, dès lors, si les méthodes de laboratoire infirment l’appartenance des fonts à l’art mosan et que l’on est bien en présence d’une mauvaise attribution, à ce stade, seules de nouvelles conclusions avec les scientifiques dédieront aux Fonts de Notre-Dame une origine reconnue20.

Street food locale, artisanale, food trucks & animations dans un cadre convivial, familial & festif!

Blind test + quiz déjantés + défis fous = Fool Game !


Lieu de vie collectif expérimental où se cultivent la terre et les liens


Fort d’Embourg
Le Fort d’Embourg est un des 12 forts composant la position fortifiée de Liège à la fin du xixe siècle en Belgique. Il fut construit entre 1888 et 1892 selon les plans du Général Brialmont. Contrairement aux forts français construits durant la même période par Raymond Séré de Rivières, il fut entièrement construit avec du béton non-renforcé, nouveau matériau pour l’époque, plutôt qu’en maçonnerie. Le fort fut lourdement bombardé lors de la Première Guerre mondiale durant la bataille de Liège ainsi qu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été préservé et est devenu un musée.
Description
Le fort est situé à environ 7 kilomètres au sud-est du centre de Liège, à la sortie d’Embourg, non loin de la route qui monte vers Beaufays. Le fort est plus haut en altitude par rapport à la zone environnante que la plupart des forts liégeois, surplombant les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre et contrôlant la route de Liège à Spa.
Le fort forme un rectangle irrégulier, contrastant avec la majorité des forts construits par Brialmont qui étaient plutôt de forme triangulaire. Un fossé de 6 mètres de profondeur et de 8 mètres de large entoure le fort. L’armement principal est concentré dans le massif central. Les fossés étaient défendus en enfilade par des fusils de 57 mm disposés dans des casemates dans le mur de contrescarpe1. Le fort est un des plus petits forts liégeois2.
Mis à part le fort de Loncin, les forts belges possédaient peu de provisions pour subvenir à l’intendance quotidienne d’une garnison en temps de guerre. De plus les latrines, douches, cuisine, morgue se trouvaient dans la contrescarpe, une position intenable au combat. Cela aura d’importantes conséquences sur la capacité des forts à soutenir un assaut se prolongeant. La zone de service était placée directement en face des baraquements, qui s’ouvraient sur le fossé à l’arrière du fort (en direction de Liège), avec une protection moindre que les 2 fossés latéraux1. L’arrière des forts Brialmont était plus légèrement défendu pour faciliter une recapture par les forces armées belges. On trouvait aussi sur ce côté les baraquements et les communs, le fossé arrière permettant l’éclairage naturel et la ventilation. Au combat, les tirs d’artillerie rendaient le fossé intenable et les Allemands ayant pu passer entre les forts pouvaient les attaquer par l’arrière3.
Armement
À l’origine, l’armement du fort d’Embourg incluait pour les cibles à distance une tourelle Grüsonwerke avec un canon Krupp de 21 cm, une tourelle Creusot avec 2 canons de 15 cm et une tourelle Châtillon-Commentry comportant 2 canons Krupp. Pour la défense rapprochée, il possédait 4 tourelles Grüsonwerke avec un canon de 57 mm. Il y avait aussi sur le fort une tourelle d’observation équipée d’un projecteur. 9 canons à tir rapide équipaient les casemates protégeant les fossés et la poterne4,2.
L’artillerie lourde du fort était composée de canons allemands de marque Krupp alors que les tourelles provenaient de diverses origines. La communication entre les forts voisins de Loncin et de Liers pouvait se faire au moyen de signaux lumineux. Les canons utilisaient de la poudre noire ce qui produisait des gaz asphyxiant se propageant dans les espaces confinés du fort5.
Première Guerre mondiale
Liège fut attaquée le 6 août 1914. Les forts de Liège opposant une résistance inattendue aux Allemands, ceux-ci amenèrent une artillerie lourde de siège avec une puissance de feu supérieure à ce à quoi les forts pouvaient résister. Embourg fut lourdement bombardé presque sans interruption du 12 août à 13h au 13 août 1914 à 20h6. C’est l’armement sous coupole dévasté, le massif central ébranlé et sous la menace d’asphyxie que le fort se rend le 13 août au soir, peu après la reddition du fort de Pontisse et la destruction du fort de Chaudfontaine.
Le fort fut occupé par les Allemands durant le reste de la guerre ; ceux-ci y apportèrent quelques aménagements en 1914 et 19152.
Position fortifiée de Liège
L’armement du fort fut amélioré dans les années trente. Celui-ci fera partie de la position fortifiée de Liège dont le but était de ralentir une éventuelle incursion allemande à partir de la frontière toute proche7. Les améliorations consistaient en le remplacement des tourelles d’origine par 4 tourelles équipées de canons de 75 mm et l’installation d’une batterie anti-aérienne. La ventilation, les sanitaires, la communication et l’installation électrique furent également améliorés.
Un casernement d’infanterie équipé d’une cloche pour fusil automatique fut construit en même temps ainsi qu’une tour de prise d’air à distance du fort et reliée à celui-ci par un tunnel En 1940, la garnison du fort comprenait 323 hommes, la plupart des réservistes, commandés par 4 officiers2.
Seconde Guerre mondiale
Le fort d’Embourg fut le premier à entrer en contact avec les forces allemandes durant la bataille de Belgique le 12 mai 1940. Le fort fut encerclé le 13 mai. Le fort voisin de Chaudfontaine fournira un soutien d’artillerie contre l’infanterie allemande qui monta à l’assaut à 22h00. Le 14 mai, les Allemands continuèrent le bombardement sur le fort d’Embourg pendant que ce dernier soutenait de son artillerie celui de Chaudfontaine. Le 15, le bombardement débuta à 14h00 et dura jusqu’à la tombée de la nuit. Le jour suivant, le bombardement continua pendant que l’infanterie infiltrait les abords du fort. Le 17, le fort fut attaqué par l’artillerie, l’infanterie et l’aviation8. Le fort demanda un soutien des forts voisins qui ne purent le fournir. Rapidement, les tourelles de 75 mm furent mises hors combat. Après avoir saboté le fort, la garnison hissa le drapeau blanc le 17 mai vers 20h009.
Actuellement
Une association commémorative fut créée en 1946. Elle érigea un monument et entretient un musée dans le fort. Le fort a été préservé et peut être visité par le public10,11.
Photos
-
Monument au début de la rue du Fort à Embourg
-
Embrasures au niveau de l’entrée principale

Fort de Barchon
Le Fort de Barchon est l’un des douze ouvrages de la ceinture fortifiée de Liège, en Belgique. Des œuvres du Général Brialmont, la forteresse a joué un rôle important autant pendant la Première que pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le fort surplombe la rive droite de la Meuse, et se situe à environ 6,5 km au nord-est du centre de la ville de Liège. Il avait pour mission d’interdire le franchissement du fleuve et de contrôler la route d’Aix-la-Chapelle, située à proximité. Son équipement et son architecture étaient comparables à ceux du fort de Loncin.
Le Fort de Barchon fut assiégé dès les premiers jours de la Première Guerre mondiale par les troupes allemandes. Il fut le premier fort de la Position Fortifiée de Liège à se rendre, le 8 août 1914.
Le fort fut considérablement amélioré et renforcé dans l’entre-deux-guerres. La modification la plus visible était une tour de 18 mètres de haut (visible de l’autoroute E40), qui servait à aspirer de l’air frais à une distance respectable du fort. La tour se trouve à quelques centaines de mètres à l’ouest du fort, auquel elle est reliée par un souterrain.
Le fort est relativement bien conservé, et un musée est actuellement en préparation. Il est ouvert au public quelques jours par an. Les points forts de la visite: la tour d’aération (dont le dernier étage est encore accessible) et la coupole à obusier de 75 mm (au saillant II de l’escarpe), importée du camp d’Elsenborn mais identique à celle qui s’y trouvait en 1940 (c’est d’ailleurs la seule coupole de 1940 encore en place dans un fort belge réarmé). Autre point fort : observer quelles modifications les Belges ont apporté au fort (creusement de nouvelles galeries sous le massif central, etc.)

Le Fort de Battice est l’un des quatre forts construits dans les années 30 et plus précisément de 1934 à 1937. En mai 1940, le fort soutint un siège de 12 jours sous le feu de l’artillerie lourde et de l’aviation allemandes. Une seule bombe lancée par un stuka, par un malheureux ricochet, pénétra dans un bloc de combat en tuant 28 de ses occupants. On peut encore voir, dans le petit musée qui y est installé, l’ampleur des dégâts.
La visite des organes, à 35 mètres sous terre, présente un grand intérêt, malgré la disparition d’équipements enlevés par un ferrailleur dans les années 60 : démonstration dynamique d’une tourelle à 2 canons de 75 millimètres, fresques picturales dans le casernement souterrain, groupe électrogène en parfait état, casemates de tir pour canon de 60 millimètres et mitrailleuse totalement restaurée.
Le fort ne dispose pas de boîtes aux lettres.
Contact : Rue du Puits Saint-Anne 9 – 4620 Fléron
Durée de la visite: 2H30

Fort de Boncelles
Le fort de Boncelles1 a été le théâtre d’une des batailles les plus importantes de la périphérie de Liège en août 1914, la bataille de Liège.
Boncelles est une section de la ville belge de Seraing, située en Région wallonne dans la province de Liège.
Historique du fort
C’est pour préserver sa neutralité tout en protégeant ses voies d’accès qu’une ceinture de 12 forts fut établie autour de Liège. Elle fut édifiée par le général Henri Alexis Brialmont. dans les années 1880-1890. Ces ouvrages étaient remarquables à bien des égards pour l’époque, notamment grâce à l’emploi du béton., matériau inédit pour l’époque. Le général Brialmont utilisa pour ses forts la forme la plus simple à défendre, le triangle. (Les forts d’Embourg et de Chaudfontaine diffèrent de cette forme et arborent un tracé trapézoïdal). Il en fut de même pour Namur, mais avec une ceinture plus petite ne comptant que 9 forts. Les forts étaient tous distants de moins de 10 km de la cité. Ils furent construits à la suite de la guerre de 1870 opposant Français et Allemands.
Les forts de la ceinture de Liège sont Barchon, Évegnée, Fléron, Chaudfontaine, Embourg, Flémalle, Hollogne, Loncin, Lantin, Liers, Pontisse et Boncelles.
Les fort de la ceinture de Namur sont Andoy, Cognelée, Emines, Dave, Maizeret, Malonne, Marchovelette, Saint Héribert et Suarlée.
1914-1918
La bataille de Sart Tilman2 est un des épisodes les plus marquants de la région. Les troupes belges avaient pour ambition de freiner l’avance allemande. Une église a été élevée à la mémoire des soldats tombés lors de ce combat qui eut lieu dans la nuit du 5 au 6 août 1914. Une plaque commémorative a été apposée sur la ferme de la Cense Rouge non loin de là.
1940-1945
Le fort d’Ében-Émael fut le premier à tomber aux mains de l’ennemi le 11 mai 1940. Les forts de Liège, délaissés par les troupes de campagne, se bornèrent à servir de forts d’arrêt, devant retenir l’ennemi le plus longtemps possible afin de permettre à l’armée Belge et ses alliés de prendre position le long de l’Escaut.
Le 16 mai 1940 à 12h30 le fort de Boncelles3, faiblement armé, tout comme celui d’Embourg, fut le deuxième des douze forts protégeant Liège à être pris de force. Le fort, puissamment armé en 1914 (2 coupoles de 12 cm, 1 coupole de 15, 2 coupoles de 21 et 4 petites coupoles de 5.7), ne disposait plus en 1940 que de l’armement ridicule que composaient les 4 coupoles de 75 mm. Le Commandant Numa Charlier3, l’ayant vaillamment défendu et n’ayant pas hissé le drapeau blanc de la reddition, fut tué par une onde de choc pendant le dernier combat et sa phrase restée célèbre « Me rendre ? Jamais ! » est inscrite sur le monument aux morts érigé sur le fort de Boncelles face à la rue qui porte son nom.
Les yeux et les oreilles du fort
Le fort, pour mener à bien sa mission, disposait d’un réseau de postes d’observations (P.O.), répartis en secteurs inter-forts. Un secteur se nomme par les deux premières lettres des forts qui le délimite (B.E. pour Boncelles-Embourg). Les postes d’observations de Boncelles sont FB2, FB3 et BE5. Les fortins FB3 et BE5 sont inclus dans le chemin du souvenir.
L’après-guerre
Le fort de Boncelles n’a jamais été restauré ni ouvert au public. L’armée, restée propriétaire du site, le transforma en dépôt. Longtemps laissé à l’abandon, son entrée est barrée par une porte métallique derrière laquelle fut érigé un mur condamnant ainsi l’accès. Ces fossés furent comblés dans les années 1980. Le site fut alors vendu afin d’y construire un lotissement sur son périmètre. Le centre du domaine a été, néanmoins, épargné.
Actuellement seules la tour, dont le rôle principal était de capter l’air frais afin de ventiler les locaux du fort, et la porte d’entrée principale sont encore visibles. En 2001 la tour devint le symbole d’un centre didactique4 ce qui lui évita d’être démolie.
Patrimoine
La Tour d’Air5 est un centre d’interprétation touristique situé en bordure du fort de Boncelles. Il fut créé en 2001 par Sergei Alexandroff, un passionné d’histoire. L’ouverture s’est faite le 11 novembre 20136.
Il rend hommage aux soldats tombés au combat pendant les guerres de 1914-18 et 1939-45 avec notamment une esplanade de blindés. Un parcours didactique ainsi qu’une multitude de pièces d’époque font de ce musée un centre intéressant, dynamique et ludique en province de Liège.
Ce projet a permis à Sergei Alexandroff de sauver non seulement la tour d’air du fort mais aussi la poterne avec les deux corps de garde.
L’esplanade des blindés
Le 12 août 20107, deux premiers blindés, un char Guépard7 et un char Léopard, ont fait leur entrée sur l’esplanade qui est un parc d’exposition de divers chars.
Ils ont été rejoints le 6 octobre 2010 par un Char M47 Patton, un JPK et un BDX8 de la gendarmerie.
Un M4 Sherman représente un monument officiel de la libération de Boncelles. Récemment, une cloche de guet est arrivée sur le site de l’esplanade.

Fort de Chaudfontaine
Le Fort de Chaudfontaine est l’un des douze forts établis pour la défense de Liège, en Belgique, à la fin du xixe siècle à l’initiative du général belge Henri Alexis Brialmont.
Histoire
Érigé de 1888 à 1892, comme une infrastructure moderne en béton, équipée des armes les plus modernes pour l’époque, le fort de Chaudfontaine est l’un des six petits forts de la ceinture de Liège. Dominant la vallée de la Vesdre sur la rive droite à une altitude de 220 m, il se trouve, avec celui d’Embourg, au sud du fort de Fléron et à l’est de celui de Boncelles.
Lors de la Première Guerre mondiale, après deux jours de résistance, le fort cède le 13 août 1914 à la suite de l’explosion d’un obus allemand dans la voûte du magasin à munitions. La rue conduisant au fort sera rebaptisée « rue du XIII Août » et un cimetière militaire y sera implanté, ainsi qu’un monument en hommage aux 50 des 71 victimes enterrées dans la nécropole et qui ont péri dans l’incendie du fort (explosion).
En 1933, le fort est rénové, réarmé et consolidé. Une épaisse couche de béton armé, destiné à résister aux engins les plus lourds, renforce les voûtes. À la Seconde Guerre mondiale, le fort résiste quelques jours, mais pilonné par la Luftwaffe dès le matin du 17 mai 1940, il est abandonné en fin de journée après l’explosion d’une grenade allemande à l’intérieur, puis d’un obus à l’entrée.
Une société de Tir dénommée « La Trairie » y est installée depuis 1983 dans les casemates défendant les fossés. Depuis les années 1990, le fort de Chaudfontaine, rebaptisé « Fort Adventure », est occupé et aménagé par une société qui y organise des parcours d’aventure, à l’intention des adultes, comme des enfants1.

Fort de Flémalle
Le fort de Flémalle est un des 12 forts composant la position fortifiée de Liège à la fin du xixe siècle en Belgique. Il fut construit entre 1888 et 1892 selon les plans du général Brialmont. Contrairement aux forts français construits durant la même période par Raymond Séré de Rivières, il fut entièrement construit avec du béton non renforcé, nouveau matériau pour l’époque, plutôt qu’en maçonnerie. Le fort fut lourdement bombardé lors de la Première Guerre mondiale durant la bataille de Liège ainsi qu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été préservé et est devenu un musée.
Description
Le fort est situé à environ 9 kilomètres au sud-ouest du centre de Liège, dominant la vallée de la Meuse, dont il barrait le passage, en amont de Liège.
Le fort est quadrangulaire et non triangulaire, contrastant avec la majorité des forts construits par Brialmont. Un fossé de 5 mètres de profondeur et de 12 mètres de large entoure le fort. L’armement principal est concentré dans le massif central. Les fossés étaient défendus en enfilade par des fusils à tir rapide de 57 mm disposés dans les coffres de contrescarpe1. Le fort est un des plus larges forts liégeois2. Mis à part le fort de Loncin, les forts belges possédaient peu de provisions pour subvenir à l’intendance quotidienne d’une garnison en temps de guerre. De plus les latrines, douches, cuisine, morgue se trouvaient dans la contrescarpe, une position intenable au combat. Cela aura d’importantes conséquences sur la capacité des forts à soutenir un assaut prolongé. La zone de service était placée directement en face des baraquements, qui s’ouvraient sur le fossé à l’arrière du fort (en direction de Liège), avec une protection moindre que les 2 fossés latéraux1. L’arrière des forts Brialmont était plus légèrement défendu pour faciliter une recapture par les forces armées belges. On trouvait aussi sur ce côté les baraquements et les communs, le fossé arrière permettant l’éclairage naturel et la ventilation. Au combat, les tirs d’artillerie rendaient le fossé intenable et les Allemands ayant pu passer entre les forts pouvaient les attaquer par l’arrière3.
En 1940, les canons sont remplacés par des fusils mitrailleurs. L’armement du fort se composait, en 1914, de 2 coupoles de 120 mm, deux coupoles de 210 mm, une coupole de 150 mm et d’un phare éclipsable. Les 4 saillants disposaient aussi chacun d’une coupole de 57 mm à tir rapide, ces coupoles étaient les seules éclipsables avec celle du phare. En 1940, l’armement ne se compose plus que d’une coupole de 105 mm, d’une de 150 mm et d’une coupole Mi-Lg (mitrailleuses lance-grenades). La coupole phare quant à elle est remplacée par une cloche spéciale développée par la F.R.C. (Fonderie Royale des Canons).
Armement
À l’origine, l’armement du fort de Flémalle incluait pour les cibles à distance deux tourelles Grüsonwerke avec un obusier Krupp de 21 cm, une tourelle Creusot avec 2 canons de 150 mm et deux tourelles Châtillon-Commentry comportant 2 canons Krupp 120 mm. Pour la défense rapprochée, il possédait 4 tourelles Grüsonwerke éclipsables avec un canon de 57 mm. Il y avait aussi sur le fort une tourelle d’observation équipée d’un projecteur. 11 canons de 57 mm à tir rapide équipaient les casemates protégeant les fossés et la poterne2
L’artillerie lourde du fort était composée de canons allemands de marque Krupp alors que les tourelles provenaient de diverses origines. La communication entre les forts voisins de Loncin et de Liers pouvait se faire au moyen de signaux lumineux. Les canons utilisaient de la poudre noire ce qui produisait des gaz asphyxiants se propageant dans les espaces confinés du fort4.
Première Guerre mondiale
Liège fut attaquée le 6 août 1914. Les forts de Liège opposant une résistance inattendue aux Allemands, ceux-ci amenèrent une artillerie lourde de siège avec une puissance de feu supérieure à ce que à quoi les forts pouvaient résister. Flémalle fut l’un des derniers forts à subir le bombardement. Peu après l’explosion du fort de Loncin, les Allemands envoyèrent des émissaires aux deux derniers forts encore tenus par les Belges, Flémalle et Hollogne, soulignant les conséquences d’une résistance continue. La garnison se rendit le 16 août à 7 h 10, 10 minutes avant celle d’Hollogne5.
Transformation par les Allemands
Lorsque les Allemands prennent les forts, ils se rendent compte d’un certain nombre de défauts. Ils y remédieront pendant leur occupation afin de pouvoir se servir des forts comme appui d’infanterie :
- La ventilation : la ventilation en 1914 était quasi inexistante. Les Allemands vont créer 2 prises d’air sur les glacis, reliés par une galerie souterraine au fort. Là, un ventilateur distribuait l’air dans un saillant du fort.
- La force électromotrice : fort défectueuse pendant les combats d’août 1914, les Allemands vont remplacer cette installation par un moteur à huile lourde entraînant un alternateur pour produire de l’électricité.
- Le débouché d’infanterie : protégé par de simples grilles et un mur frontal en 1914, les Allemands vont construire un bunker avec sorties chicanées offrant une bien meilleure protection. Des portes fractionnables en 2 éléments ferment ce bunker et d’autres baies du fort.
Entre-deux-guerres
Pendant l’entre-deux-guerres, l’armée belge décide de réarmer les vieux forts de la Meuse. Le principe de réarmement est semblable dans tous les forts. Il se résume en quelques grandes étapes:
- Réduction des espaces par la construction d’un nouveau local plus petit dans l’ancien local (coulé en béton armé).
- Placement d’un plafond en tôles ondulées galvanisées (renforcement JOWA), destiné à servir de coffrage perdu, éviter les infiltrations d’eau et les chutes de gravats.
- Comblement des espaces vides par les terres provenant du creusement des étages inférieurs.
Au-delà du renforcement du fort existant, des réseaux inférieurs sont créés pour mettre hommes et munitions à l’abri:
L’étage -1 : appelé quadrilatère ou galerie axiale, il dessert les coupoles via des puits de monte-charge doublés d’échelles pour les hommes.
L’étage -2 : appelé galeries G.P. (grandes profondeurs), il sert de liaison entre la tour d’air et le local du ventilateur. Sur cette galerie sont greffés une galerie pour munitions, des locaux pour les fusées et un bureau de tir secondaire, accessible depuis le bureau de tir central via une série d’échelles.
Position fortifiée de Liège
En 1914, la position fortifiée entourant la ville de Liège comptait 12 forts Brialmont. Celui-ci fera partie de la position fortifiée de Liège II dont le but était de ralentir une éventuelle invasion allemande à partir de la frontière toute proche6. En 1940, 4 nouveaux forts ont été construits en avant de la ceinture des vieux forts. Les forts de la rive droite de la Meuse furent réarmés dans les années trente, ainsi que les deux forts les plus proches de la Meuse, Pontisse et Flémalle. De plus, une multitude d’abris sont créés pour être occupés par l’armée de campagne.
À Flémalle, les améliorations apportées furent le remplacement des tourelles d’origines par 4 tourelles d’un canon de 75 mm, 1 tourelle à 2 canons de 105 mm, 1 tourelle à 1 canon de 150 mm, 1 tourelle avec 1 mitrailleuse Maxim et 2 lance-grenades, et l’installation d’une batterie anti-aérienne. La ventilation, les sanitaires, la communication et l’installation électrique furent également améliorés. Les canons de 57 mm furent remplacés par des mitrailleuses2.
Seconde Guerre mondiale
En 1940, la garnison du fort comprenait 300 hommes environ, commandés par 6 officiers. Le commandant du fort est alors le capitaine-commandant Barbieux2. À la suite de la prise du fort d’Eben-Emael situé à l’est par les Allemands, Flémalle fournira un feu de soutien aux unités belges de campagne et aux forts voisins dans les jours suivants. Le 15 mai, le fort subit un bombardement aérien qui détruit ses tourelles. Le jour suivant, l’infanterie allemande prend d’assaut le fort qui se rend, incapable d’assurer une quelconque résistance7. La garnison reçut les honneurs militaires avant d’être envoyée prisonnière en Allemagne à Königsberg.
Actuellement
Le fort fut partiellement dépouillé de ses équipements durant l’occupation allemande et par un ferrailleur durant les années soixante2. Le fort est maintenu en état de préservation par une association qui a créé un musée dans le fort en 19927,
Photos

Fort de Hollogne
Le fort de Hollogne est un des 12 forts composant la position fortifiée de Liège à la fin du xixe siècle en Belgique. Il fut construit entre 1888 et 1892 selon les plans du général Brialmont. Contrairement aux forts français construits durant la même période par Raymond Séré de Rivières, il fut entièrement construit avec du béton non renforcé, nouveau matériau pour l’époque, plutôt qu’en maçonnerie. Le fort fut lourdement bombardé lors de la Première Guerre mondiale durant la bataille de Liège. Contrairement aux autres forts liégeois, il n’a jamais été modernisé durant l’entre-deux-guerres. Il a été préservé et est devenu un musée.
Description
Le fort est situé à environ 8 kilomètres à l’ouest du centre de Liège juste à côté de l’actuel aéroport de Bierset.
Le fort forme un triangle isocèle dont la base est longue de 200 m et les côtés de 225 m, Un fossé de 6 mètres de profondeur et de 8 mètres de large entoure le fort. L’armement principal est concentré dans le massif central. Les fossés étaient défendues en enfilade par des canons de 57 mm disposés dans des casemates dans le mur de contrescarpe1
C’est un des plus petits forts de la position fortifiée2
Mis à part le fort de Loncin, les forts belges possédaient peu de provisions pour subvenir à l’intendance quotidienne d’une garnison en temps de guerre. De plus les latrines, douches, cuisine, morgue se trouvaient dans la contrescarpe, une position intenable au combat. Cela aura d’importantes conséquences sur la capacité des forts à soutenir un assaut se prolongeant. La zone de service était placée directement en face des baraquements, qui s’ouvraient sur le fossé à l’arrière du fort (en direction de Liège), avec une protection moindre que les deux fossés latéraux1. L’arrière des forts Brialmont était plus légèrement défendu pour faciliter une recapture par les forces armées belges. On trouvait aussi sur ce côté les baraquements et les communs, le fossé arrière permettant l’éclairage naturel et la ventilation. Au combat, les tirs d’artillerie rendaient le fossé intenable et les Allemands ayant pu passer entre les forts pouvaient les attaquer par l’arrière3.
Armement
L’armement du fort de Hollogne incluait pour les cibles à distance une tourelle Grüsonwerke avec un obusier Krupp de 21 cm, une tourelle Creusot avec 2 canons de 15 cm et deux tourelles Châtillon-Commentry comportant 1 canon Krupp 12 mm. Pour la défense rapprochée, il possédait 3 tourelles Grüsonwerke éclipsables avec un canon de 57 mm. Il y avait aussi sur le fort une tourelle d’observation équipée d’un projecteur. 7 canons de 57 mm à tir rapide équipaient les casemates protégeant les fossés et la poterne2,4.
L’artillerie lourde du fort était composée de canons allemands de marque Krupp alors que les tourelles provenaient de diverses origines. La communication entre les forts voisins de Loncin et de Liers pouvait se faire au moyen de signaux lumineux. Les canons utilisaient de la poudre noire ce qui produisait des gaz asphyxiants se propageant dans les espaces confinés du fort5.
Le fort était tenu par une garnison de 230 artilleurs et 120 fantassins et commandée par le capitaine-commandant Cuisinier4,
Première Guerre mondiale
Liège fut attaquée le 6 août 1914. Les forts de Liège opposant une résistance inattendue aux Allemands, ceux-ci amenèrent une artillerie lourde de siège avec une puissance de feu supérieure à ce que à quoi les forts pouvaient résister. Le fort de Hollogne fut lourdement bombardé le 13 août. Peu après l’explosion du fort de Loncin, le 15 août vers 17h20, les Allemands envoyèrent des émissaires aux deux derniers forts encore tenu par les Belges, Flémalle et Hollogne, soulignant les conséquences d’une résistance continue. Le plan initial était de fuir le fort après l’avoir saboté, mais se rendant compte qu’elle était encerclée, la garnison se rendit le 16 août à 7h30, 10 minutes après celle de Flémalle4,6,
Seconde Guerre mondiale
Le fort de Hollogne ne fut pas modernisé dans les années trente et resta comme construit par Brialmont additionné des quelques modifications apportées par l’occupant allemand entre 1914 et 1917. Après 1918, l’armée belge utilisa le fort comme dépôt de munitions7, En mai 1940, le fort fut bombardé par des Stukas qui l’avaient confondu avec le fort de Flémalle. Durant l’occupation, il exista un projet de transformer le fort en base de lancement de V2. Après la libération en 1944, les Américains l’aménagèrent en hôpital. Peu après la fin de la guerre, il redevint tout d’abord un dépôt pour l’armée belge avant de devenir un poste de commandement de la force aérienne belge jusqu’en 1991. Il reste encore propriété de la Défense nationale jusqu’en 1997, année durant laquelle il est transféré au ministère des Transports pour être intégré à l’aéroport de Liège2.
Actuellement
Le fort est maintenu en état de préservation par une association, le Comité de sauvegarde du patrimoine historique du fort de Hollogne2. Il est visitable à diverses occasions.

Le Fort de Huy est une forteresse, construite en 1818, accrochée au bord de la Meuse et qui domine la ville de Huy, dans la province de Liège en Belgique. ll se trouve à l’emplacement de l’ancien Tchestia, une des « quatre merveilles » de la ville de Huy.
Origines : le comté de Huy
C’est dans un acte de vente de 890 qu’apparaît la première mention incontestée d’un château qui, en 943, est reconnu comme le centre d’un vaste comté. L’existence de ce comté de Huy est assez brève puisque, en 985, l’impératrice Théophano, au nom de son fils, le jeune Otton III, fait donation à Notger du comté de Huy, que venait de lui céder le comte Ansfrid. À partir de ce moment, l’histoire de Huy se fond dans celle de la principauté de Liège, dont elle devient une des bonnes villes.
Le siège de 1595
le 7 février 1595, les Hollandais assiégèrent par surprise, la ville et le château de Huy, en violation de la neutralité liégeoise. Le Prince-évêque parvint à libérer la ville avec l’aide des Espagnols – en échange d’un pouvoir de désignation du commandant de la place de Huy et d’un droit de passage des troupes au besoin1.
XIXe siècle
Conscient de l’importance stratégique d’une situation qui verrouillait la vallée de la Meuse, l’État hollandais décide, en 1815, d’y ériger une forteresse. La première pierre de la future citadelle est déposée par le lieutenant-colonel H. Camerlingh le 6 avril 1818. La construction, sur base des plans de Camerlingh et son contrôle par le capitaine ingénieur A. J. Anemaet, dure cinq ans2.
La forteresse construite par les Hollandais ne servit jamais. Elle fut une prison politique, en 1848, pour les républicains du « Risquons-tout ». En 1876, la citadelle est cédée à la ville de Huy, puis rachetée par l’État en 1880 qui la réintègre dans le système défensif de la Meuse en 19143. Le fort devient alors un camp de discipline interne pour les Allemands. Après la Première Guerre mondiale, le fort est utilisé pour héberger des prisonniers russes puis une école régimentaire pour le quatorzième de Ligne. À partir de 1932, le fort est utilisé pour des activités touristiques afin de visualiser le panorama de la ville.
Seconde Guerre mondiale
En 1939, des soldats allemands sont internés après avoir franchi la frontière belge. Le 10 mai 1940, ces soldats passent du régime d’internés à celui de prisonniers de guerre3. Le fort est attaqué par les Allemands peu de temps après afin de libérer les prisonniers. Cependant, ces derniers ont déjà été transférés ailleurs. Dès lors, le fort est utilisé par les Allemands comme centre d’internement pour des prisonniers politiques et des otages principalement. Il est sous l’administration de la Wehrmacht et dirigé par le commandant Frimberger4. Plus de 6 500 patriotes dont Guillaume Vermeylen y sont internés. Les motifs des arrestations sont variables : résistance, banditisme, marché noir, réfractaires au travail obligatoire, otages, communistes, grève4… On retrouve également différentes nationalités chez les internés. À partir de juillet 1940, des prisonniers anglais, des grévistes français, des russes sont internés à Huy. Environ la moitié des internés sont des otages. Ils encourent le risque d’être exécutés. Mais finalement, aucun d’entre-eux n’est exécuté sur place mais emmenés ailleurs avant leur assassinat. À partir du 22 septembre 1941, le fort de Huy est également utilisé comme camp de transit avant la déportation vers des camps de concentration, principalement Vught et Neuengamme5. À la Libération, le fort est transformé en centre d’internement pour inciviques.
Un Musée de la Résistance et des Camps de Concentration y est installé depuis 1992.
XXe siècle
De 1957 à 2012, un téléphérique permettait le survol de la ville avec un passage au-dessus du fort. Un des câbles du téléphérique est sectionné par un hélicoptère Robinson 22 le 6 avril 20126,7. Il n’a pas été réparé.
XXIe siècle
Une demande de reconnaissance du fort comme patrimoine matériel de l’humanité8 introduite en 2007 a été rejetée.

Fort de Lantin
Le Fort de Lantin est l’un des douze forts établis pour la défense de Liège, en Belgique à la fin du xixe siècle à l’initiative du général belge Henri Alexis Brialmont. Contrairement aux ouvrages français de l’époque (voir Séré de Rivières), le fort a été construit presque exclusivement en béton (non armé), matériau largement méconnu. Le fort fut lourdement bombardé par l’artillerie allemande lors de la bataille de Liège en août 1914. Il ne fut pas réarmé comme les autres forts liégeois et conserve donc ses caractéristiques d’origine. Il est devenu musée et peut donc être visité.
Description
Le fort de Lantin est situé à 7 km au nord-ouest du centre de Liège.
Le fort a la forme d’un triangle isocèle dont la base mesure 200 m de long et les côtés 225 m. Un fossé profond de 6 m et large de 8 m entoure le fort. L’armement principal est concentré sur le massif central. Les fossés étaient défendus en enfilade par des canons de 57 mm disposés dans des casemates dans le mur de contrescarpe1 C’est un des plus petits forts de la position foritfiée de Liège2.
Exception faite du fort de Loncin, les forts belges possédaient peu de provisions pour subvenir à l’intendance quotidienne d’une garnison en temps de guerre. De plus, les latrines, douches, cuisine, morgue se trouvaient dans la contrescarpe, une position intenable au combat. Cela aura d’importantes conséquences sur la capacité des forts à soutenir un assaut se prolongeant. La zone de service était placée directement en face des baraquements, qui s’ouvraient sur le fossé à l’arrière du fort (en direction de Liège) avec une protection moindre que les 2 fossés latéraux1. L’arrière des forts Brialmont était plus légèrement défendu pour faciliter une recapture par les forces armées belges. On trouvait aussi sur ce côté les baraquements et les communs, le fossé arrière permettant l’éclairage naturel et la ventilation. Au combat, les tirs d’artillerie rendaient le fossé intenable et les allemands ayant pu passer entre les forts purent les attaquer par l’arrière3.
Armement
L’armement du fort de Lantin incluait une tourelle avec 2 canons de 15 cm et une tourelle comportant 1 obusier de 21 cm, 2 tourelles avec un canon de 12 cm et 3 tourelles avec un canon de 5,7 cm. Il y avait aussi sur le fort une tourelle d’observation équipée d’un projecteur. 6 canons de 5,7 cm à tir rapide équipaient les casemates protégeant les fossés et la poterne2
La communication entre les forts voisins de Loncin et de Liers pouvait se faire au moyen de signaux lumineux. Les canons utilisaient de la poudre noire ce qui produisait des gaz asphyxiants se propageant dans les espaces confinés du fort4
Première Guerre mondiale[
En 1914, le fort de Lantin fut un des derniers forts de Liège à subir les bombardements allemands (à partir du 10 août). Lors de la bataille de Liège, la garnison du fort, au bord de l’asphyxie, se rendit le 15 août 1914, vers 12 h, peu avant la destruction du fort de Loncin où se trouvait le général Leman qui commandait la place5.
Après guerre
Après la Première Guerre mondiale, le fort n’a subi aucune modification, ce qui en fait un exemplaire unique, parfaitement conservé, de l’archéologie militaire du xixe siècle.
Après la Seconde Guerre mondiale, le fort a été utilisé comme terrain de manœuvres et stand de tir.
Il a été acquis par l’Asbl Les Amis du Fort de Lantin en 1983 alors qu’il était laissé à l’état d’abandon par la Défense Nationale belge. L’association a entièrement restauré le fort et, depuis 2005, un parcours-spectacle a été mis en place avec un système d’audio-guidage quadrilingue. Parmi les travaux importants, il y a eu la restauration du massif central avec la pose de fausses coupoles et de la coupole-phare et la mise en place du système de rotation de la coupole de 120 droite et de l’accumulateur hydraulique de la coupole-phare (pièce unique actuellement fonctionnelle).

Fort de Loncin
Le fort de Loncin est l’un des douze forts établis pour la défense de Liège, en Belgique. Il fut construit entre 1888 et 1891 d’après les plans du général Henri Alexis Brialmont. Contrairement aux ouvrages français de l’époque (voir Séré de Rivières), le fort a été construit presque exclusivement en béton (non armé), matériau largement méconnu.
Il fut détruit au début de la Première Guerre mondiale par un tir d’obus engendrant une puissante explosion. La grande majorité des défenseurs ayant été enfoui sous les décombres, le fort est rapidement devenu une nécropole militaire. À la faveur royale, il fut même élevé au rang de nécropole nationale, le 3 août 2014 par le roi Philippe1.
Architecture et situation
Le fort a la forme d’un triangle isocèle dont la base fait 300 mètres environ (les côtés font 235 m de long). Un fossé sec de 6 mètres de profondeur et de 8 mètres de largeur entoure le centre de l’ouvrage, appelé massif central, où est concentré l’armement principal et le phare longue portée, intégralement protégés par des coupoles cuirassées (10 coupoles au total). Les fossés, tout comme l’entrée principale, étaient battus en enfilade par des petits canons de 57 mm placés sous casemates (aussi appelés « coffres »). Le coffre de tête, à la pointe du triangle, comporte deux niveaux ; cela permettait de poursuivre la défense en cas d’obstruction des embrasures du premier niveau. Chaque coffre était équipé d’une embrasure supplémentaire pour accueillir un projecteur. En cas d’assaut ennemi, il restait la possibilité à la garnison du fort d’effectuer des sorties d’infanterie sur le terre-plein entourant le massif central. Le débouché d’infanterie de Loncin a cependant été détruit lors de l’explosion du fort (une des grilles qui en fermaient l’accès a été retrouvée en 2006).
Le fort est situé à environ 7 kilomètres à l’ouest du centre-ville de Liège, en direction de Bruxelles et Tongres. La garnison, qui comprenait un détachement d’infanterie, se composait de 500 hommes environ.
Il est curieux d’observer que la plupart des locaux essentiels à la vie des hommes (latrines, douches, cuisine, boulangerie, morgue) étaient placés dans la contrescarpe du fossé de gorge, alors que le massif central (comprenant l’armement principal du fort) était situé à l’escarpe. Et pour des raisons budgétaires, on ne creusa pas de tunnel afin de relier les deux parties du fossé, si bien que la contrescarpe devenait inaccessible dès les premiers bombardements.
Armement du fort
- deux coupoles à un obusier de 21 cm
- une coupole à deux canons de 15 cm
- deux coupoles à deux canons de 12 cm
- quatre coupoles à un canon de 5,7 cm
- une coupole d’observation pour le phare électrique longue portée
- neuf canons à tir rapide de 5,7 cm sous casemates pour la défense des fossés et de la poterne
Les grosses pièces sortaient toutes des usines allemandes Krupp Ag d’Essen, tandis que les cuirassements avaient été réalisés par des usines belges (forges de Cockerill), françaises (Ateliers du Creusot) et allemandes (Usine Gruson). Le phare électrique, équipé de clapets, pouvait servir à communiquer en morse avec les forts voisins de Lantin et de Hollogne.
La Première Guerre mondiale
En 1914, le fort de Loncin fut parmi les derniers forts de Liège à subir les bombardements allemands. Le gouverneur de la place de Liège, le général Leman, en avait fait son quartier général dès le 6 août. Loncin fut bombardé massivement à revers, depuis le centre-ville, pendant trois jours, du 12 au 15 août. Le 15 août 1914, un des deux magasins à poudre du fort, qui contenait encore 12 tonnes de poudre, explosa. Cette explosion détruisit le cœur du fort, tuant 350 de ses 550 soldats de garnison. La plupart des corps reposent encore sous les décombres du fort, devenu un lieu de mémoire doublé d’un musée. C’est le seul fort de la position fortifiée de Liège qui ne se soit pas rendu. Le général Leman échappa miraculeusement à la mort (il fut retrouvé inconscient dans le fossé de gorge et fait prisonnier par les Allemands).
La destruction du fort de Loncin fut immédiatement exploitée par la propagande allemande, précipitant la reddition des deux derniers forts de la position fortifiée de Liège, (Flémalle et Hollogne). La propagande fit beaucoup pour mettre en place le mythe des Grosses Bertha (énormes mortiers de calibre de 42 cm) qui tirèrent sur le fort de Loncin. La Grosse Bertha, l’arme secrète ultime de l’armée allemande en 1914, est rapidement devenue le canon le plus célèbre de l’histoire.
Les conséquences pour l’assurance allemande
La puissance des Grosses Bertha, et leurs terribles ravages, furent pour beaucoup dans la croyance des Allemands en leur capacité de fabriquer des armes miracles, supérieures à celles de leurs adversaires. Le calibre et le nom de celles-ci sont d’ailleurs pratiquement devenu synonymes. Cette foi en la technique perdurera pendant les deux guerres mondiales, jusqu’à et y compris avec l’avènement des V2.[réf. nécessaire]
Les enseignements de la destruction pour les Belges
La raison principale de la destruction du fort de Loncin fut le fait que les chambres de munitions avaient été placées trop près de la surface. Des maladresses dans les constructions en béton ont par ailleurs été commises, le matériau étant encore mal maîtrisé. Il fut remédié à ces deux failles lors du réarmement de certains forts (Loncin n’en faisait pas partie) et de la construction de quatre nouveaux forts, dont le plus grand jamais construit au moment de sa construction, le Fort d’Ében-Émael placé à la frontière entre la Belgique et le Hollande, face au canal Albert.
Le monument commémoratif
Après la guerre, la fin tragique du fort suscita des sentiments d’admiration et de reconnaissance envers les défenseurs du fort. Une souscription publique permit l’érection d’un monument que le roi Albert Ier vint inaugurer le 15 août 1923.
Ce monument est dû au ciseau du sculpteur liégeois Georges Petit. Les personnages au sommet d’une tour de 18 m de hauteur sont en bronze (3 m) et sont un légionnaire romain et un hoplite grec qui représentent l’hommage des guerriers antiques aux défenseurs de Loncin. Ceux de la base représentent une femme aux bras étendus avec, à ses pieds, un soldat mort au glaive brisé. Ils symbolisent Liège se dressant contre les envahisseurs. Sur la face arrière, on peut voir le commandant Victor Naessens en médaillon.
On peut lire la mention suivante : « Passant… va dire à la Belgique et à la France qu’ici 550 Belges se sont sacrifiés pour la défense de la liberté et le salut du monde. » Il s’agit des paroles du général français Malleterre.
Le Fort de Loncin de nos jours
Le Fort de Loncin est depuis le 15 août 1914 une nécropole et un lieu de mémoire. Sur les 500 hommes qui formaient la garnison, la plupart reposent encore aujourd’hui sous les décombres. Les corps qui ont pu être dégagés ont été inhumés dans une crypte installée dans le coffre de tête.
En octobre 2007, lors d’une vaste campagne de déminage du fort, 3 500 obus, représentant 142 tonnes de munitions, ont été remontés à la surface.
« Ce n’était absolument pas le but, mais lors de cette opération de déminage, on a retrouvé les dépouilles de 25 soldats », a expliqué Fernand Moxhet, président de l’ASBL gestionnaire du fort. « Mais aussi des pièces de monnaie en très bon état, des restes d’uniforme, et même une gourde contenant encore du lait qui n’avait même pas caillé ! », a ajouté M. Moxhet.
Quatre des dépouilles ont pu être identifiées, grâce à une alliance, une chevalière, un numéro de matricule et un pistolet. Il s’agit des soldats De Bruycker, Armand Désamoré, Louis Noé et René Halain. Tous les quatre, ainsi que leurs 21 frères d’armes anonymes, ont été inhumés, lors d’une commémoration exceptionnelle de l’explosion du fort, le 15 août 2008 dans la crypte du fort, où reposent déjà, depuis 1921, 43 soldats.
« C’est un événement exceptionnel pour l’armée qui a donc suscité une commémoration exceptionnelle », souligne le commandant militaire de la province de Liège, le colonel BEM Thierry Babette.
L’évêque de Liège, Aloys Jousten, a célébré une messe en présence de détachements du 1er régiment d’artillerie et du 12e de ligne, représentant les unités des soldats morts dans le fort.
À l’issue de celle-ci, un cortège s’est rendu sur le lieu de l’explosion pour la cérémonie d’hommage et les salves d’honneur. Les quatre soldats identifiés seront également décorés à titre posthume de la médaille de la victoire, de l’Ordre de Léopold, de la médaille de la guerre 1914-1918 et de la Croix de guerre 1914-1918.
Depuis fin 2007, le site du fort de Loncin est équipé d’un nouveau système élaboré d’audio-guidage automatique. Le coût des nouveaux aménagements s’est élevé à près de 1 800 000 euros (subsides octroyés par le FEDER (Fonds européen de développement régional), la Région wallonne et la commune d’Ans). Le site est certainement l’un des plus intéressants témoignages de fortification de la fin du xixe siècle en Belgique, étant donné qu’il est le seul du genre (sur les 21 forts construits pour la défense de la vallée de la Meuse) à posséder encore tous ses équipements d’origine (coupoles cuirassées, canons, etc.).
Une rue a été nommée en l’honneur de l’officier qui commandait le fort, le commandant Naessens.

Le Foyer Culturel d’Awans et le Conseil Culturel sont des équipes dynamiques qui proposent des activités pour tous les publics tout au long de l’année : spectacles, conférences, ateliers, activités pour enfants,…

Le Foyer culturel de Jupille-Wandre, c’est avant tout une équipe de professionnels au service du public, des associations et des artistes. Il propose et prend en charge des activités d’éducation permanente et de formation, des actions citoyennes, des spectacles divers pour petits et grands, des ateliers, des accueils en résidence, des actions de diffusion, de promotion, de communication, … Avec comme objectif majeur : La Culture par tous et pour tous !
Le Foyer culturel de Jupille-Wandre vous informe de ses activités par le biais de son trimestriel le « Jupi Canard » et de son web magasine le « Jupi Mag ». N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet ou à rejoindre notre page Facebook « Foyer Culturel Jupille Wandre » pour vous tenir au courant des prochains événements à ne pas rater !
Aujourd’hui, le Foyer culturel de Jupille-Wandre compte plus de cent associations membres avec lesquelles il collabore étroitement. Le Foyer dispose de plusieurs locaux tels que la salle de spectacle « Prévers », la salle d’exposition « Espace Culture », l’ancienne école des Acacias, deux locaux à Wandre ainsi que les bureaux administratifs. Certains sont mis à disposition des associations lors d’ateliers, expositions, manifestations, … .
Pour la petite histoire, le Foyer culturel de Jupille-Wandre a vu le jour en 1975 et est reconnu et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Liège et la Ville de Liège.


Christine Colon qui, dans sa galerie éponyme, ravit depuis de nombreuses années les amateurs d’art. De cette rue Saint-Rémy, située en plein cœur du Liège médiéval, Christine Colon a fait de sa galerie un lieu incontournable de l’art contemporain.
Présentation
Bienvenue à la Galerie Evasion, une adresse incontournable située dans la charmante ville de Waremme en Belgique. Ce lieu atypique est spécialisé dans les services d’animations et propose une large gamme de spectacles pour tous les goûts.
Grâce à une équipe de professionnels passionnés, la Galerie Evasion vous offre un divertissement de qualité et original. Vous pourrez y découvrir des artistes locaux et internationaux, des spectacles de musique, de danse, de théâtre et bien plus encore. Chaque événement est soigneusement sélectionné pour vous faire voyager dans un univers unique et enchanteur.
La Galerie Evasion se distingue par son ambiance chaleureuse et conviviale. En plus de ses spectacles, l’établissement propose également des expositions artistiques ainsi que des événements spéciaux tels que des soirées à thème ou des vernissages. C’est l’endroit idéal pour passer un moment agréable en famille, entre amis ou même en solo.
Alors n’hésitez plus, venez découvrir la Galerie Evasion et laissez-vous emporter par sa programmation diversifiée et de qualité. Vous serez assurément séduit par cet établissement qui ne manquera pas de vous faire évader le temps d’une soirée inoubliable

Organisation d’expositions ayant pour but la promotion des Arts plastiques à Huy et dans la région.

Bienvenue sur la page Galerie Michel Huynen, nouvel espace dédié à l’art contemporain en région liégeoise, à Verviers.


Depuis 1986, année de sa création, la galerie TRIANGLE BLEU est installée à Stavelot, Belgique.

Galerie indépendante affiliée à YellowKorner. Véritables tirages d’art en édition limitée et numérotée à prix démocratiques, disponibles en 5 formats : forcément une oeuvre pour faire de votre intérieur un lieu unique

Get Out est un concept de jeu d’équipe basé sur la réflexion. Seule votre capacité de déduction vous permettra de sortir d’une pièce dans un temps donné


Organisation de balades dans la nature, de visites de villes en Belgique et, à l’étranger, de visites d’entreprises.

Découvrez les joies du gyropodes, également appelés segways, en vous promenant dans l’Ardenne belge verdoyante. Plaisir assuré!
Gyrogo
Gyrogo vous propose des balades organisées et des parcours en gyropodes dans le cadre verdoyant et bucolique des Bois et Etangs de la Julienne à Visé.
Le gyropode est un moyen de déplacement original, intuitif, ludique, écologique et accessible à un large public. Il s’adapte à presque tous les terrains et permet de se déplacer uniquement grâce aux mouvements du corps. Il vous fera appréhender votre environnement avec un autre regard.
Afin de découvrir ce véhicule innovant, nous vous proposons 2 formules-types:
- Une balade « initiation » de 1 heure (30€/personne) par groupes de 2 à 6 personnes accompagnés d’un moniteur.
- une balade « sensation » de 2 heures (50€/personne) par groupes de 2 à 6 personnes accompagnés d’un moniteur.
Toutes nos formules sont flexibles, n’hésitez pas à nous contacter pour une activité personnalisée selon vos souhaits.
Vous fêtez votre anniversaire? Signalez-le nous lors de la réservation et une petite attention vous sera offerte.
Nous vous attendons pour venir faire un test grandeur nature en famille ou entre amis.
Partez à la découverte de l’Ardenne belge et réservez une maison de vacances avec Ardennes-Etape.
Copyright photos: Gyrogo


Henotes Music Events spécialisé dans l’animation musicale pour mariage, annif. et bien plus encore


C’est un musée privé destiné a être vu par tous, afin que jamais on n’oublie les souffrances et les vies perdues pour notre liberté. Vous pourrez voir une cinquantaine de mannequins qui représentent l’occupation et la libération de la région « grand Verviers ». Sont visibles également nombreuses photos et documents. Le fondateur est en contact avec les vétérans du 314 TCG 50 sq (US Air force) qui ont complété généreusement le patrimoine déjà rassemblé. Une partie du musée leur est dédiée. Le musée abrite le CAM (centre archéologique) qui dernièrement a retrouvé le pilote d’un FW190 (H Hillebrant) abattu en 1944 et inhumé à Lommel en avril 2003. Les photos de la recherche sont visibles au musée. Les visites sont libres et c’est avec plaisir et passion que le conservateur vous racontera la petite histoire des divers objets présents.

IAI organise diverses activités de sensibilisation à l’environnement et/ou liées à l’interculturalité.
Elles sont inspirées du « Buen Vivir » / « Sumak Kawsay » (en quechua).

L’IKOB – Musée d’Art Contemporain (IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst) est une institution culturelle située à Eupen, dans la Province de Liège (Belgique). L’IKOB est fondé en 1993 par Francis Feidler sous le nom de « IKOB – International Art Centre East Belgium » et est rebaptisé sous le nom actuel en 2005. Depuis lors, l’IKOB est le seul musée d’art de la Communauté germanophone de Belgique.
La collection du musée est consacrée à l’art contemporain et comprend en 2021 plus de 400 œuvres d’art d’artistes belges, néerlandais, français, luxembourgeois et allemands, sur une superficie d’exposition de 800 m².
Histoire
Après la fermeture de l’abattoir d’Eupen au début des années 1990, les responsables politiques prévoient de transformer cet espace en centre culturel. Afin de mettre en œuvre ces plans, l’exécutif de la Communauté germanophone fonde le 16 février 1993 avec Francis Feidler le « IKOB – International Art Center East Belgium », une institution qui agit comme organisation faîtière pour la coordination et le repositionnement de la scène culturelle eupenoise dans le domaine de l’art contemporain1. Par manque de locaux fixes dans les premières années, les expositions et manifestations artistiques sont organisées dans des parcs publics ou dans des salles louées.
L’IKOB attire l’attention internationale par l’exposition de sculptures « Kontakt 93 » qui a lieu lors de l’ouverture en 1993 et qui comprend entre autres des œuvres de Guillaume Bijl, Jacques Charlier, Ann Veronica Janssens, Bernd Lohaus et Berlinde De Bruyckere2, ainsi que par l’exposition « Volle Scheunen » en 1997. Sous l’encouragement de l’organisateur de la Documenta, Manfred Schneckenburger, des artistes de renom tels que Tony Cragg, Ugo Dossi, Wolfgang Nestler, Maik et Dirk Löbbert ou Marie-Jo Lafontaine exposent leurs œuvres.
A partir de 1999, l’IKOB trouve un local permanent en face de l’ancien abattoir dans la rue Rotenberg et utilise ses propres fonds pour aménager un entrepôt en tant qu’espace d’exposition lumineux et spacieux. Ainsi, l’IKOB commence à se constituer une propre collection à partir de 2003, collection qui contient aujourd’hui plus de 400 œuvres d’artistes renommés de Belgique, des Pays-Bas, de France, du Luxembourg et d’Allemagne, dont, par exemple, Günther Förg, Joachim Bandau et Kati Heck. Cette collection est notamment présentée en 2008 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Museum of Young Art à Vienne et en 2009 au Museum van Bommel van Dam à Venlo sous le titre « The IKOB Collection – in progress »3. En 2010, l’IKOB agrandit ses salles, créant un espace pour la collection de l’IKOB en tant qu’exposition permanente ainsi que pour les expositions temporaires annuelles.
Début 2013, l’historienne de l’art et commissaire d’exposition française Maïté Vissault reprend la direction de l’IKOB de Francis Feidler. Après avoir été commissaire de sa dernière exposition à l’IKOB en 2015 avec Marcel Berlanger et Adrien Lucca, elle devient directrice de l’Institut supérieur pour l’étude du langage plastique (ISELP) à Bruxelles4.
L’historien de l’art allemand Frank-Thorsten Moll lui succède à partir de 20165,6. Il introduit notamment les « Entretiens d’artistes » et la série « Moll trifft » (Moll rencontre), dans laquelle des personnalités connues sont interviewées dans une atmosphère détendue, dont Gerhard Thiele (2016) ainsi que Herbert Ruland et Klaus Sames (2017). Il ouvre l’IKOB à des représentations de théâtre de chambre, comme par exemple en 2016 pour la pièce « Die Gerechten » (Les Justes) d’Albert Camus avec des acteurs de l’Euro Theater Central Bonn7. En outre, l’IKOB organise des performances musicales, notamment en coopération avec le OstbelgienFestival 2017, le concert Bilder einer Ausstellung dans un arrangement pour quintette à vent et piano, ainsi que le concert « Glorious Bodies » avec le compositeur, violoniste Paul Pankert en 2017 et le Meakusma-Festival en 2017 et 20198.
De nombreux ateliers, des dimanches en famille, des projections de films, entre autres dans le cadre du projet docfest on tour9, ainsi que des lectures et des conférences continuent d’avoir lieu à l’IKOB.
Expositions temporaires
L’IKOB propose, en plus de son exposition permanente, plusieurs expositions individuelles et collectives changeantes et thématiques chaque année. L’IKOB consacre notamment des expositions aux oeuvres de Horst Keining et Alice Smeets, Luc Tuymans, Anne-Mie van Kerckhoven, Roger Raveel et Jonathan Meese (tous en 2012). L’IKOB expose également des œuvres de Jan Fabre et Paul Schwer (2013) ainsi que d’Ulrike Rosenbach (2014), de Jürgen Claus (2016) et rend hommage posthume à Jan Hoet10. En février 2021, l’exposition « Assange Situation – Emergency » de l’artiste grec Miltos Manetas est à voir à l’IKOB11.
Sous la direction de Frank-Thorsten Moll, l’IKOB se consacre durant l’année 2017 au thème du « Ressentiment »12. L’année 2018 a été consacrée au thème « Pragmatisme et auto-organisation » (Pragmatismus und Selbstorganisation)13. En, le musée se concentré sur le thème « Féminisme » et entreprend un examen de sa propre collection sous l’angle de l’égalité des genres14,15.
Prix IKOB[
Depuis 2005, le prix international « IKOB Art Prize for Young Visual Artists », doté de 5000 €, est décerné tous les trois ans et, à partir de 2011, tous les quatre ans à de jeunes artistes jusqu’à l’âge de 45 ans. Parmi les lauréats figurent Stefanie Klingemann (2005), Ralph Cüpper (2008) et Kati Heck (2011). En 2015, deux catégories sont instituées, la catégorie « Euregio Meuse-Rhin » étant dotée de 3000 € et la catégorie « International » de 5000 €.
En 2019, le prix a été attribué comme « Prix IKOB pour l’art féministe »14. Il s’agit du premier prix mondial consacré à l’art féministe, un prix s’adressant aux artistes femmes et hommes. La lauréate du 1er prix est l’artiste vidéo anglaise Helen Anna Flanagan.

Infor Famille Éducation Permanente s’engage pour l’égalité et le progrès social à travers des activités d’éducation permanente accessibles à toutes et tous et des cours d’alphabétisation pour adultes non francophones.

Yeunten Ling
L’institut Yeunten Ling est un centre de bouddhisme tibétain situé à Huy à proximité de Liège, en Belgique. Yeunten Ling, qui signifie « jardin des qualités », est un centre de stages, de résidence et de retraite fondé en 1983 par Kalou Rinpoché1.

Interra est une asbl créatrice de liens entre les personnes récemment arrivées en terre liégeoise et la population locale, au travers d’ateliers permettant la mise en valeurs des compétences de chacun.e


Fondée en 1946, la Jeunesse Barchonnaise a pour vocation l’organisation d’évènement mais également l’apprentissage des vraies valeurs aux jeunes!

Le Comité a le plaisir de vous accueillir sur sa page où sont partagées nos nombreuses activités en lien avec le village de Magnée. Nous sommes heureux depouvoir interagir avec vous ! Votre avis compte, alors n’hésitez pas à nous écrire…




Un escape Game dans un vieux vaisseau spatial. Jusqu’à 7 joueurs. Observez, travaillez en équipe et résolvez les énigmes pour réussir votre mission


Un outil innovant pour et par les créatifs liégeois au 13 rue Roture à Liège. Deux salles de concerts, un snack, une salle d’expo, des bureaux, une salle de création et bien plus encore. Infos et programme : http://kulturaliege.be

L’AN VERT est une association qui a pour objectif de favoriser l’émulation et la création artistique… C’est un projet en cours de développement auquel nous vous invitons à contribuer en tant qu’acteur ou spectateur.
Spectacles, concerts, expositions, projections de films, danse, expériences en tous genres…
 Depuis le mois de mai 2002, L’AN VERT se développe en bord de Meuse dans le quartier d’Outremeuse. L’initiative de ce projet émane d’une poignée d’artistes, se proposant alors d’ouvrir et de mettre à disposition d’artistes plasticiens des espaces créatifs (ateliers temporaires à prix démocratique). Cette orientation a depuis fortement évolué, en s’ouvrant à d’autres idées et formes d’expression artistique. La pratique artistique n’étant pas réservée aux seuls plasticiens, l’idée d’ateliers s’est naturellement élargie à l’ensemble des créateurs : musiques, spectacles, auteurs, danseurs…
Depuis le mois de mai 2002, L’AN VERT se développe en bord de Meuse dans le quartier d’Outremeuse. L’initiative de ce projet émane d’une poignée d’artistes, se proposant alors d’ouvrir et de mettre à disposition d’artistes plasticiens des espaces créatifs (ateliers temporaires à prix démocratique). Cette orientation a depuis fortement évolué, en s’ouvrant à d’autres idées et formes d’expression artistique. La pratique artistique n’étant pas réservée aux seuls plasticiens, l’idée d’ateliers s’est naturellement élargie à l’ensemble des créateurs : musiques, spectacles, auteurs, danseurs…
Nous vous convions à goûter nos banquets de passions et à partager notre théâtre d’affinités…

Atelier de peinture & créations de Mélanie Maquinay ARTiviste.
Décoration d’intérieur. Wall Art.

L’Apéro des Français de Liège est un rendez-vous informel chaque 2m jeudi du mois



Espace de concerts de culture et de convivialité dans les murs d’une ancienne brasserie.
Une vraie scène avec sono et light shows, pour le confort de tous.
1 jeudi sur 2
Ouverture des portes 19h30 – Concert 20h30
Entrée de 5€ + chapeau






Centre d’Initiative pour une Transition Écologique, L’ASBL est une invitation à l’action collective! L’équipe propose ateliers, chantiers et formations sur 4 thématiques: l’habitat, l’énergie, l’alimentation et la biodiversité.

La Fabrik est un ensemble d’anciens bâtiments industriels transformés en « espaces events ».


Lieu conviviale valorisant des auteurs, des plasticiens et créateurs singuliers.

La Grand Poste, le Totem du district créatif de Liège
Food Market • Brewery • Cowork & More

#Bar #Café #Liège #Carré #Musique #Concert #Rock #Pop #DJ

La Marelle , ludothèque – CEC
une ludothèque et un centre d’expression et de créativité

La Mézon t’accueille du lundi au vendredi dans une ambiance cool et conviviale ! À l’accueil tu peux te détendre, discuter, rencontrer des gens, jouer ( PS4, ping pong, kicker, PC) et proposer tes idées à des animateurs à l’écoute !


La Petite Centrale est une salle de spectacles polyvalente en région hutoise.
Concerts, spectacles,

La Scène du Bocage ASBL propose une palette d’activités culturelles au cœur du Pays de Herve.

La Scène Malmedy est une salle de grande capacité pouvant accueillir tous types d’événements !

Le Musée du Silex a.s.b.l.
La Tour d’Eben-Ezer est un monument dédié à la Paix, érigé dès 1950. Elancés vers le ciel, quatre chérubins aux quatre points cardinaux, envoient leur message symbolique au monde. Ses sept niveaux débouchent sur une plateforme entourée aux angles par 4 tourelles surmontées des chérubins.
Elle est construite en pierres de silex, issues des carrières. Son allure brute lui confère un caractère insolite et fantastique. Eben-Ezer est à l’image de Liberté-Egalité-Fraternité grâce à Aimer-Penser-Créer.
Eben-Ezer est le musée de Robert Garcet, chaque salle est animée et fait vivre l’œuvre d’une vie, ses découvertes : ses écritures, sculptures, découvertes, philosophies.
La Tour
D’un caractère insolite et inattendu, la Tour d’Eben-Ezer renferme une symbolique mûrement réfléchie, rien dans sa construction n’est laissé au hasard.
Tels la tour de Babel, les Ziggourats ou encore les donjons du Moyen-âge, les tours ont toujours symbolisé le lien entre les hommes et les dieux. En effet, ces constructions fixent leur encrage dans les profondeurs de la terre et s’élèvent vers le ciel. Elles réalisent ainsi la liaison symbolique entre le Monde Souterrain, la Surface et le domaine des dieux. Par analogie, la Tour d’Eben-Ezer est le moyen donné aux hommes d’atteindre d’autres sphères par le biais de la connaissance.
La tour d’Eben-Ezer représente l’Humanité telle que symbolisée dans la Bible par la Jérusalem Céleste, ville mythique de 12 000 stades de côté ( 2160 km). Disposant d’un espace autrement plus réduit, Robert GARCET conserva néanmoins cette proportion dans son œuvre ; la Tour d’Eben-Ezer fait 12 mètres de côté.
Le Fusil brisé
Le nom même : » Eben-Ezer » fut donné à cette colline par Robert GARCET.
Ce nom est porteur de sens. En effet, c’est selon la Bible l’endroit où Samuel érigea, en 1038 avant JC, une pierre afin de symboliser la paix enfin retrouvée.
La tour d’Eben-Ezer construite à la fin de la seconde guerre mondiale s’érige contre la guerre et toutes formes de violence. C’est pourquoi, chaque année lors du solstice de printemps y flotte une bannière sur laquelle on lit : » … et l’on n’apprendra plus la guerre… « .
Nous ne reprenons ici que quelques exemples de la symbolique de la Tour d’Eben-Ezer. Nous pourrions y consacrer l’entièreté de ce site ; mais tel n’est pas notre objectif… Nous vous invitons plutôt à la découvrir par vous-même au cours d’une visite entre rêverie et mythologie

Expositions, magasin de vins bio, actuellement en sous-sol sur rendez-vous ! Toutes les infos sur https://lavillasauvage.be/

La Zone (Liège)
La Zone est une Maison des Jeunes et un centre liégeois de cultures alternatives qui existe depuis 1988. Elle est située en Outremeuse.
Elle accueille chaque année une large variété de groupes musicaux internationaux et locaux de tous styles, des troupes de théâtre, des artistes de cabaret, des expositions, etc. Citons encore des tables d’hôtes hebdomadaires à prix démocratiques tous les jeudis, des ateliers d’initiation à la sérigraphie ou aux Médias Assistés par Ordinateurs (M.A.O).
Une scène Slam mensuelle très active donne la parole à toutes et tous et est lié à un atelier d’écriture qui permet de se perfectionner à l’expression orale ou écrite.
Présentation
La Zone est un projet politique actif dans le champ culturel qui s’articule autour de 2 axes : la volonté de soutenir, par des processus d’accueil et de coopération, toute initiative portée par des minorités culturelles et permettre à l’ensemble des usagers de s’investir dans une gestion participative des moyens et des lieux de l’association.
À la façon d’un « micro service public », La Zone se donne pour mission de développer un espace d’accueil ouvert à toutes les pratiques collectives où les usagers sont acteurs de leur propre culture tout en reconnaissant la richesse d’autres singularités que la leur et en étant donc capables d’enrichir la construction de leur identité et de leur pratique par des rapports de coopérations, de dialogues et d’échanges.
Nous pouvons qualifier le projet Zone comme axé principalement sur la résistance créative ouverte à toutes les formes d’expression et toujours réceptive aux cultures émergentes dans des rapports de tolérance, de reconnaissance des désirs affinitaires et de garantie d’accès pour chacun.
La Zone veut principalement soutenir la culture active et permettre la mise en œuvre en interne de multiples expériences collectives dans des champs d’action variés. Son objectif prioritaire étant que le projet La Zone reste porté par le plus grand nombre d’usagers en y permettant de multiples entrées concrètes.
Les niveaux de participation pour les usagers sont extrêmement divers et laissés au libre choix de chacun, tout en se fondant sur une série de principes qui ont été pensés pour responsabiliser les usagers, leur donner la possibilité de s’impliquer plus profondément et de devenir de réels usagers actifs et porteurs du projet.
La participation de plusieurs dizaines de personnes, de collectifs, de passionnés de musique, de slam, de cinéma, de cuisine, de créations numériques, de productions artistiques les plus diverses, …, est à la base même du projet, c’est-à-dire : rebondir sur les projets, les envies, les idées, les énergies et aider à leur finalisation; mettre à disposition une infrastructure et des moyens; favoriser une implication à tous les niveaux de gestion, de l’organisation pratique d’événements à l’Assemblée Générale.
Le projet tend à construire une logique de mise en réseaux par l’éclectisme et la transversalité de ses activités, par les rencontres entre différentes cultures, par les collaborations avec d’autres associations de manière à partager les ressources et à échanger les expériences et pour donner de la visibilité à ces démarches.
Reconnue depuis 1988 par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Maison des Jeunes, La Zone reçoit divers subsides pour le fonctionnement et les emplois. Elle dispose d’une infrastructure comprenant une salle de concert, une salle polyvalente, un dortoir, une cuisine, des locaux pour les ateliers, des bureaux, des salles de réunions, etc.
La structure juridique de La Zone est une ASBL dont l’Assemblée Générale est idéalement composée d’usagers actifs et représentative des différents secteurs d’activités de manière équilibrée.
Historique
L’asbl La Zone a été fondée par une troupe de théâtre-action à la fin des années 80. À la même époque, des connivences s’établissent entre l’équipe de la Zone, un nouveau collectif d’organisations de concert (Zone Libre) et un groupe de plasticiens (Trace). De cette rencontre va naître un projet alliant activités théâtrales, musicales et arts plastiques. Ensuite arrive la reconnaissance de la Zone en tant que Maison de Jeunes, et le 17 octobre 1991 a lieu l’inauguration de la salle de concert souterraine.

Le Laser Game est l’activité à la mode de 7 à 77 ans. Celui de Verviers a ouvert ses portes en juillet 1997, le système a bien évolué depuis.


Le Chœur d’hommes de Liège, Société royale des Disciples de Grétry, fondée à Liège le 18 juin 1878, chante depuis plus d’un siècle un répertoire aussi vaste que varié : chant sacré, Gospel, Opérettes, comédies musicales, variété, …


HANNUT:
Une salle attractive de 500m2 accueillant des spectacles de stand-up (Comedy Club) ainsi que des soirées dansantes & corporate. Une jolie mezzanine vous permettra ainsi de passer d’agréables moments et de profiter d’une vue à 180 degrés sur la salle.
BARCHON :
Une salle polyvalente de 550m2, unique dans la région liégeoise, accueillant des spectacles de stand-up (Comedy Show) des soirées dansantes ainsi que des événements associatifs. La salle dispose également d’une surface extérieure afin de vous divertir en configuration Outdoor l’été.

Le Forum est une salle de spectacle liégeoise ouverte le 30 septembre 1922. De style Art déco, la salle est située rue Pont d’Avroy. Le bâtiment est classé au patrimoine exceptionnel de la Région wallonne.
Histoire
Inaugurée en 1922 à l’initiative d’Arthur Mathonet, la salle est dédiée au cinéma, au music-hall et à l’opérette. La salle est reprise en 1929 par la MGM. « La Comilière » (société à la base de la naissance du Forum), fit faillite en 1936. Le duo Masereel-Beckers racheta les lots de terrain dont le Forum faisait partie.
Pendant la guerre cependant, la MGM, aux mains de propriétaires israëlites2, fut écartée de la gestion par les nazis. La MGM ne put reprendre ses activités au Forum qu’en 1947.
Les propriétaires ouvrirent alors Le Churchill (salle existant toujours, dorénavant gérée par le groupe Grignoux), au sous sol du bâtiment. Au terme du bail de la MGM en 1956, M. et Mme Masereel devinrent alors les seuls propriétaires du lieu. Ils cédèrent le bail d’exploitation en 1968 à Hubert Defawes. Au décès de M. Masereel en 1979, sa femme devint seule propriétaire.
En 1968, M. Masereel passa la main et céda le bail d’exploitation à M. Defawes qui devint administrateur-gérant. Monsieur Masereel resta propriétaire. En février 1979, M. Masereel décéda à l’âge de 86 ans, sa femme devint alors propriétaire. Mme Claeys, directrice du complexe Opéra (site et propriétaires depuis à la base du groupe Kinepolis), racheta le bail d’exploitation du Forum en 1984. Suite à un contrôle des services de sécurité communaux, le Forum dut fermer temporairement ses portes. Elle ne rouvrirent qu’en 1989, suite au rachat et à la rénovation par Communauté française de Belgique. La salle et le péristyle furent classés dès 1979, et la façade et l’escalier en 1989 3,4.
Tournages
Le Forum a servi de décor aux scènes de la compétition internationale pour le film Populaire (2012) de Régis Roinsard, avec Romain Duris et la liégeoise Déborah François5.

Le CEC « Le Grain d’art » organise des ateliers hebdomadaires, des stages et des projets d’expression

Grand Curtius
Le Grand Curtius est un ensemble muséal situé à Liège en Belgique inauguré en 2009. Il regroupe les collections de plusieurs musées liégeois : le musée Curtius (Musées d’archéologie et d’arts décoratifs), le musée d’art religieux et d’art mosan, le musée d’armes et le musée du verre ainsi que l’ancienne collection d’égyptologie de l’université de Liège.
Il occupe notamment la résidence et le palais Curtius, les hôtels de Hayme de Bomal et Brahy, et la maison Dewilde. Son nom lui vient de Jean De Corte, dit Jean Curtius, industriel liégeois et négociant d’armes du xviie siècle qui construit sa demeure, le palais Curtius au bord de la Meuse à Liège.
Avec plus de 5 000 m2 de surface d’exposition et plus de 5 000 pièces, le musée est le plus grand et le plus important musée de la Région wallonne1.
Histoire
Historique des collections
En 1850 fut fondé l’Institut archéologique liégeois (IAL), dont l’un des objectifs était d’ouvrir un musée. Les collections furent successivement présentées dans différents lieux avant d’être exposées dans une aile du palais des Princes-Évêques en 1874. En 1891 naquit le projet de transfert du musée dans la maison Curtius. En 1896, la ville projeta également d’abriter ses collections propres ainsi que celles de l’IAL dans un bâtiment à leur mesure. Le palais Curtius fut acquis par la ville en 1901. Après une longue restauration par l’architecte Joseph Lousberg, il abrita le musée Curtius (appelé initialement Musée archéologique liégeois) qui ouvrit ses portes le 1er août 1909.
À l’origine, l’œuvre d’une famille de collectionneurs, Alfred Baar et son fils Armand Baar, la collection de verres fut mise en dépôt au musée Curtius par la veuve d’Armand en 1946. La ville l’acheta en 1952. Dès 1959, cette collection devint une section indépendante, qui fut progressivement enrichie en pièces des xixe et xxe siècles, ainsi qu’en cristal du Val-Saint-Lambert.
Le musée d’Armes de la ville de Liège fut créé grâce à la donation initiale du fabricant d’armes Pierre-Joseph Lemille. Lorsqu’il ouvrit ses portes en 1885, la Cité ardente était toujours l’une des plus grandes productrices d’armes portatives au monde. Cette tradition liégeoise de fabrication d’armes perdure d’ailleurs encore au xxie siècle, notamment à la Fabrique nationale d’Armes d’Herstal ou à l’école d’armurerie. Il était abrité dans l’hôtel de Hayme de Bomal. S’il fut créé pour montrer aux professionnels ce qui se fabriquait dans le monde en matière d’armurerie, il eut pour vocation, depuis les années 1960, d’intéresser le grand public.
L’ancien musée d’Art religieux et d’Art mosan, également appelé MARAM, fut fondé en 1891 par la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, et agréé par la ville de Liège dès 1976. Ce musée fut hébergé rue Mère-Dieu jusqu’à la création du Grand Curtius.
Historique du projet de regroupement des collections
Si l’idée de regroupement fut maintes fois évoquée, c’est en 1995 que le projet devint plus précis. À ce moment le regroupement des musées décrits est arrêté sous le nom d’EMAHL, pour « Ensemble muséal d’art et d’histoire de Liège ».
De nombreuses polémiques et recours, principalement architecturaux, émailleront sa conception jusqu’en 2005. Le projet prit entre-temps le nom de « Grand Curtius ». L’aménagement se poursuivit ensuite sans heurts jusqu’à la date d’ouverture, en mars 2009.
Bâtiments
- Palais Curtius
- Maison Dewilde
- Hôtel de Hayme de Bomal
- Hôtel Brahy
- Nouveaux bâtiments
- Résidence Curtius
Le musée est logé dans quatre bâtiments historiques, qui forment un grand bloc entre le fleuve et la collégiale Saint-Barthélemy, à la périphérie du centre-ville de Liège. De 2001 à 2009, le complexe a été restauré et agrandi.
Palais Curtius
Le palais Curtius, bâtiment principal, ainsi que de l’ensemble du musée doivent leur nom à Jean Curtius, le nom latinisé de Jean de Corte. Curtius était un marchand d’armes et de poudre à canon et gagna beaucoup d’argent pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans. Il construit entre 1597 et 1605 sur le quai de Maestricht, sur le site d’une ancienne maison canonial, une grande maison en briques rouge contrastant avec la pierre de Namur. Le bâtiment est souvent considéré comme l’archétype du style Renaissance mosane2. Après la mort de Curtius, le bâtiment principal, le palais, est acheté par le mont-de-piété. Le reste du complexe, la résidence Curtius est resté une possession de la famille jusqu’en 1734. À partir de 1909, le Palais Curtius abrite l’ancien Musée Curtius avec sa collection archéologique et d’art religieux. À la suite de l’extension du bâtiment, il est actuellement encore utilisé principalement pour des expositions temporaires3.
-
Vue depuis la Meuse
Hôtel de Hayme de Bomal
Une autre partie importante de l’actuel Grand Curtius est l’hôtel de Hayme de Bomal, un typique hôtel particulier français dans le style Louis XVI. La maison date de la seconde moitié du xviiie siècle et fut construite sur ordre de Jean-Baptiste de Hayme de Bomal d’après les plans de l’architecte liégeois Barthélemy Digneffe. En 1793, le palais est le siège de la préfecture du département Ourthe. Vers 1800, la propriété est richement décoré dans le style Empire avec beaucoup de miroirs et de feuilles d’or. Napoléon Bonaparte y réside plusieurs fois (son portrait peint et celui de sa femme, un buste sculpté et divers souvenirs sont exposés au musée)4.
-
Vue depuis le quai de Maestricht
-
Intérieur de style Empire
Autres bâtiments et extension
Œuvre de Lawrence Weiner dans le jardin du Grand Curtius
En plus de ces deux palais, il y a un complexe de bâtiments du xviie siècle : l’hôtel Brahy et la maison Dewilde. Les quatre hôtels particuliers ont été considérablement restaurés entre 2001 à 2009. Les bâtiments existants ont été reliés entre eux par une nouvelle construction, où le verre est largement utilisé. Un grand, nouveau volume de construction le long de Féronstrée a été conçu par l’architecte Daniel Dethier dans le style néo-classique, en harmonie avec l’environnement. Entre ces bâtiments se trouvent quelques cours joliment décorées, l’une d’entre elles est décorée par l’artiste Lawrence Weiner5. Le Grand Curtius dispose d’un café-restaurant et d’une boutique de musée.
-
Entrée du musée en Féronstrée
Collections
Le nouveau musée Grand Curtius regroupe les collections de cinq musées liégeois, cet ensemble muséal est devenu le centre pour les arts appliqués dans l’Euregio Meuse-Rhin.
Le musée possède plus de 100 000 objets d’importance régionale, nationale et internationale, allant des haches en silex préhistoriques aux éventails du xviiie siècle. Seule une partie de la collection, environ 5%, est exposée en permanence dans le musée ordonné. L’ensemble donne un aperçu de plus de 7 000 ans de civilisation humaine : trésors archéologiques de l’Égypte ancienne (ancienne collection de l’université de Liège), objets de l’époque romaine, mérovingienne et franque (collection originale des Musées d’Archéologie et d’Arts Décoratifs), sculptures et orfèvrerie mosanes (collection de l’ancien Musée d’Art et d’Art mosan religieux) et un grand nombre de peintures, sculptures, parties d’ouvrage, meubles, tapisseries et objets de l’époque Renaissance et baroque. Le musée possède également une grande collection de verre ancien (issue de l’ancien Musée du Verre) et l’une des plus importantes collections d’armes anciennes dans le monde (de l’ancien Musée des Armes). En 2007, le musée reçut un don important d’horloges françaises, de verrerie et porcelaine de Sèvres du baron et de la baronne Duesberg (appelé collection Duesberg).
Dans le cadre de la redistribution des collections muséales liégeoises à la suite de l’ouverture du nouveau musée des beaux-arts, La Boverie, certaines peintures du Grand Curtius ont récemment déménagé. Ce déménagement comprend des tableaux de Jan Steen et de Jacob Jordaens ainsi que le fameux portrait de Bonaparte, Premier consul, par Ingres. Le Grand Curtius n’a pas pour vocation d’être un musée d’art, les sculptures et peintures exposées illustrent un épisode de l’histoire de Liège ou font partie de chambres d’époque.
S’étendant sur une superficie d’environ 10 000 mètres carrés, et exposant quelque 5 000 œuvres, le Grand Curtius présente deux parcours. Le premier est chronologique. Le second est thématique et couvre certains domaines particulièrement bien représentés dans le musée.
Archéologie et histoire
Les collections d’archéologie sont riches notamment de pièces néolithiques et paléolithiques, gallo-romaines et mérovingiennes. La plupart proviennent de fouilles menées en province de Liège (Engis, Haccourt, Liège, Roche-aux-faucons, Omal)à Spy. Elles retracent l’histoire locale de la préhistoire à la fin de l’époque carolingienne.
Ce département est créé en 1896 à la suite de la volonté de la ville de Liège de fusionner sa propre collection archéologique avec la collection d’objets de l’Institut archéologique liégeois. Pièces marquantes de la collection : crâne d’un homme de Néandertal découvert à Engis en 1829 (c. 5 300 av. J.-C.), peigne en os de l’époque néolithique, une table d’offrandes égyptienne (Moyen Empire égyptien (c. 2 000 av. J.-C.), vase-buste gallo-romain (ier–iiie siècle), un dodécaèdre (ive siècle), l’arc de Glons (viie siècle), divers livres et manuscrits médiévaux et un modèle de la cathédrale Saint-Lambert démoli après 1789.
-
Crâne d’un homme de Néandertal
-
Vase-buste gallo-romain
Art religieux et art mosan
Datée de 19706, une maquette de la Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège, ici comme vue du Palais des Prince-évêques, montre les tours de sables en tuffeau, sorte de craie sableuse…
L’art religieux, issu des collections du musée d’art religieux et d’art mosan7 et de l’ancien musée Curtius, est plus particulièrement représenté par ses pièces d’art mosan mais, plus globalement, la section présente l’évolution de l’art religieux dans l’ancien diocèse de Liège, suivant les grands courants artistiques du Haut Moyen Âge au début du xxe siècle.
Y sont notamment présentées des sculptures sur bois, des manuscrits, des pièces d’orfèvrerie mosane et liégeoise, des bronzes, des peintures des écoles wallonne, flamande, italienne, allemande et française, des tissus orientaux et des ornements liturgiques du viiie au xixe siècles.
Une section du musée est consacrée à saint Lambert : elle regroupe les principaux souvenirs historiques et iconographiques liés au Saint, ainsi qu’une maquette au 1/100 de l’ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert détruite à partir de 1794 pendant la Révolution liégeoise.
Enfin, une salle consacrée à la franc-maçonnerie à Liège termine le parcours, exposant des pièces prêtées par les musées maçonniques et les principales loges de Liège.
Les œuvres majeures de cette collection sont les chapiteaux sculptés de la cathédrale Saint-Lambert (xiie siècle), le Secret d’Apollon ou la Pierre Bourdon (tympan du xiie siècle), La Vierge de Dom Rupert (bas-relief du xiie siècle), plusieurs crucifix en bois et Vierge à l’Enfant (xie et xiiie siècles), l’Évangéliaire dit de Notger (orfèvrerie du xe siècle), l’Évangéliaire d’Arenberg (xiie siècle) et le triptyque-reliquaire de la Sainte-Croix (xiie siècle).
-
Chapiteaux sculptés de la cathédrale Saint-Lambert
Art gothique
Le Grand Curtius possède une importante collection de sculptures et reliefs gothiques et gothique tardif. Parmi les pièces intéressantes :Il convient de noter sont les sculptures romano-gothique du xiiie siècle, un saint pape inconnu du début du xive siècle, une Vierge à l’Enfant grandeur nature de la fin du xive siècle, un Ioannes in Disco (la tête de Jean-Baptiste dans un plat) de Jan de Steffeswert de 1508 et plusieurs fragments de retables des Pays-Bas méridionaux du xve et xvie siècles.
Aux mains de l’historien et peintre Jules Helbig, le musée acquiert des peintures de primitifs flamands comprenant la Vierge à l’enfant d’un peintre anonyme d’autour de 1475. Une autre œuvre importante de cette période est le dessin d’une vierge à l’enfant dans un intérieur d’église, de la région de Jan van Eyck.
Renaissance liégeoise
Le style Renaissance liégeoise ou Renaissance mosane s’est développé à Liège au xvie siècle sous le règne de Érard de La Marck. De cette époque qui comprend le Palais des Princes-Évêques (d’Arnold Mulken après 1526), l’Hôtel de Cortebach (vers 1540) et, un peu plus tard, le portail de l’église Saint-Jacques-le-Mineur (Lambert Lombard en 1558). Lambert Lombard en plus d’être architecte était également peintre. Il peint notamment une série de 8 tableaux connus sous le nom de Femmes Vertueuses qui décoraient les bâtiments de l’abbaye de Herkenrode, le Grand Curtius possède quatre de ces huit tableaux. Le musée possède également un certain nombre de sculptures de la Renaissance en marbre noir de Theux et un collier de guilde précieux de 1525-1530.
-
Jaël (Lambert Lombard, c. 1530)
-
Colonne sculptée (Abbaye de Beaurepart, c. 1560)
Baroque liégeois
Le baroque liégeois occupe une position intermédiaire entre le baroque flamboyant français et le classicisme rigoureux néerlandais. Le musée dispose d’un grand nombre de dessins et d’études de Jean Del Cour, « Le Bernin liégeois » et de son contemporain Arnold de Hontoire. On peut également citer les peintres liégeois Englebert Fisen, Jean-Baptiste Coclers, Jean-Guillaume Carlier, Léonard Defrance et Paul-Joseph Delcloche ou le peintre de Malmedy Louis-Félix Rhénasteine, portraitiste des princes-évêques de Liège.
-
Vierge à l’Enfant (Jean Del Cour, 1693)
-
Buste de Joseph-Clément de Bavière (Arnold de Hontoire, c. 1700)
-
Promethée enchaîné sur le rocher (Guillaume Évrard, c. 1790)
Art mobilier liégeois
L’art mobilier liégeois atteint son apogée dans la seconde moitié du xviiie siècle avec la perfection des meubles Liège-Aix. Malgré une vaste collection, le Grand Curtius, par rapport au proche musée d’Ansembourg, ne propose qu’un bref aperçu en raison du manque de place. Le mobilier des différents styles et époques sont exposés dans des chambres d’époque du xve siècle. Plusieurs créations de Gustave Serrurier-Bovy s’y retrouvent, notamment dans le studio d’Eugène Ysaÿe, légué à la ville par ses héritiers et désormais présenté au Grand Curtius.
-
Chambre d’époque(xviie siècle)
-
Garde-robe liégeoise style Louis XV (xviiie siècle)
-
Ensemble Art nouveau (1902)
Collection Duesberg
La collection Duesberg, obtenue en 2007, contient des horloges françaises, verrerie et de la vaisselle (y compris de la porcelaine de Sèvres) de la période 1775-1825 exposées dans les salons de musique, le salon « aux palmiers » et la rotonde de l’hôtel de Hayme de Bomal. Ces salons d’apparat portent désormais le nom de salons baron et baronne François Duesberg. La majeure partie de la collection du couple est exposée au musée des arts décoratifs François Duesberg de Mons. En plus de la collection Duesberg, le Grand Curtius est propriétaire d’une vaste collection de figurines en porcelaine, vaisselle et argenterie, principalement des xviiie et xixe siècles, dont seule une petite partie est exposée.
-
Vitrine dans l’hôtel de Hayme de Bomal
-
Ère napoléonienne (style Empire)
-
Pendule avec Arlequin et un singe
Argenterie religieuse
Liège, ville des Princes-évêques, compta un nombre d’églises et de couvents très important. Les objets liturgiques était donc extrêmement nombreux : chandeliers, reliquaires et autres objets d’orfèvrerie pour le culte catholique. Les orfèvres liégeois du xviiie siècle (comme à Tongres, Maastricht et Aix-la-Chapelle) ont atteint un grand niveau d’expertise. La collection d’argenterie ecclésiastique du Grand Curtius se trouve au dernier étage de l’hôtel de Hayme de Bomal. Cette collection compte un ensemble en argent impressionnant : la garniture baroque du service de l’autel de la chapelle Saint-Augustin de l’hôpital de Bavière.
-
Vitrines dans l’hôtel de Hayme de Bomal
Art verrier
La noyau de la collection de verres acquise en 1952, dite collection Baar, était à l’origine constituée de 2 400 pièces représentant les verres vénitiens, liégeois, anversois, hollandais, ainsi que le cristal de Bohême et d’Angleterre. En 1959, la collection devient indépendante et nait ainsi le Musée du Verre8.
Elle fut plus tard enrichie en verres des xixe et xxe siècles, de pièces d’art contemporain, et en œuvres des Cristalleries du Val-Saint-Lambert. Actuellement, il s’agit d’une des plus prestigieuses collections mondiales, riche d’environ 10 000 pièces. Elle donne un bon aperçu de la fabrication et de la transformation des objets en verre de l’Antiquité à nos jours avec un fort accent sur la région de Liège qui fut au xviie et xviiie siècles un site de production du verre très important. La collection se trouve au rez-de-chaussée et étage de l’hôtel Brahy et résidence Curtius.
-
Vase Art nouveau (Philippe Wolfers, Val-Saint-Lambert, 1901)
-
Lapin et perruches (Charles Graffart, Val-Saint-Lambert, 1932-1935)
Armes
Liège était déjà un important centre de fabrication d’armes au xvie siècle. Ainsi, Jean Curtius, commanditaire du palais Curtius, était, un marchand d’armes qui a fait des affaires dans toute l’Europe. Il n’est donc pas surprenant que le Musée des Armes, fondé grâce à la donation initiale du fabricant d’armes Pierre Joseph Lemille en 1885, soit l’un des plus anciens musées de Liège. Ce musée était alors situé dans l’hôtel de Hayme de Bomal, propriété de Lemille9. Lorsqu’il ouvrit ses portes, la Cité ardente était toujours l’une des plus grandes productrices d’armes portatives au monde. Cette tradition liégeoise de fabrication d’armes perdure d’ailleurs encore au xxie siècle, notamment à la Fabrique nationale d’Armes d’Herstal ou à l’école d’armurerie. S’il fut créé pour montrer aux professionnels ce qui se fabriquait dans le monde en matière d’armurerie, il eut pour vocation, depuis les années 1960, d’intéresser le grand public.
En 2009, les collections de l’ancien musée d’armes rejoignent celles du Grand Curtius. La collection regroupant 20 000 pièces se trouve alors dans une aile de la résidence Curtius et se compose de deux sections : les armes civiles et les armes militaires. Sur l’ensemble des pièces, seules 465 sont exposées10. L’accent est mis sur la production liégeoise et en particulier la FN Herstal. L’équipement défensif, l’artillerie, l’armurerie de luxe sont plus brièvement évoqués.
En 2018, la fondation Roi-Baudouin confie au musée l’épée de Rubens. Celle-ci appartenait au roi Charles Ier d’Angleterre qui l’avait lui-même reçue du parlement anglais. Charles Ier offre son épée à Rubens en 1630 pour le remercier de ses efforts diplomatiques à faire aboutir un traité de paix entre l’Espagne et l’Angleterre au sujet des Pays-Bas espagnols et des Provinces-Unies11,12.
Le musée propose une refonte complète de sa collection d’armes en l’installant sur trois étage de palais Curtius. La première partie de cette rénovation est inaugurée, le 20 septembre 2018 avec la section installée au 1er étage et consacrée aux armes civiles (chasse et tir sportif) et aux armes de défense (pistolets et revolvers) comptant quelque 600 pièces.
En 2019, le 2e étage abritera les armes militaires et les armes blanches et techniques seront installées au 3e étage palais en 2020. Au terme de ce redéploiement, ce sont environ 3 000 pièces qui seront exposées sur les trois premiers étages du palais Curtius13.
-
Gantelet d’armures (Greenwich, c. 1585)
-
Pistolets à monture d’ivoire (Maastricht, c. 1665)
-
Mitrailleuse Montigny(Liège, 1870)
-
Armes modernes (FN Herstal, 2008)
Biens classés
Le musée compte 24 biens classés au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
| Catégorie | Sous-catégorie | Nom du bien | Datation | Illustration |
|---|---|---|---|---|
| Beaux-arts | Peinture | La Vierge à l’Enfant avec donatrice et Marie Madeleine du Maître à la Vue de Sainte Gudule | xve siècle | |
| Beaux-arts | Peinture | Diptyque dit Palude | Après 1488 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Vierge dite de Dom Rupert | 1149–1158 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Tympan de la Prophétie d’Apollon | Dernier quart du xiie siècle | |
| Beaux-arts | Sculpture | Vierge de Berselius y compris son socle | 1529–1535 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Christ de Rausa | c.1230–1240 | |
| Beaux-arts | Sculpture | 6 fragments d’un retable de la Passion (Collection privée) | c. 1340 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Christ d’Oreye | c.1260 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Ivoire d’Amay | c. 850–1050 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Saint Luc et saint Marc | c. 1320–1330 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Prométhée enchaîné, Guillaume Évrard | Avant 1784 | |
| Beaux-arts | Sculpture | Vierge d’Évegnée | Vers 1050-1070 | |
| Beaux-arts | Orfèvrerie | Coupe Oranus dans son ensemble | 1564 (datation non certaine) |
|
| Beaux-arts | Orfèvrerie Manuscrits |
Les plats de reliure et l’Évangéliaire dit de Notger | Manuscrit : vers 860 Ivoire : fin xe siècle Émaux : c.1160–1170 |
|
| Beaux-arts | Orfèvrerie | Triptyque-reliquaire de la Sainte-Croix | c. 1160–1170 | |
| Beaux-arts | Verre | Vase « Crépuscule » de Philippe Wolfers | c. 1900 | |
| Beaux-arts | Verre | Aiguière catalagne | 2e moitié du xvie – début du xviie siècle | |
| Beaux-arts | Verre | Vase des neuf Provinces de Léon Ledru | 1894 | |
| Beaux-arts | Mobilier | Piano de la Chapelle-en-Serval, Gustave Serrurier-Bovy | 1901–1902 | |
| Archéologie | Bronzes d’Angleur formant un ensemble de vingt pièces constitutives du décor d’un autel et d’une fontaine dédiés à Mithra | Fin du iie siècle-première moitié du iiie siècle | ||
| Archéologie | Bassin de purification avec inscription dédicatoire trouvé à Jupille | Seconde moitié du iie siècle | ||
| Archéologie | Cinq claveaux ornés et deux pierres dédicatoires de Glons (Fondations de l’église Saint-Victor de Glons ) | Milieu du viie siècle | ||
| Sciences-Techniques-Industries | Fusil de chasse de grand luxe pour cartouche à broche, attribué à Pierre-Joseph Lemille | 1865 | ||
| Sciences-Techniques-Industries | Pendule astronomique à 6 cadrans de Sarton, Dieudonné Hubert Sarton | c. 1794–1795 |
Expositions
- Luis Salazar du 14 septembre 2012 au 17 décembre 2012
- Jean-Paul Laixhay du 15 mai 2013 au 28 juillet 2013
- Sophie Langohr, New faces du 26 avril 2013 au 14 juillet 2013
- Christophe Remacle, Regard sur le Grand Curtius du 26 avril 2013 au 14 juillet 2013
- Christian Satin (en), Peintre et Architecte du 15 février au 15 mars 2015
En quelques chiffres
- Superficie totale du site : 5 635 m2, dont 3 176 m2 bâtis ;
- Superficie totale du projet (exposition, circulation, espace technique) : 9 687 m2 ;
- Superficie totale des parcours : 5 103 m2 répartis de la manière suivante14 :
- parcours chronologique : 2 417 m2,
- parcours thématiques : 1 290 m2 (Égypte, verre, armes, lapidaire, arts de la table et spiritualité),
- parcours exposition temporaire :1 396 m2 y compris la salle d’actualité ;
- Nombre de pièces exposées : 5 91415.
- Nombres de pièces classées : 18 (Patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles)



Le Lab’O, c’est le 2ème dimanche de chaque mois, à la Casa Nicaragua, avec Splatchwork asbl et 48FM.

Historique
En 19851, quelques amateurs de théâtre investissent la salle d’un ancien cinéma du quartier Sainte-Walburge construit en 1928, et aménagent deux salles de spectacle, la grande d’une capacité de 120 places et la petite d’une capacité de plus ou moins 50 places, et une cafétéria pour y faire principalement du théâtre2, des expositions, des ateliers et des stages3.
La compagnie
Composée d’une trentaine de comédiens, la compagnie du Moderne réunit des personnes de tous les âges et de tous les milieux. Elle s’ouvre régulièrement à des comédiens issus d’autres compagnies ou du milieu professionnel3.
La diffusion, les accueils
Musiciens, chanteurs, danseurs et bien sûr comédiens, artistes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que de jeunes compagnies cherchant à faire connaître leur travail3.
Les expositions photographiques
Tous les deux mois, la cafétéria du Moderne accueille une exposition de photographie, individuelle ou collective. Sous la houlette de l’association de photographes « Priorité à l’ouverture », partageant ainsi leurs œuvres avec le public du théâtre, mais aussi du quartier3.

Location de matériels festifs (châteaux gonflables, chapiteaux, go-karts, jeux ludiques, popcorn,


La référence latino à Liège 🇧🇪
Commence seul ou en couple 😍
Fitness, Salsa, Bachata & M

Péniche spectacle, espace d’art et d’expression itinérant
Afin de vous inciter à partager notre rêve éveillé, voici une petite projection tout en poésie:
A l’intérieur et tout autour
A l’intérieur : dans l’intimité des cœurs qui battent.
C’est l’hiver : le feu crépite dans le poêle à bois, les flammes se reflètent dans l’eau du fleuve qui arrive juste à fleur des hublots, c’est la tombée de la nuit, entre chien et loup, un cygne passe ; le parfum du potimarron cuisiné aux épices vous titille les narines, agite vos papilles gustatives ; bientôt la cloche sonnera et le spectacle pourra commencer.
Tout autour :
C’est le printemps : Cent tambours et trompettes laissent échapper mille notes par les sabords grands ouverts ; il est temps de sortir du ventre, d’aller danser là-haut sur le pont, sous le soleil de minuit et applaudir les petites poupées de chiffon qui saluent sous les étoiles.

La Bibliothèque libre de Racour, la petite bibliothèque qui a tout d’une grande et même davantage !
Membre du réseau public de lecture de la région hannutoise, elle offre depuis plus de 80 ans aux habitants de notre commune l’accès à la lecture.

Les Apéros Hutois, c’est le rendez-vous incontournable, ouvert à tous, qui rythme les saisons dans la région hutoise.

Le Centre de littérature jeunesse et graphique de la Ville de Liège a été créé en 2009 au départ du Fonds Michel Defourny. Conservé aux Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège, ce centre documentaire tout à fait exceptionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles, propose quelques 70.000 ouvrages à la disposition de tous les publics, composés essentiellement de chercheurs, artistes, illustrateurs, étudiants, enseignants,…
Depuis sa création l’asbl Les Ateliers du Texte et de l’Image vise à la valorisation de ce Fonds exceptionnel. Elle met son expertise ainsi que ses ressources documentaires et humaines au service d’initiatives locales (Liège et son arrondissement), communautaires (territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et internationales (UE principalement) : les points communs à toutes ces initiatives sont des objectifs de promotion de la lecture chez les jeunes, de formation de bibliothécaires et d’animateurs de centres culturels, de soutien à la création artistique et littéraire, de rayonnement des auteurs et illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles,…
Pour mener à bien ses actions et missions, l’asbl Les Ateliers du Texte et de l’Image n’œuvre pas seule ; au contraire elle construit au fil du temps et de sa programmation diversifiée un réseau dense de partenariats avec diverses institutions culturelles et d’éducation permanente : Centres d’Expression & de Créativité et ateliers d’éveil à la philosophie ; bibliothèques publiques, centres de documentation et librairies spécialisées ; écoles primaires, secondaires et supérieures (d’art et de pédagogie essentiellement) ; musées, centres d’art et centres culturels ; maisons d’édition liées au monde de l’illustration et de la littérature jeunesse ; etc.
A souligner : ces partenariats s’inscrivent dans un large objectif de transversalité ardemment défendu par l’asbl Les Ateliers du Texte et de l’Image.

Troupe de théâtre amateur bénévole composée de femmes et d’hommes qui jouent et répètent dans la région de Soumagne (Liège). Plus d’infos sur notre nouveau site web : http://www.benevolart.be


Grottes de Remouchamps
Les grottes de Remouchamps, situées en Belgique dans la commune liégeoise d’Aywaille, sont formées de deux galeries se visitant à pied et en barque. Elles sont surnommées la Merveille des Merveilles et sont un des hauts lieux du tourisme en province de Liège et en Wallonie.
Historique
Les grottes de Remouchamps se trouvent sur la limite de trois régions géologiques : le Condroz formé de grès et de calcaire, la Calestienne calcaire et l’Ardenne schisteuse. Les grottes se sont formées dans le calcaire il y a plus d’un million d’années par la présence d’une rivière souterraine, le Rubicon.
Cette petite rivière provient du vallon des Chantoirs entre Louveigné et Deigné où elle s’engouffre sous terre pour ne réapparaître que quelques mètres avant son confluent avec l’Amblève. Le Rubicon a d’abord façonné la galerie supérieure (visite à pied) avant de trouver plus bas une autre voie, la galerie inférieure, où il coule encore aujourd’hui (visite en barque).
Il y a 8 000 ans, les chasseurs du paléolithique ont fréquenté la première salle. L’ensemble des grottes fut découvert en 1828 et ouvert officiellement au public en 1912 (visiteurs équipés de torches). Un éclairage permanent fut installé dès 1924. Pendant la seconde Guerre mondiale, elle servit de refuge aux Remoucastriens.
Visite
Toutes les visites des grottes de Remouchamps sont guidées et en plusieurs langues. Elles durent environ une heure et quart. La température à l’intérieur des grottes varie peu. Elle oscille entre 8 et 10 degrés.
Galerie supérieure (à pied)
On y découvre successivement, au fil d’un circuit long de 1 200 mètres : la galerie du précipice qui est la salle d’entrée, la salle des ruines et son bloc suspendu d’une quarantaine de tonnes, la grande draperie d’une hauteur de 7 mètres formée par l’eau de pluie se transformant en dépôts cristallins, la salle de la Vierge et sa stalagmite évoquant la Vierge Marie portant Jésus, la grande galerie et ses barrages de calcite et enfin la cathédrale, haute de 40 mètres et profonde de 100 mètres.
Galerie inférieure (en barque)
Par l’arche naturelle appelée le pont des Titans, on accède à la rivière du Rubicon où la visite se poursuit en barque à fond plat.
Au milieu du Rubicon, se dresse le palmier, étrange et magnifique colonne d’une stalactite et d’une stalagmite rejointes.
La navigation est tranquille mais le plafond s’abaisse par endroits. Seules de petites crevettes dépigmentées, les niphargus vivent dans cet environnement. Par un ancien siphon agrandi pour permettre le passage des embarcations, on accède au débarcadère au terme d’une navigation souterraine de 600 mètres, soit la plus longue au monde[réf. souhaitée].
À la sortie des grottes, se trouvent un petit musée ainsi que des expositions thématiques.


Les Temps Mêlés, un outil de promotion des arts et de la culture en plein cœur de Verviers.
Les Territoires de la Mémoire sont un centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté

Anciens thermes de Spa
Les anciens thermes de Spa appelés aussi ancien établissement thermal de Spa ou Bains de Spa sont une construction située dans le centre de la ville de Spa en province de Liège (Belgique). Ils font partie du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne depuis le 6 octobre 2016.
Localisation
Les anciens thermes se situent en plein centre de Spa. La façade est visible depuis la rue Royale. Les rues de la Poste, Servais et Léopold entourent le bâtiment.
Historique
Ces thermes sont en réalité les troisièmes construits dans la ville de Spa.
Un premier établissement public de bains avait été érigé en 1828 à l’emplacement de l’actuel hôtel de ville.
En 1841, un deuxième établissement fut construit Place Royale, à l’emplacement de l’ancien hôtel des Tuileries et de l’actuel pavillon de la maison du tourisme situé au bout de la galerie Léopold II, à l’entrée du parc de Sept Heures. Une moyenne de 6 000 bains par an y était donnée.
Sous l’impulsion du bourgmestre Servais, les troisièmes thermes sont inaugurés le 15 août 1868 sur les prairies Lezaack. Il s’agit d’un ensemble hydrothérapique de première classe qui coûta la somme très importante pour l’époque d’1 500 000 de francs belges. Ces thermes accueillirent jusqu’à 167 182 opérations thermales par an (en 1967).
Après 135 années de fonctionnement, ces thermes ferment leurs portes en 2003. Ils sont remplacés par un établissement moderne (les quatrièmes thermes) sur la colline d’Annette et Lubin. Ces nouveaux thermes sont reliés par funiculaire au centre de la ville.
Malgré quelques problèmes dus à la présence de mérule1, les thermes de 1868 devraient être réaffectés en résidence hôtelière de luxe afin de protéger cet immeuble incontournable du thermalisme spadois2 qui se trouve depuis 2014 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO parmi les grandes villes d’eaux d’Europe.
Description
Cet imposant bâtiment comprenant deux étages est construit dans un style néo-Renaissance française sur les plans de l’architecte Léon Suys.
À l’origine, cet établissement comptait 52 cabines de bains avec 54 baignoires, 2 salles de grandes douches à forte pression, 2 grandes salles de douches ordinaires et hydrothérapiques avec bassin d’immersion, 2 salles d’hydrothérapie proprement dite, 2 salles pour douches en cercle, douches de siège et pour bains de pieds à eau courante ainsi que 2 plongeons. Par la suite, de nombreuses modifications ont été opérées dans un souci de modernisation de l’établissement.
Charles-Henri Thorelle fut chargé de la taille et de la sculpture des pierres de France. Les statues de la façade et des côtés sont les œuvres de Jacques Van Omberg et des frères Van Den Kerkhove. Le vestibule d’entrée et les salons de repos ont été décorés par le peintre Carpey.
Les façades intérieures (sur cour) et extérieures ainsi que le perron d’accès et le hall d’entrée sont repris sur la liste du patrimoine immobilier classé de Spa et font partie des biens inscrits à la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie. Les thermes ne se visitent pas.
Galerie

Oeuvres, profanes et sacrées, chansons populaires françaises et wallonnes, Negro spirituals, chants folkloriques de tous pays, chants contemporains …

Depuis 1998, les stewards de l’a.s.b.l. Liège « Gestion Centre-Ville » sont présents dans les rues de la Cité ardente pour accomplir diverses missions. Ce métier est avant tout un travail de proximité. Ils collaborent régulièrement avec les différents acteurs de la ville (Echevinats, Police, etc.), fournissent une aide précieuse aux commerçants et produisent un sentiment de sécurité par leur présence dans les rues du centre.
Leurs fonctions auprès du public sont d’aider, d’écouter et de renseigner.

INFOS PRATIQUES:
Permanence touristique et Espace d’expositions
La permanence touristique à l’Arvô, est située place Saint-Georges 30 – 4830 Limbourg.
Ouverture: les week-ends et jours fériés de 12h à 17h à partir du 03 avril jusqu’au 26 septembre 2021.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Sandra Huberty, Présidente Syndicat d’Initiative, au 0494/59.55.91
Isabelle Erkens, Service Tourisme de la ville de Limbourg, au 0473/60.60.86
L’espace d’exposition “Espace Arvô” est situé place Saint-Georges 30 (1er étage) – 4830 Limbourg.
Ouverture : du mercredi au vendredi de 14h00 à 18h00
les week-ends et jours fériés de 13h00 à 18h00
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Anne Dedoyard au 0474/64.47.55
Accès
- Un parking pratique se situe Hors-les-Portes, 4830 Limbourg. Une zone de parking est possible dans le Thier de Limbourg
- En voiture – Google maps + possibilité de créer son itinéraire
- En autocar : Autoroute E42– Sortie 6 Verviers-Sud Heusy Stembert – – Suivre Stembert (N625) – Limbourg – Aire d’accueil – Hors les Portes
- En train – Arrêt Dolhain-Gileppe, ligne directe vers Spa et Aachen, correspondance aisée vers Liège et Bruxelles (lien site SNCB)
- En bus – Ligne TEC n°724 et 725 de Verviers ou d’Eupen – Arrêt Dolhain – Place Léon d’Andrimont (lien site TEC)




Association ayant pour objet de promouvoir, diffuser la pensée, l’expression, la morale, la philosophie, l’enseignement et l’éducation laïques.

Maison de la métallurgie et de l’industrie de Liège
La maison de la métallurgie et de l’industrie de Liège est un musée de Liège retraçant l’histoire des industries et des techniques, articulée sur trois thèmes majeurs : métallurgie, énergies et informatique.
La maison de la métallurgie fait partie du réseau l’Embarcadère du Savoir, qui comprend l’Aquarium-Muséum, la maison de la science, les Espaces botaniques universitaires de Liège, l’ASBL Haute Ardenne, Hexapoda et la société astronomique de Liège.
Description
Elle présente notamment une grosse forge wallonne et un authentique ensemble sidérurgique des xviie siècle et xviiie siècle, le plus vieux haut-fourneau de Belgique (Gonrieux-lez-Couvin, 1693), mais également un four à zinc : la baignoire de voyage en zinc de Napoléon trône dans une des salles (voir Jean-Jacques Dony et Vieille-Montagne).
La salle consacrée à la sidérurgie moderne rappelle les différentes étapes de la fabrication de la tôle d’acier.
La maison de la Métallurgie et de l’Industrie est installée dans l’ancienne usine Espérance-Longdoz fondée dans le quartier de Longdoz en 1846 par D. Dothée pour le laminage du fer et la fabrication du fer-blanc. Seul l’actuel bâtiment du musée subsiste de l’ancienne usine.

La maison de la science de Liège propose une série de démonstrations, de vitrines automatisées dont le but est de faire découvrir les sciences en s’amusant. Elle met en évidence concrètement les applications des découvertes faites en biologie, en chimie et en physique.
Description
Elle présente notamment des expériences sur l’électricité (cage de Faraday), l’azote liquide, la musique, la mécanique ou encore l’optique.
Un salon de la « Belle Époque » présente d’anciens appareils correspondants aux techniques de pointe en 1900 afin de montrer les prodigieux progrès de la science.
La maison de la science fait partie de l’Embarcadère du Savoir.
Bâtiment
La maison de la science de Liège occupe une partie de l’aile droite d’un des instituts Trasenster, l’institut de zoologie. Construit en 1885, le bâtiment est l’œuvre de l’architecte liégeois Lambert Noppius.

La Maison du Jazz est à la fois un centre de documentation, d’animation et de promotion du jazz.

Centre de documentation, d’animation et de promotion sur le Jazz


Aux frontières des Pays-Bas et de l’Allemagne, dans l’entre-Vesdre-et-Meuse, le Pays de Herve révèle un pays de bocages, haies et vergers, étoffé d’un patrimoine remarquable !
Douze communes forment donc désormais le territoire de la Maison du Tourisme du Pays de Herve : Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Visé et Welkenraedt.
Le Pays de Herve… c’est cette contrée située entre-Vesdre-et-Meuse, au cœur de l’Euregio Meuse-Rhin et du triangle Aachen-Liège-Maastricht. Au-delà d’une situation géographique privilégiée, 450 km2 de bocages, haies et vergers hautes-tiges composent un paysage rural d’exception.

L’Office du tourisme de Liège, première porte d’entrée sur la ville et son patrimoine, vous ouvre ses portes tous les jours. Vous y trouverez toute l’information nécessaire à un séjour agréable et enrichissant dans la région liégeoise. En plus de conseils personnalisés, brochures, espace numérique et espace détente, vous y découvrirez également tout un panel d’activités telles que des visites guidées, des applications ludiques, un service de location de vélos et de trottinettes, boutique de souvenirs…Tout beau séjour à Liège commence par l’Office du tourisme.

Le Pays de Vesdre (et ses communes partenaires Baelen, Dison, Limbourg & Verviers).

Explorez les Terres-de-Meuse le temps d’une escapade, d’un week-end ou pour un plus long séjour.

Malmundarium, espace touristique culturel de Malmedy
Le Malmundarium est un musée de la ville belge de Malmedy (province de Liège).
Situation
Il occupe l’ancien monastère de Malmedy qui, avec l’abbaye de Stavelot, était le siège de la principauté épiscopale de Stavelot-Malmedy. Il se trouve au centre de Malmedy sur la place du Châtelet à côté de la cathédrale.
Description
Cet espace touristique et culturel inauguré le 4avril2011 d’une capacité de 3 000 m2 répartis sur deux niveaux regroupe plusieurs thèmes chers à l’histoire de la ville de Malmedy :
- l’atelier du cuir retrace l’histoire des tanneries présentes à Malmedy d’au moins 1565 jusqu’à 1996.
- l’atelier du carnaval expose de nombreuses photographies, pièces et costumes représentants le cwarmê dont la 556e édition a eu lieu en 2014.
- l’atelier du papier décrit cette industrie encore présente au bord de la Warchenne depuis les environs de 1726.
- l’historium raconte l’histoire de la ville depuis sa fondation en 648 par Saint Remacle jusqu’aux épisodes sanglants de la Seconde Guerre mondiale.
- le trésor de la cathédrale voisine.
- plusieurs expositions sont organisées chaque année.
- une boutique présentant des ouvrages liés aux différents thèmes du musée ou des expositions.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter :

La MJ c’est : des ateliers, des stages, des activités, des événements et un accueil !


Le musée d’Ansembourg est le musée d’art décoratif de la ville de Liège. Le musée est installé dans l’hôtel d’Ansembourg situé en Féronstrée dans le cœur historique de la ville. La collection de mobilier du musée est une des plus importantes collections d’art mobilier de style Liège-Aix.
Historique
Le musée trouve son origine dans la fondation de l’Institut archéologique liégeois (IAL) le 4 avril 1850. Les collections archéologiques et d’arts décoratifs sont abritées successivement dans le palais des Princes-Évêques, à la Bibliothèque de l’Université et à l’Émulation, avant d’être hébergées dans le premier musée de l’IAL inauguré le 12 octobre 1874 dans une des ailes du Palais des Princes-Évêques.
En 1901, la ville de Liège et l’IAL acquièrent le Palais Curtius afin d’y installer les collections archéologiques, par la suite augmentées des collections d’arts décoratifs, qui devient le Musée Curtius (ces collections font aujourd’hui partie du Grand Curtius).
Le 12 février 1903, la Ville achète l’hôtel d’Ansembourg qui, après restauration, abrite depuis le 10 juillet 1905 le musée consacré aux arts décoratifs du xviiie siècle.
Collections
Collections d’art
Outre les salles d’époque, le musée possède une importante collection de peintures, dessins et sculptures du xviie, xviiie et xixe siècle des artistes Gérard de Lairesse, Nicolaas Verkolje, Jean-Baptiste Coclers, Théodore-Edmond Plumier, Englebert Fisen, Louis-Michel van Loo, Léonard Defrance, Jean Delcour et Louis-Félix Rhénasteine.
-
Théodore-Edmond Plumier, Portrait du prince Guillaume de Hesse (1720)
-
Englebert Fisen, Portrait de l’artiste avec sa famille (1722)
-
Léonard Defrance, Femmes buvant le café (1763)
-
Jean Delcour, Vierge à l’enfant
Meubles liégeois
Le musée Ansembourg possède une vaste collection de salle de meubles, lambris et boiseries du xviiie siècle, la plupart en chêne et presque exclusivement de fabrication liégeoise. C’est probablement la plus large collection de meubles de style Liège-Aix dans le monde.
Autres collections
Le musée possède une belle collection de tapisseries flamandes, diverses horloges anciennes, une collection de porcelaine et objets en verre du xviiie et xixe siècle, des objets en argent de fabrication liégeoise, un grand nombre d’ustensiles en cuivre, en étain et en bois et quelques instruments musicaux et jouets anciens.
-
Tapisserie du xviiie siècle
-
Horloge de Hubert Sarton
-
Porcelaine du xviiie siècle

C’est dans une chaleureuse et élégante demeure du XVIIIème siècle qu’on été installés les ensembles mobiliers des Musées; si chaque pièce mérite attention, le visiteur s’attardera peut-être plus spécialement devant de précieux «cabinets» d’ébène, incrustés d’ivoire, d’écaille, d’albâtre et de nacre. Leurs multiples petits tiroirs ont dû contenir autrefois maintes lettres et objets précieux !!
Une attention spéciale aussi pour trois pianos : le style Empire de deux d’entre eux les date du début XIXème (un des deux se retrouve sur un « Portrait de jeune fille » !), le troisième, daté de 1892, est le souvenir émouvant d’un de nos plus grands compositeurs, Guillaume Lekeu. Légués eux aussi par des familles verviétoises, quelques meubles liégeois sculptés d’excellente facture évoquent les intérieurs bourgeois d’antan
Autre legs : la collection de dentelles anciennes, admirée tout spécialement par les dentellières d’aujourd’hui, qui détaillent avec plaisir les différents points de dentelle aux fuseaux, à l’aiguille, d’application…Croirait-on de nos jours que les hommes, autrefois, en furent grands amateurs ?
On y trouve également des vestiges archéologiques préhistoriques ou romains découverts dans la région verviétoise
On ne peut évidemment oublier de rappeler aux petits et aux grands que Noël se fête au Musée, en participant au Bethléem verviétois, savoureuse tradition wallonne des Réveillons de nos aïeux.

Le Musée de l’Abeille est situé à l’arrière du Château Brunsrode à Tilff dans la commune d’Esneux (Province de Liège– Belgique).
Historique
La Confrérie du Grand Apier de Tilves, fondée en 1973, se veut l’ardent défenseur de l’abeille et de l’apiculture1. Le musée ouvre ses portes en 1974.
Situation
Le musée se trouve au centre de Tilff. Il occupe une dépendance du Château Brunsrode.
Description
Le musée est subdivisé en quatre sections :
- une section Exposition où sont rassemblés les objets anciens et modernes, locaux et internationaux utilisés en apiculture
- une section audio-visuelle où plusieurs montages illustrent l’activité des abeilles aux différentes périodes de leur vie
- une section vivante où deux ruches vitrées permettent d’observer le travail des abeilles
- une section scientifique où des collections d’insectes et de nids situent l’abeille domestique par rapport aux autres hyménoptères2
Un fichier de livres et de revues traitant de l’abeille et de l’apiculture sont mis à la disposition des visiteurs.
Visite
Le musée est ouvert tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 18 h en juillet et août et les samedis et dimanches de 14 à 18 h en avril, mai, juin et septembre.

Yvette Dardenne est buxidaferrophile : elle collectionne les boîtes métalliques illustrées. Elle en possède près de 60.000 originaires de tous les continents, et ce n’est pas fini ! Son imposante collection est à découvrir sur rendez-vous.
Prévoyez deux bonnes heures pour parcourir les allées des différents bâtiments qui abritent ce fabuleux trésor. Commencé par hasard, ce hobby s’est transformé, au fil des années et des acquisitions, en une passion dévorante dont témoigne même le Guiness Book des records.
Aujourd’hui, l’imposant patrimoine représente véritablement un pan de l’Histoire, par les sujets, les formes diverses ou l’utilisation qui en était faite, du XIXe siècle à nos jours. Tant et si bien que Yvette Dardenne est régulièrement sollicitée pour des expositions thématiques à travers le monde…
Yvette Dardenne est buxidaferrophile : elle collectionne les boîtes métalliques illustrées. Elle en possède près de 60 000 originaires de tous les continents, et ce n’est pas fini ! Son imposante collection est à découvrir sur rendez-vous. Prévoyez deux bonnes heures pour parcourir les allées des différents bâtiments qui abritent ce fabuleux trésor. Commencé par hasard, ce hobby s’est transformé, au fil des années et des acquisitions, en une passion dévorante dont témoigne même le Guiness Book des records. Aujourd’hui, l’imposant patrimoine représente véritablement un pan de l’Histoire, par les sujets, les formes diverses ou l’utilisation qui en était faite, du 19ème siècle à nos jours. Tant et si bien que Yvette Dardenne est régulièrement sollicitée pour des expositions thématiques à travers le monde…
Uniquement sur réservation
- Langues de visite :
- Français
- Équipements/Services :
- Parking
- Cafétéria / Restaurant

« Grâce à ses vastes salles thématiques, ce musée vous plonge dans la nature spadoise. Chaque année est rythmée d’une exposition temporaire et d’une Chouette Enquête. La Chouette Enquête est un petit jeu de piste offrant aux familles la possibilité de découvrir le musée différemment. »


Musée de la lessive
Description
L’exposition remonte aux origines de la lessive (Antiquité) et retrace son évolution jusqu’à nos jours. Les avancées technologiques sont présentées grâce à une collection de documents, d’objets anciens, de machines en état de fonctionnement mais également en suivant l’histoire du savon jusqu’aux poudres à lessiver.
En plus de l’aspect technique proprement dit, la visite propose d’aborder l’aspect socioculturel qui y est lié (hygiène, conditions de vie et de travail, rareté des biens de consommation…).
Expositions temporaires
En plus de l’exposition permanente, le musée propose régulièrement une exposition temporaire sur un sujet, avec la lessive comme fil conducteur (Bulles de lessive dans la BD, La lessive dans l’imagerie populaire, L’enfant et la lessive…).
Organisation
L’équipe du musée est composée d’une vingtaine de membres bénévoles. Ceux-ci s’occupent de la collecte des documents et objets exposés mais également de l’animation des visites.
Notre musée propose un voyage dans le temps à la découverte de l’évolution du savon, des techniques de blanchissage du linge et de la vie des lavandières.


Château de Raeren
Le château de Raeren (ou Burg Raeren) est un Wasserburg ( « château fort d’eau ») érigé à Raeren, où est établi un musée de la poterie, lequel grâce à sa collection de grès de Raeren a le statut de patrimoine européen.
Description
Fier et immuable, le Château de Raeren veille sur le village. Insolite d’exposer des objets fragiles derrière des murs si épais! En effet, le château abrite le musée de la poterie, cet art dont d’innombrables exemplaires ont été exportés dans le monde entier du 14ème au 19ème siècle. Plus de 2.000 pièces exposées expliquent l’étymologie de la poterie.
Fiers, les artisans de l’époque n’y allaient pas avec le dos de la cuillère! Jan Emens Menneken, le potier le plus célèbre de Raeren, enjoliva vers 1570-80 des chopes à bière de dictons truculents : à voir dans une des vitrines. Des céramiques contemporaines de l’Eurégio Meuse-Rhin et d’ailleurs s’y côtoient et révèlent la corrélation historique et culturelle jusqu’à nos jours.
Horaires d’ouverture
| lun. | – |
|---|---|
| mar. | 10h00 à 17h00 |
| mer. | 10h00 à 17h00 |
| jeu. | 10h00 à 17h00 |
| ven. | 10h00 à 17h00 |
| sam. | 10h00 à 17h00 |
| dim. | 10h00 à 17h00 |

Inauguré le 24 mai 1964, le musée relate en quelques séquences la longue et difficile histoire de la célèbre chaussée Charlemagne. Le musée de la Route classé dans les musées insolites (musée en plein air), se situe dans l’angle de la façade actuelle de l’Hôtel de la Couronne, en bordure de la route. Il se compose de 6 bandes de terrain, sur lesquelles sont reconstitués les revêtements routiers des différentes époques de notre histoire. La première route présentée est bien évidemment une chaussée romaine. Suivent alors les revêtements routiers à l’époque de Charlemagne, de Notger, de Marie-Thérèse, de Napoléon et d’Albert Ier.

Musée de la Vie rurale (Xhoris)
Le Musée de la Vie rurale est situé au n° 34 de route de Hamoir à Xhoris dans la commune de Ferrières (Province de Liège– Belgique).
Pour plus d’infos, veuillez consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Vie_rurale_(Xhoris)

Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne administration communale de Tihange. Il est composé de six salles représentant la cuisine de nos grands-parents, une classe d’école primaire du début du siècle ou encore une fonderie de cloches. Elles abritent des œuvres d’artistes et d’écrivains du village.
On y trouve des outils, des objets, des maquettes, tous relatifs aux thèmes abordés dans chacune des salles.
Le visiteur replonge ainsi dans l’ambiance de la vie d’autrefois.
Des expositions temporaires d’objets rares et/ou curieux ont lieu régulièrement.

Musée de la vie wallonne
Le musée de la vie wallonne a été fondé en 1913. C’est l’un des plus riches musées d’ethnologie de la Région wallonne, il est situé dans le cadre de l’ancien couvent des mineurs de Liège. Si ses collections rassemblent tout ce qui a fait et fait encore la vie en Wallonie, il offre, à travers son parcours, un regard original et complet sur ce que sont la Wallonie et ses habitants, du xixe siècle à aujourd’hui. Un théâtre de marionnettes y donne vie à Tchantchès, à Charlemagne, à Nanesse, à Roland et aux personnages du répertoire traditionnel liégeois.

Musée de la ville d’eaux
Historique
En 1894, appelé Musée communal de Spa, il partage ses locaux avec l’École des Beaux-Arts, à côté de l’ancienne poste, à l’angle de la rue Servais à Spa1.
Dès 1942, le Musée communal s’installe au Waux hall où il cohabite avec l’orphelinat de la ville.
Depuis 1965, il est situé dans la partie centrale de la Villa royale, cet espace muséal comprend plusieurs collections. L’exposition permanente compte quelque 300 objets dits Jolités de Spa ou en bois de Spa2.
Expositions temporaires
Depuis 1965, le musée a organisé régulièrement des expositions temporaires, vous pouvez découvrir la liste de ces expositions sur le site officiel du musée 3,4.
Modalités pratiques
Le musée est fermé en période hivernale5. Différents itinéraires permettent de rejoindre le musée, avec le bus de la ligne 388 ou par le train de la ligne 44 de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
Patrimoine immobilier classé de Spa
Le musée, situé dans l’ensemble formé par la villa royale et ses abords immédiats, fait partie du patrimoine immobilier classé de Spa, suivant un arrêté du 27 septembre 1972, sous le numéro d’inventaire 63072-CLT-0006-016.
Le 7 janvier 1994, certains éléments de la villa royale, sont aussi inventoriés (no 63072-CLT-0007-01)7 :
- les façades avant des trois bâtiments ;
- les façades donnant sur la cour des deux ailes latérales ;
- les galeries couvertes reliant les bâtiments entre eux ;
- les toitures des trois bâtiments ;
- le lampadaire en fonte de la cour rectangulaire.
Le périmètre définissant cet ensemble peut être visualisé sur Google Earth sous le code 63072-CLT-0006-01-GOOG-01-018. Une galerie de photos peut être consultée sur le Portail de la Wallonie9.

Le musée December 44 est dédié aux combats qui se sont déroulés durant l’hiver 44 sur la commune de La Gleize pendant la bataille des Ardennes.

Musée des Beaux-Arts de Liège
Le musée des Beaux-Arts de Liège ou BAL était un musée liégeois qui a ouvert en 2011 et fermé ses portes le 28 février 2016 à la suite de l’ouverture de La Boverie. Il était situé dans le quartier Féronstrée et Hors-Château dans un bâtiment construit entre 1975 et 1980 sur des plans de l’architecte Henri Bonhomme.
Historique
Créé en 1903, le musée des Beaux-Arts de Liège était logé dans un bâtiment annexe de l’Académie royale des beaux-arts de Liège, rue des Anglais ; il disparaît dans les années 1970, lorsque ses collections d’art moderne et d’art contemporain sont déménagées dans le palais des beaux-arts construit dans le parc de la Boverie lors de l’Exposition universelle de 1905: le musée suivant était baptisé MAMAC.
Les collections d’art wallon étaient rassemblées depuis 1952 dans le musée de l’Art wallon, hébergé de 1952 à 1980 dans le bâtiment du parc de la Boverie. Le musée de l’Art wallon s’installe de 1980 à 2011 dans le complexe construit dans le quartier Féronstrée et Hors-Château par l’architecte Henri Bonhomme.
Fin 2011, le musée des Beaux-Arts de Liège ressuscite à la suite du projet de transformation du palais des beaux-arts qui accueille un nouveau musée : La Boverie. Les collections du MAMAC, du Fonds ancien, du cabinet des Estampes et des Dessins et du musée de l’Art wallon sont rassemblées en une seule entité appelée musée des Beaux-Arts de Liège ou BAL (Beaux-Arts Liège)1, installé dans les locaux de l’ancien musée d’Art wallon.
Le 28 février 2016, le musée des Beaux-Arts ferme ses portes et l’ensemble des collections sont transférées à La Boverie.
Collections
Historique
Les collections rassemblées au musée des Beaux-Arts provenaient de trois entités distinctes jusqu’en 2011 :
Musée de l’Art wallon
Les collections du musée de l’Art wallon de la ville de Liège présentent diverses peintures et sculptures d’artistes de la Communauté française du xvie au xxe siècle.
On y retrouve notamment pour les xvie au xviiie siècles des œuvres de Lambert Lombard, Jean Del Cour et Jean Varin.
Pour le xixe siècle, les sculptures, du Liégeois Léon Mignon, du Hennuyer Victor Rousseau, le xxe siècle vit s’affirmer de nouvelles tendances telles que l’abstraction, l’expressionnisme ou le surréalisme.
Musée d’art moderne et d’art contemporain
La collection de l’ancien musée d’Art moderne et d’Art contemporain — près de 700 œuvres — permet d’apprécier l’évolution de la peinture et de la sculpture depuis la genèse de l’art moderne (vers 1850) jusqu’aux tendances contemporaines.
L’accent est mis sur les écoles belges et françaises. Corot, Eugène Boudin annoncent l’impressionnisme français (Monet, Pissarro, Guillaumin, Signac) et belge (Claus, van Rysselberghe, Heymans). Le symbolisme (Fernand Khnopff), le fauvisme (Othon Friesz, Marquet, Vlaminck) côtoient l’expressionnisme belge (Permeke, Van den Berghe) et allemand (Franz Marc, Kokoschka). Les surréalistes belges (Delvaux et Magritte) complètent le panorama. Les œuvres exceptionnelles de Gauguin, Picasso, Chagall, Ensor renforcent la collection. Les années 1950–1960 sont principalement illustrées par l’abstraction française (Estève, Poliakoff, Magnelli, Mathieu, Vasarely, etc.) et le mouvement Cobra.
Cabinet des Estampes et des Dessins
Les collections d’œuvres sur papier du cabinet des Estampes et des Dessins de Liège atteignent quelque 40 000 pièces, estampes et dessins du xvie siècle à nos jours, pour la plupart des œuvres d’artistes liégeois, mais aussi d’artistes des écoles allemande, flamande, française, hollandaise et italienne. Ce fonds important s’est constitué au fil du temps par des achats de la Ville de Liège, mais aussi grâce à de nombreux legs et dons d’artistes. La majeure partie des œuvres antérieures au xixe siècle provient de la collection du chanoine Henri Hamal, dernier maître de chapelle de la cathédrale Saint-Lambert et grand collectionneur. Le legs Ulysse Capitaine représente 2 000 pièces dont des vues et plans anciens de Liège.
Donateurs
- Paul Dony
- Baron Fernand Graindorge
- Henri Hamal
- Désiré Jaumain – Ada Jobart
- Louis-Pierre Saint-Martin
Œuvres
Les œuvres reprises dans ces listes font partie des collections du musée des Beaux-Arts de Liège ; certaines d’entre elles sont susceptibles de ne pas être exposées en permanence.
xvie siècle
- Henri Blès
- Paysage, huile sur bois.
- Paysage avec la rencontre sur le chemin d’Emmaüs, huile sur bois.
- Galères et bâtiments de guerre dans un estuaire montagneux, huile sur bois.
- Lambert Lombard,
- Saint Denis refusant de sacrifier au dieu inconnu (avers), huile sur bois.
- Autoportrait, huile sur bois.
xviie siècle

Gérard de Lairesse, Orphée et Eurydice ou La Descente d’Orphée aux enfers, vers 1662
- Jean-Guillaume Carlier
- Autoportrait, huile sur bois.
- Saint Jean Baptiste endormi dans une grotte, huile sur toile.
- Gérard Douffet
- Vénus dans la forge de Vulcain, huile sur toile, 1615.
- Portrait d’homme, huile sur toile.
- Portrait de femme, huile sur toile.
- Gérard de Lairesse
- Orphée aux Enfers, huile sur toile, vers 1662.
- Judith, huile sur toile.
- Sainte Cécile, huile sur toile.
- Bertholet Flémal, Autoportrait, huile sur toile.
xviiie siècle
- Léonard Defrance
- Portrait du chanoine Hamal, huile sur toile.
- Visite à la manufacture de tabac, huile sur bois.
- Scène de rue, huile sur bois.
- La Houillère, huile sur bois.
- Paul-Joseph Delcloche, La famille du comte de Horion, grand mayeur de Liège, huile sur toile.
- Nicolas Henri Joseph de Fassin
- Les quatre points du jour. Le matin, huile sur toile, 1802.
- Les quatre points du jour. Le milieu du jour, huile sur toile, 1797.
- Les quatre points du jour. Le crépuscule, huile sur toile, 1797.
- Les quatre points du jour. Le soir, huile sur toile, 1797.
- Théodore-Edmond Plumier, Portrait du prince Guillaume de Hesse, huile sur toile, 1720.
xixe siècle

Antoine Wiertz, Rosine à sa toilette
- Jean-Joseph Ansiaux, Évocation de la Paix, huile sur toile, 1795.
- Eugène Boudin, Trouville, scène de plage, huile sur toile, 1884.
- Hippolyte Boulenger
- Horizon (Lisière de forêt), huile sur toile.
- Les Lavandières, huile sur toile.
- Évariste Carpentier
- La Baignade interdite, 1877.
- La Laveuse de navets, huile sur toile, 1890.
- Mer du Nord, 1897.
- La Gardeuse de chèvres
- Les Canards
- Émile Claus, Le Vieux Jardinier, huile sur toile, 1885.
- Corot
- Franz Courtens : La Drève ensoleillée (1892).
- Émile Delperée, Portrait de la marquise de Péralta, pastel sur toile, 1892.
- François Joseph Dewandre, Buste de Marc Aurèle jeune, marbre, 1784.
- James Ensor, La Mort et les Masques, huile sur toile, 1897.
- Henri Evenepoel
- Le Bébé ou Le Jouet brisé, huile sur toile, 1895.
- La Dame au chapeau vert, huile sur toile, 1897.
- Foire aux Invalides, huile sur toile, 1897.
- Promenade du dimanche au Bois de Boulogne, 1899.
- Théodore Fourmois, Paysage à Rahier, huile sur toile.
- Louis Gallait, François Ier au chevet de Léonard de Vinci, huile sur bois, 1857.
- Armand Guillaumin, L’Écluse du Moulin Bouchardon, à Crozant, après 1892.
- Jean-Auguste Dominique Ingres, Bonaparte, Premier Consul, huile sur toile, 1804.
- Fernand Khnopff, Portrait de Mme Edmond Khnopff, 1885.
- Jean-Baptiste Madou, Cartomancienne, huile sur bois, 1862.
- Xavier Mellery, Intérieur dans l’île de Marken, huile sur toile, 1878.
- Constantin Meunier
- Mineurs, huile sur toile.
- La Coulée à Ougrée, huile sur toile.
- Claude Monet, Le Bassin du Commerce. Le Havre, huile sur toile, 1875.
- François-Joseph Navez, Portrait d’un jeune couple, huile sur toile.
- Jean-Mathieu Nisen, Portrait du procureur général Raikem, huile, sur toile, 1880.
- Léon Philippet
- Michelina Gismondi, huile sur toile, 1876.
- Fillette, huile sur toile, 1877.
- Carnaval à Rome, huile sur toile.
- Félicien Rops, Le rocher des Grands malades, huile sur toile, 1876.
- Henri-Joseph Rutxhiel, André Grétry, buste en marbre.
- Théo van Rysselberghe
- Les Sœurs du peintre Schlobach, 1884.
- La Dame en blanc – Portrait de Mme Théo Van Rysselberghe, huile sur toile, 1926.
- Paul Signac, Le Château de Comblat, 1887.
- Charles Soubre, Le Départ des volontaires liégeois pour Bruxelles, 4 septembre 1830, huile sur toile, 1878.
- Alfred Stevens
- La Parisienne japonaise, huile sur toile, 1872.
- Le sommeil de l’enfant, huile sur bois.
- Eugène Verboeckhoven, Vaches à l’abreuvoir, huile sur bois, 1856.
- Barthélemy Vieillevoye
- Botteresses agaçant un braconnier, huile sur toile, 1836.
- Un épisode du sac de Liège par Charles le téméraire en 1468, huile sur toile, 1842.
- L’Assassinat de Sébastien Laruelle, bourgmestre de Liège, huile sur toile, 1851.
- Guillaume Vogels
- La Rue Sainte-Catherine, huile sur toile.
- Les Huîtres.
- Antoine Wiertz, Rosine à sa toilette, huile sur toile.
- Adrien de Witte
- Portrait de femme au corsage noir, huile sur toile, 1873.
- Coin d’atelier, huile sur carton, 1876.
- La Lessiveuse, 1879.
- Femme au corsage rouge, huile sur toile, 1880.
xxe siècle

Richard Heintz, La Roche noire, 1905.

Auguste Donnay, Jardin sous la neige.

Franz Marc, Chevaux au pâturage, 1910
- Pierre Alechinsky, Le Dragon triste, acrylique sur toile.
- Mady Andrien, Jeux d’enfants, sculpture en polyester.
- Émile Berchmans,
- Jeunesse, huile sur toile, 1902.
- La Fuite irréparable du temps, huile sur toile.
- Pol Bury, Carré et disques – 3 découpes en rouge, xylographie.
- Pierre Caille, À la recherche d’une issue, gouache sur papier, 1969.
- Gustave Camus, Retour de pêche, huile sur toile.
- Anto Carte
- Les Archers de saint Sébastien, aquarelle sur carton, 1920.
- Les Aveugles, huile sur toile, 1924.
- Marc Chagall, La Maison bleue, huile sur toile, 1920.
- Paul Charavel, Nature morte au violon, huile sur toile.
- Émile Claus, Le Châtaignier, huile sur toile, 1906.
- Jo Delahaut
- Plain-chant, huile sur toile, 1957.
- Espace blanc 83, huile sur toile.
- Paul Delvaux
- L’homme de la rue, huile sur toile, 1940.
- La mise au tombeau, huile sur toile, 1953.
- Eugène Dodeigne, Ah! Ce sont mes mains, fusain sur papier.
- Auguste Donnay
- La Fuite en Égypte, huile sur toile.
- Jardin sous la neige, huile sur carton.
- Esquisse, huile sur carton.
- Maurice Estève
- Fernand Flausch, Grand « X », tableau lumineux, plexiglas et aluminium, vers 1984.
- Léon Frédéric, L’Enterrement du paysan, huile sur toile, 1905.
- Othon Friesz, Le Port d’Anvers, 1906.
- Paul Gauguin, Le Sorcier d’Hiva Oa ou Le Marquisien à la cape rouge, huile sur toile, 1902.
- George Grard
- Plénitude, bronze, 1947.
- Fillette aux tresses, bronze.
- Jane Graverol, La Goutte d’eau, huile sur toile, 1964.
- Richard Heintz
- La Roche Noire à Sy, huile sur toile, 1905.
- Le Palais des doges à Venise, huile sur toile, 1908.
- Brouillard et givre, huile sur toile, 1927.
- La Roche Noire, huile sur toile, 1928.
- Marie Howet, Paysage d’Irlande, aquarelle sur papier.
- Oskar Kokoschka, Monte Carlo, 1925.
- Eugène Laermans, Les Intrus, 1903.
- Marie Laurencin, Portrait de jeune fille, 1924.
- Georges Le Brun, Dans un presbytère, pastel sur papier.
- Albert Lemaître
- Venise. Vue de l’Abbazia Deserto, huile sur toile, 1912.
- Le Bateau rouge, huile sur toile, 1919.
- Jules Lismonde, Clementina I, fusain sur papier, 1965.
- Max Liebermann, Le Cavalier sur la plage, huile sur toile, 1904.
- René Magritte
- La Forêt, huile sur toile, 1926.
- La Vérité dans son bouquet de jasmin, dessin, 1955.
- À la recherche de l’absolu, huile sur toile, 1960.
- Auguste Mambour
- Portrait de Madame D., huile sur toile, 1924.
- Nu de fer, huile sur toile, 1933.
- La Guadeloupe, béton polychrome.
- Franz Marc, Chevaux au pâturage, tempera sur papier, 1910.
- Albert Marquet, Le Quai du Havre, 1934.
- Léon Navez, Femme à la colombe, huile sur toile.
- Jules Pascin, Le déjeuner, huile sur toile, 1923.
- Pierre Paulus,
- Le Mineur, huile sur toile, 1936.
- Au pays noir (Effet de neige), huile sur toile.
- Constant Permeke, Les Époux, huile sur toile, 1932.
- Pablo Picasso, La Famille Soler, huile sur toile, 1903.
- Maurice Pirenne, Les Pommes de terre, huile sur toile, 1937.
- Camille Pissarro, Le Louvre, printemps, huile sur toile, 1901.
- Serge Poliakoff
- Armand Rassenfosse
- Femme se lavant, huile sur bois, 1919.
- Femme au bonnet, huile sur toile.
- Félix Roulin, Aile d’Icare, sculpture en aluminium et bronze, 1985.
- Victor Rousseau
- Les Béatitudes, plâtre, 1905.
- Eugène Ysaÿe, buste en marbre blanc, 1916.
- Constantin Meunier, buste en bronze.
- Edgar Scauflaire, Le Pain de ménage, huile sur bois, 1949.
- Paul Sérusier, Bords de mer, 1914.
- Jakob Smits, Grande maternité rouge, huile sur toile, vers 1924.
- Rodolphe Strebelle, Nature morte, huile sur toile, 1949.
- Antoni Tàpies
- Raoul Ubac, Le Signe de la faux, estampe, 1979.
- Maurice Utrillo, Le moulin de la Galette, 1922.
- Kees van Dongen, La Violoniste, vers 1922.
- Suzanne Valadon, Nature morte aux fleurs et fruits, 1930.
- Victor Vasarely
- Claude Viallat
- Maurice de Vlaminck
- Rik Wouters
- Femme au bord du lit, huile sur toile, 1912.
- L’Homme au chapeau de paille, huile sur toile, 1913.
- Léon Wuidar, Passage étroit, huile sur toile, 1978.
-
Paysage avec pèlerins d’Emmaüs (Herri met de Bles, ca. 1525-50)
-
Portrait du bourgemestre Hubert du Château (Théodore-Edmond Plumier, ca. 1710-30)
-
Foire aux Invalides (Henri Evenepoel, 1897)
-
Le Cavalier sur la plage (Max Liebermann, 1904)
-
Femme au bord du lit (Rik Wouters, 1912)
Biens classés
Le musée comptait 18 biens classés au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
| Catégorie | Sous-catégorie | Nom du bien | Datation | Illustration |
|---|---|---|---|---|
| Beaux-Arts | Peinture | Ensemble des 9 peintures dit de « la vente de Lucerne de 1939 » :1. La maison bleue, Marc Chagall, 1920 Provient de la Kunsthalle de Mannheim (Allemagne) 2. La Mort et les Masques, James Ensor, 1897 3. Le sorcier d’Hiva-Oa ou Le Marquisien à la cape rouge, Paul Gauguin, 1902 4. Monte-Carlo, Oskar Kokoschka, 1925 5. Portrait de jeune fille, Marie Laurencin, 1924 6. Le cavalier sur la plage, Max Liebermann, 1904 7. Les chevaux bleus ou Chevaux au pâturage, Franz Marc, 1910 8. Le déjeuner, Jules Pascin, 1923 9. La famille Soler, Pablo Picasso, 1903 |
||
| Beaux-Arts | Peinture | Promenade du dimanche au Bois de Boulogne de Henri Evenepoel | 1899 | |
| Beaux-Arts | Peinture | Mariage mystique du bienheureux Herman-Joseph (hors encadrement), Jean-Guillaume Carlier | c. 1670–1675 | |
| Beaux-Arts | Peinture | La forêt (hors encadrement), René Magritte | 1927 | |
| Beaux-Arts | Peinture | Bonaparte, Premier Consul (hors encadrement), Jean-Auguste-Dominique Ingres | 1804 | |
| Beaux-Arts | Peinture | Le Bassin du Commerce, Claude Monet | c. 1874 | |
| Beaux-Arts | Peinture | L’homme de la Rue (hors encadrement), Paul Delvaux | 1940 | |
| Beaux-arts | Peinture | Orphée aux enfers (hors encadrement), Gérard de Lairesse | 1662 | |
| Beaux-Arts | Peinture | Ensemble de deux portraits (hors encadrement), Gérard Douffet | c. 1625–1630 | |
| Beaux-Arts | Peinture | Femme au corset rouge (hors encadrement), Adrien de Witte | 1880 |

La Compagnie Royale des Francs Arquebusiers Visétois est née en 1579 de la volonté des visétois.
Les collections du musée de la Compagnie Royale des Francs Arquebusiers illustrent l’évolution de l’arme à feu depuis les arquebuses et les mousquets du 16e siècle jusqu’au fusil Comblain. Un imposant râtelier d’armes d’hast ne manquera pas d’attirer l’attention du visiteur. De nombreux objets retracent les activités et les traditions de la Compagnie fondée en 1579 pour défendre la ville. Une panoplie complète d’outils de sapeurs, des mannequins portant des uniformes caractéristiques de la gilde, des médailles commémoratives, des souvenirs de la Première Guerre Mondiale.

Musée des transports en commun de Wallonie
Le Musée des Transports en commun est un musée de Liège présentant de nombreux véhicules tels que d’anciens tramways, trolleybus et autobus. Il est ouvert au public du premier mars au 30 novembre. Le week-end et les jours fériés, le musée est accessible à partir de 14 heures.
L’arrêt de bus « Hôtel de Police » situé à proximité est desservi par les lignes 4, 26 et 31 du TEC Liège-Verviers. Un parking pour automobiles et des râteliers pour vélos sont à la disposition des visiteurs.
Histoire
Le musée a été fondé à l’initiative d’associations d’amateurs en 1985 pour sauver de la destruction d’anciens tramways, trolleybus et autobus. Le musée est en effet géré par l’asbl Musée des Transports en Commun du pays de Liège.
Il présente une quarantaine de véhicules entièrement restaurés sur une superficie de plus de 3 500 m2, depuis les véhicules à traction chevaline, jusqu’aux tramways électriques, trolleybus et autobus, utilisés de 1875 à nos jours. On notera la présence de 3 tramways en provenance du réseau d’Aix-la-Chapelle.
Le musée présente aussi un ensemble de plaques de destinations anciennes, une série de vitrines montrant l’ancien matériel de réseau (éléments d’uniformes, monnayeurs…) ainsi qu’une série de modèles réduits de tramways ayant circulé dans le pays de Liège.
- tramways
-
Motrice 193 des Tramways Unifiés de Liège et extensions.
-
Motrice et remorque du tramway de Verviers.
-
Motrice des Tramways Est-Ouest de Liège et Extensions
- autres véhicules
-
Fourgonette Renault 4, véhicule de service de la Société des transports intercommunaux de Liège.
- autobus et trolleybus
-
Ford TT des Autobus SADAR (1922).
-
Trolleybus bidirectionnel Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (1938).
-
Mercedes O 3500 (1952) des Tramways unifiés de Liège et extensions et Leyland Olympic (carrosserie La Métallurgique, 1953) de la SNCV.
-
Van Hool AG280 (1981) Société des transports intercommunaux de Liège et Van Hool A508 (1991) d’Aix-la-Chapelle.

Musée du château fort de Logne
Découvrez l’histoire de ce site médiéval et admirez les incroyables objets de la vie quotidienne des seigneurs et des chevaliers du Moyen Âge au Musée du Château Fort de Logne !
Au pied du château, l’ancienne ferme la « Bouverie », bâtiment classé du 16ième siècle, accueille le musée du château qui évoque la période des chevaliers. Profitez de cette collection exceptionnelle issue des fouilles archéologiques qui ont mis à jour de nombreuses traces de la vie des mercenaires jusqu’à la destruction de la forteresse en 1521.
Des centaines d’objets, comme des écuelles en bois, pièces d’armement, étains, éléments de cuirs, cadran solaire portatif, vous racontent ainsi l’histoire des Lognards, de leurs grandes batailles jusqu’aux menus de tous les jours. Tous ces vestiges retrouvent leur signification grâce à la reconstitution d’une maison et de tombes mérovingiennes, d’une table et d’une cheminée médiévales, à la projection d’un film sur les fouilles du puits, mais aussi à la modélisation du Château Fort de Logne avant sa destruction.
Visiter ce musée, c’est se laisser emporter par la richesse de cette époque trop souvent méconnue ! Déjà fascinés par cette visite, petits et grands pourront encore visiter les ruines du château, ses murailles et ses souterrains ou s’émerveiller devant des spectacles de fauconneries qui se déroulent sur le site. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette journée un moment inoubliable à vivre en famille !
Les visites du Château Fort et du Musée du Château étant complémentaires, un pass Château Fort de Logne + Musée du Château Fort vous est proposé.
Ces deux visites peuvent être réparties sur deux journées !
Des audioguides en 4 langues (FR – NL – ALL – GB) sont fournis gratuitement.
Une visite guidée est possible (FR – NL – GB) pour les groupes (min. 20 pers.) sur réservation.
Horaire
- Avril à juin : de 9 h à 17 h en semaine et de 14 h à 18 h 30 le week-end
- Juillet et août : de 10 h à 18 h 30 en semaine et de 13 h à 18 h 30 le week-end
- Septembre au 10 novembre : de 9 h à 17 h en semaine et de 14 h à 18 h 30 le week-end
- 11 novembre à mars : de 9 h à 17 h en semaine et fermé le week-end
Réservation obligatoire au 086/21 20 33 – infos@palogne.be
Minimum 20 personnes
- Langues de visite :
- Français
- Allemand
- Anglais
- Néerlandais
- Visites pour groupes :
- Visites groupes
- Visites guidées pour groupes sur demande
- Équipements/Services :
- Vestiaire
- WC
- Parking
- Parking Autocars
- Cafétéria / Restaurant
- Boutique
- Personnes à mobilité réduite :
- PMR (Autodéclaré)
| Tarifs | Min | Max |
|---|---|---|
| Tarif adulte | 6.50€ | 9.50€ |
| Tarif enfant | 5.00€ | 7.50€ |
| Forfait groupe | 18.00€ | 31.00€ |
- Château Fort + Musée : 6,50 € (ad.) / 5,00 € (enf. / < 14 ans) / 18 € (prix famille / 2ad. + 2 à 3 enfants)
- Château Fort + Musée + fauconnerie : 9,50 € (ad.) / 7,50 € (enf. / < 14 ans) / 31 € (prix famille / 2ad. + 2 à 3 enfants)
- Jeu de l’été : + 1 € / personne à la formule choisie
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.
L’entrée du Musée est gratuite le 1er dimanche du mois.
1 Rue de la Bouverie
- Langues parlées :
Le Musée du château fort de Logne est situé au sein de la ferme de la Bouverie dans le village de Vieuxville faisant partie de la commune de Ferrières (Province de Liège– Belgique).
Description
En réalité, ce musée expose les découvertes réalisées sur deux sites bien distincts du village de Vieuxville : le château fort de Logne et le cimetière mérovingien de Vieuxville.
- Le rez-de-chaussée présente les objets découverts sur le site du château fort de Logne situé à un kilomètre du musée. Et plus particulièrement, le résultat des fouilles réalisées dans le puits du château fort. Ce puits, entièrement comblé depuis plus de 480 ans, d’une profondeur de 56 mètres et de 2 mètres 50 de diamètre, a été systématiquement déblayé entre 1990 et 2003. Les restes d’une grande machine de levage en bois, des bols, des écuelles, des armes toujours munies de leurs poignées, un cadran solaire et beaucoup d’autres objets ont pris place dans les vitrines du musée. Un petit film explique la chronologie des fouilles de ce puits.
- Au premier étage, se trouvent de nombreux objets trouvés dans les 190 tombes du cimetière mérovingien de Vieuxville. Il s’agit principalement d’armes, de bijoux, de céramiques et surtout de verreries datant du ve siècle au viie siècle. Les reconstitutions de plusieurs tombes et d’une maison du vie siècle sont également visibles.
Visite
Le musée est ouvert du 1er avril au 11 novembre suivant les horaires en vigueur.

Description
Découvrez la prestigieuse histoire du Circuit de Spa-Francorchamps et les nombreux véhicules exposés
Blotti dans un écrin de verdure entre Stavelot, Malmedy et Spa, théâtre de tant d’exploits automobiles et motocyclistes, le circuit de Spa-Francorchamps est toujours considéré par de nombreux pilotes comme « le plus beau circuit du monde »
Dans les superbes caves voûtées de l’abbaye, le musée retrace la prestigieuse histoire du circuit. Des documents visuels inédits, des panneaux didactiques et une présentation sans cesse renouvelée de véhicules d’exception retracent la passion de la compétition, des pionniers à nos jours : Ferrari, March, Chevron, Porche, Cooper, …
La Formule 1, mais aussi les épopées des 24 heures motos et voitures, prennent ici une nouvelle dimension. Les « Demoiselles de Herstal » évoquent avec nostalgie les heures de gloire des industries liégeoises : FN, Gillet et Saroléa.
Une grande maquette et les consoles Playstation 4 rendent le circuit plus concret pour les amateurs.

Musée du jouet de Ferrières
Historique
Ce musée est ouvert depuis 1984 dans les anciens locaux de l’école des sœurs. Il a été principalement constitué par la collection de jouets anciens et insolites qu’un couple de Ferrusiens avaient patiemment rassemblés.
Situation
Le musée se trouve au centre de Ferrières à deux pas de la place de Chablis.
Description
Le musée présente plus de 1 000 jouets anciens choisis dans ses collections riches de plus de 8500 pièces et répartis dans 5 salles :
- Salle 1 : les jouets de fabrication belge
- Salle 2 : exposition bisannuelle :
- en 2013 et 2014, le thème est « Le cheval jouet remonte le temps ».
- en 2015 et 2016 : « Play & Mobiles ».
- en 2017 et 2018 : « En avant, marche! ».
- en 2019, 2020 et 2021 : « Tous en piste! ».
- Salle 3 : les jouets d’ici et d’ailleurs (France, Allemagne, États-Unis,…) et kiosque à expositions temporaires.
- Salle 4 : salle de jeux où les jeunes visiteurs peuvent jouer avec de véritables jouets anciens.
- Salle 5 : boutique du musée (jouets actuels pour tout âge, jeux d’occasion, documentation et souvenirs).
La plupart de ces jouets anciens datent de la fin du xixe siècle à 1950.
Il s’agit entre autres de jouets en bois, jouets artisanaux, jouets musicaux, jouets religieux, jouets mécaniques, jeux de société, trains, véhicules divers, poupées dont une à trois visages, maisons de poupées, ours en peluche, cuisinières, ustensiles de ménage, tirelires ou encore un manège musical.
Outre son rôle patrimonial et muséal, le Musée du Jouet de Ferrières a la volonté pédagogique d’accompagner les acteurs de l’éducation dans leur leçons et activités : visites guidées gratuites pour les écoles, location de valises pédagogiques aux enseignants (jouets anciens et dossiers pédagogiques), animations diverses (jeu de l’oie géant, jeu de village, jeux de table).
Nouveau en 2021 : Service de location de jeux anciens (1940-1980).
« De la poussière d’un grenier ou au fond d’un placard, les jouets qui surgissent, usés, brisés, détraqués ou miraculeusement préservés, nous fascinent. »

« De la poussière d’un grenier ou au fond d’un placard, les jouets qui surgissent, usés, brisés, détraqués ou miraculeusement préservés, nous fascinent. »


Le musée du terroir fut inauguré en 1999. Etabli dans une ancienne maréchalerie de 1638 au centre du village de Moresnet, il s’offre à la découverte de l’histoire, des activités d’antan ainsi que des divers aspects de la vie culturelle et sociale de Moresnet et de sa région.
Une exposition permanente traite de l’histoire (mouvementée) du viaduc ferroviaire depuis sa construction en 1914, en passant par ses destructions successives pendant la guerre 40-45, jusqu’à sa rénovation complète achevée en 2004.
Deux autres petites salles hébergent à l’occasion des expositions thématiques (par exemple sur les « vieux métiers » : menuisier, sabotier, forgeron, cordonnier et boucher).

Le musée en plein air du Sart Tilman est un musée de l’université de Liège. Fondé en 1977, il abrite une collection d’une centaine d’œuvres monumentales de plein air (sculptures et intégrations à l’architecture) sur les 700 hectares du domaine de l’université de Liège au Sart Tilman. Le musée en plein air du Sart Tilman est cogéré par l’université de Liège et la Communauté française de Belgique.
Histoire
L’origine du musée remonte au transfert de l’université de Liège en périphérie urbaine, sur la colline du Sart Tilman à la fin des années 1960. Les responsables académiques (emmenés par le recteur Marcel Dubuisson) et leurs architectes (Claude Strebelle, André Jacqmain, Pierre Humblet, Charles Vandenhove) confient dès les premières constructions à quelques artistes (Pierre Culot fut le premier en 1967) le soin d’établir des liens harmonieux entre les nouveaux bâtiments, l’environnement naturel et l’activité humaine qui s’y installe. L’implantation d’œuvres d’art dans le domaine de l’université s’inscrit dans une perspective plus générale : concilier l’expansion immobilière avec la préservation de la forêt et l’ouverture au public.
En 2017, à l’occasion du quarantième anniversaire du musée, l’oeuvre La mort de l’automobile de Fernand Flausch est dotée d’une fresque éphémère et un nouveau catalogue est édité1.
Collections
Centrées sur la sculpture et la peinture monumentales, les collections du musée en Plein Air du Sart Tilman illustrent, pour l’essentiel, la création contemporaine en Belgique francophone, représentée à la fois par des valeurs sûres (Eugène Dodeigne, George Grard, Pierre Caille, Serge Vandercam, Félix Roulin, Pierre Alechinsky, Léon Wuidar…). Le musée en Plein Air constitue aussi un terrain d’expérimentation pour des artistes plus jeunes, comme le montre la présence d’œuvres de Patrick Corillon, Gérald Dederen, Daniel Dutrieux, Jean-Pierre Husquinet, et Émile Desmedt. Avec les œuvres conservées au Centre hospitalier universitaire de Liège, la collection acquiert une dimension internationale : à la demande de l’architecte Charles Vandenhove, des créateurs comme Sol LeWitt, Niele Toroni, Claude Viallat, Jacques Charlier ou Daniel Buren sont intervenus dans les locaux de l’hôpital.
Artistes représentés dans la collection du musée en plein air
- Pierre Alechinsky
- Francis André
- Mady Andrien
- Élodie Antoine
- Olivier Bovy
- Daniel Buren
- Pierre Caille
- Jacques Charlier
- Georges Collignon
- Pierre Cordier
- Patrick Corillon
- Pierre Culot
- Michaël Dans
- Gérald Dederen
- Jo Delahaut
- Messieurs Delmotte
- Paul De Gobert
- Émile Desmedt
- Eugène Dodeigne
- Peter Downsbrough
- Daniel Dutrieux
- Ian Hamilton Finlay
- Fernand Flausch
- Florence Fréson
- Jean Glibert
- Paul Gonze
- George Grard
- Marie-Paule Haar
- Joseph Henrion
- Jean-Pierre Husquinet
- Idel Ianchelevici
- Nic Joosen
- Marin Kasimir
- Nicolas Kozakis
- Jean-Paul Laenen
- Charles Leplae
- Sol LeWitt
- Claire Mambourg
- Xavier Mary
- Jean-Pierre Ransonnet
- Lambert Rocour
- Félix Roulin
- Luis Salazar
- Michel Smolders
- Émile Souply
- Olivier Strebelle
- Tapta
- Niele Toroni
- Clémence Van Lunen
- Serge Vandercam
- Claude Viallat
- Antoine de Vinck
- Thomas Vinçotte
- Jean Willame
- André Willequet
- Rik Wouters
- Léon Wuidar
- Freddy Wybaux
Manifestations et événements
Le Musée en plein air organise régulièrement des manifestations et événements liés à l’art contemporain, à la sculpture et à l’intégration des œuvres d’art dans l’espace public.
- Prix de la jeune sculpture de la Communauté française de Belgique, en 1991, 1994, 1997, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017.
- Prix Triennal Ianchelevici, en 1997, 2000, 2007, 2010, 2014.
- Cycle « Artistes à l’hôpital » : Djos Janssens (2012), Jeanne Susplugas (2014), Patrick Corillon (2015), Sophie Langohr (2016)

Objets témoignant de l’activité industrieuse des artisans romains (couteaux, maillets, bijoux, …) retrouvés sur des sites gallo-romains à Berneau.

Ce musée est dédié à Albert Thys, ce dalhemois né en 1849. Attaché à la maison militaire du roi Léopold II, il devient adjoint au secrétariat de l’Association Internationale Africaine. A partir de 1885, il projette la construction d’une ligne ferroviaire au Congo pour relier la côte ouest à Léopoldville et en dirige ensuite la construction. En 1899, Thys fonde la Banque d’Outremer pour promouvoir l’installation d’entreprises à l’étranger, surtout en Afrique. Dalhem et Thysville/Mbanza-Nungu sont en partenariat depuis 2005.

Le musée Grétry est un musée de Liège consacré au compositeur André Ernest Modeste Grétry.
Situation
Ce musée, situé au no 34 de la rue des Récollets (en Outremeuse), est inauguré solennellement en présence du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth le 13 juillet 1913. Il est constitué d’un petit immeuble de style liégeois Louis XV agrémenté d’une annexe de même style. Cette demeure est la maison natale du compositeur André Ernest Modeste Grétry dont la statue trône en face de l’Opéra royal de Wallonie. L’immeuble fut la propriété d’une famille liégeoise, les Dubois-Desoer, jusqu’en 1859. À cette date, la famille décida d’en faire don à la ville de Liège.
La maison est alors restaurée afin de la restituer telle qu’elle existait en 1824 et effacer ainsi les transformations dues aux locataires successifs. L’immeuble abrite la collection Grétry rassemblée par Jean-Théodore Radoux, directeur du conservatoire royal de Liège.
Collections
Les multiples événements qui constituent la vie de Grétry sont évoqués à travers les collections du musée. Celles-ci sont réparties dans les différentes pièces de la maison qui ont gardé, chacune, leur vocation originelle. Partout, une iconographie présente Grétry à tous les âges et sous tous les aspects (cent vingt-cinq effigies dont quelques-unes rarissimes se répartissant en peintures, dessins, bustes, statuettes, médaillons, miniatures…). Plusieurs instruments de musique d’époque sont également présentés (piano-forte, piano « muet » de travail, violons, serpent, pochette « liégeoise »…). Le deuxième étage renferme une riche bibliothèque : partitions et livres de Grétry, musicien et penseur. Dans les vitrines alentour, des lettres autographes voisinent avec des ouvrages critiques ou biographiques relatifs à Grétry. Des expositions, concerts et conférences y sont régulièrement organisés.
Rénovation
De 2011 au 9 mars 2013, le musée est fermé au public en vue de profondes rénovations (toit, annexe, plancher, châssis, électricité et rénovation des collections dont le piano de Gretry)

Le Musée présente une trentaine de voitures anciennes toutes marques. Un stand réservé aux voitures Impéria et Vanguard prend une place importante avec 12 véhicules construits à Nessonvaux. La plus ancienne voiture Impéria exposée date de 1927 et possède le fameux moteur sans soupape (moteur qui a fait la renommée de la marque). Une Vanguard de 1951 est le témoin de cette période importante pour Nessonvaux. Plusieurs motos Adler sont exposées ainsi qu’une douzaine de motos toutes marques confondues. Lors de la balade de Fraipont (n°5), possibilité de faire une extension pour visiter ce Musée.
Bus 31 arrêt Pont de Fraipont.
A proximité de la gare SNCB de Fraipont (ligne Liège-Verviers).
Poussettes accetptées
ouvert du lundi au vendredi toute l’année de 14h à 17h
- Langues de visite :
- Français
- Réception de groupes :
- Groupes acceptés
- Visites pour groupes :
- Visites groupes
- Visites guidées pour groupes sur demande
- Équipements/Services :
- Parking
- Cafétéria / Restaurant
- Accès PMR :
- PMR (Autodéclaré)

Musée Postes restantes
Le musée Postes restantes est un musée belge consacré à l’histoire de la poste et de l’écriture. Situé à Hermalle-sous-Huy, le musée fut créé par une association sans but lucratif et géré par une petite équipe de bénévoles.
Genèse
Philatéliste dès l’âge de sept ans, l’Amaytois Armand Henrot (1926-2005) voue sa vie entière à la philatélie et à la Poste, étudiant non seulement les timbres-poste belges, français et luxembourgeois, mais aussi les marques postales figurant sur le courrier émis dans sa région natale, et collectionnant dans la dernière partie de sa vie des objets postaux.
À l’âge de 77 ans, il décide d’offrir sa collection d’objets de poste à l’asbl qui gère le Musée de la Gourmandise car le conservateur de celui-ci, Charles-Xavier Ménage, l’a fort aidé dans ses recherches.
Un musée nait donc en 2004, dans le site historique et touristique de la Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy où se trouvent déjà les Bibliothèque et musée de la Gourmandise. Son nom, Postes restantes, fait allusion au service « Poste restante » et au fait que la collection présente des objets restants de l’ancienne poste belge, les collections du Musée postal de Bruxelles ayant été dispersées un an plus tôt.
Collections
La collection d’A. Henrot est constituée de couvre-chefs de facteurs de différents pays, d’uniformes de facteurs et factrices, de cannes, sacoches, claquoirs, machines diverses, affiches postales (modernes).
Le musée développe peu à peu sa collection avec des cornets, enseignes postales, cachets, matériel de bureau de poste, intégrant également des objets contemporains dans l’optique de la conservation d’un patrimoine « à risque » – car la privatisation et la modernisation de la poste belge induisent la réduction radicale du nombre de bureaux de poste et la mise à la casse du matériel devenu superflu.
À ces objets s’ajoutent, dès la naissance du musée, ceux de l’écriture, rassemblés par une collectionneuse belge – l’idée de base étant que sans écriture, il n’y aurait pas eu de message ni par conséquent de poste – : Style, calame, plumes, porte-plumes et essuie-plumes, taille-plumes et taille-crayons, porte-mines, stylos, encriers, machines à écrire, à sténographier, etc. et aussi calligraphies du xviie au xixe siècle.
Visites guidées, bibliothèque et animations
Les guides privilégient le côté anecdotique de l’histoire de la poste et de l’écriture, ce qui rend la visite particulièrement attrayante. Mais l’aspect scientifique n’en est pas négligé pour autant et les recherches d’ouvrages relatifs à la poste ont permis la création d’un fonds géré par le conservateur de la Bibliothèque de la Gourmandise. Ce fonds est accessible sur demande écrite.
À la demande, pour les écoles et les groupes, le musée organise des animations en écriture et/ou art postal.
Histoire de la poste et de l’écriture
Sur le site internet de la Ferme castrale, dans les pages consacrées au Musée Postes restantes, une « Petite histoire de la poste et de l’écriture » est développée de deux en deux mois.
Expositions temporaires et prêts
Le musée présente une exposition thématique temporaire chaque année et prête des objets et documents à d’autres institutions culturelles.

Découvrez Visé et la Basse-Meuse au travers de tous ses patrimoines : archéologie, architecture, histoire, vie quotidienne, guerres et célébrités.
Il s’agit d’un ancien couvent de style Renaissance mosane reconstruit après 1918.
Différentes thématiques sont abordées :
- Archéologie : préhistoire, époques gallo-romaine et mérovingienne, époque moderne
- Histoire : ville médiévale, châteaux, architecture, dynastie, guerres du 20e siècle, objets militaires
- Folklore : gildes de Visé, anciens métiers, oies, les artistes locaux
Des projections audio-visuelles sont disponibles sur Visé sur demande, ainsi qu’un circuit en car accompagné d’une vidéo sur le 17e siècle, la Première Guerre Mondiale, le patrimoine rural et les découvertes archéologiques.
Possibilité d’effectuer un parcours mémoriel 14-18 en ville et au musée
Durée : 1h30
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 16h
Portes ouvertes chaque premier dimanche des mois de février à décembre (14h à 17h)
Les expositions présentées à la Chapelle des Sépulcrines sont accessibles de 14h à 17h
Durée : 30 à 90 min
- Langues de visite :
- Français
- Néerlandais
- Réception de groupes :
- Groupes acceptés
- Nombre de personnes minimum 10
- Nombre de personnes maximum 30
- Visites pour groupes :
- Visites groupes
- Visites guidées pour groupes sur demande
- Équipements/Services :
- Parking

Tchantchès, parfois écrit Tchantchèt, est un personnage issu du folklore liégeois représenté par une marionnette.
Origine folklorique de la marionnette liégeoise
Au début du xixe siècle, on attribua souvent de manière erronée l’origine de la marionnette liégeoise à un Sicilien (en réalité Toscan) nommé Conti qui établit en Outremeuse un théâtre de marionnettes de type sicilien2 ou marionnettes à tringle unique en 1854. Cette fausse paternité vit le jour après la guerre 40 donnant vérité à un roman de Dieudonné Salme (wa) : « Li Houlot » car nul ne sait réellement d’où proviennent ces marionnettes. Ce qui est certain c’est que d’après d’autres écrits on retrouve des traces des marionnettes liégeoises avant l’arrivée de ce fameux Conti. Certains journalistes, ayant enquêté sur le sujet tels qu’Alexis Deitz ou Auguste Hock, parlent d’un premier théâtre sédentaire avec ce type de marionnettes en 1826 dans le quartier d’Outremeuse.
Dans ces théâtres, on jouait tous les écrits populaires du xixe siècle. En particulier les romans de chevalerie de la « collection Bleue » des éditions Larousse, mettant le plus souvent en prose, les chansons de geste du Moyen Âge liées au preu Charlemagne. Dans les entre-scènes intervenait un personnage que l’on avait nommé Tchantchès. Le public liégeois, surtout dans les milieux ouvriers, réclama à corps et à cris tant et si bien que de l’entre-scène il entra dans les scènes et devint contemporain de Charlemagne. Et comme à l’époque certains romantiques voulaient absolument faire naître Charlemagne en région liégeoise, Tchantchès n’eut vraiment pas à se déplacer beaucoup pour rencontrer le grand personnage.
Origine du nom
D’après Maurice Piron entre autres, linguistiquement, Tchantchès viendrait de « petit Jean » en flamand (Jantches) prononcé à la wallonne (D’jan tchès).
De nombreuses orthographes de son nom (Chanchet, Tchantchet, Jantches, Jeanches…) se retrouvent, notamment dans des registres de mines ou dans des journaux populaires d’époque ; et pour cause, le wallon s’écrivait comme il se prononçait, sans aucune orthographe, jusque dans les années 1950.
Ce n’est qu’avec Jean Haust qui fixe l’orthographe wallonne que Tchantchès s’écrira avec « ès » final, orthographe apposée sur le monument de Joseph Zommers érigé en 1937 en Outremeuse, au détriment du « èt » plus populaire.
C’est à cette même époque que les politiciens liégeois s’occupant de la culture dans la fin des années 1950 décideront très officiellement que la signification de Tchantchès viendrait d’une altération enfantine de « François » en bon wallon, bien que dans la littérature liégeoise François se traduise par Françwès.
Le personnage
Le personnage ainsi appelé est une figure folklorique et emblématique de Liège; en particulier du quartier d’Outremeuse3. C’est à l’origine une marionnette à tringle représentant le public venant au théâtre de marionnette. Dans les années 1920, à la suite de la disparition des théâtres « bourgeois » (destinés aux classes sociales les plus riches qui ferment leurs portes, car leurs clients ont de nouvelles activités), il ne reste plus que les théâtres ouvriers. Le costume de Tchantchès se fixe : le pantalon à carreau noir et blanc, le sarrau bleu, le foulard rouge à pois blancs, la casquette noire. C’est le costume typique des ouvriers de la fin du xixe début xxe siècle dans le nord de l’Europe.
Tchantchès arbore également le nez rouge d’amateur de peket, le genièvre.
Réellement les premières traces de l’apparition de ce personnage remontent vers 1860 dans le théâtre de Léopold Leloup dans la rue Roture. Dans ce théâtre venaient de nombreux étudiants en médecine… C’est afin de les contenter que ce petit personnage intermède de second rang occupera finalement le devant de la scène.
Question caractère, il incarne l’esprit frondeur des Liégeois qui, à l’époque de sa création (milieu du xixe siècle), venaient de bouter les Hollandais dehors peu après qu’ils eurent fait de même avec les princes-évêques : il n’est pas impressionné par les titres et les couronnes, il est courageux et déterminé, assoiffé de liberté mais aussi sensible à la gloriole. À cet archétype du bonhomme liégeois il fallait associer une bonne femme liégeoise, ce fut fait avec Nanesse, la femme de Tchantchès. À la maison c’est elle qui porte la culotte, son révolutionnaire de mari n’a qu’à bien se tenir car sa poêle à frire ne sert pas qu’à faire des bouquettes. Ne serait-ce pas une manière de souligner avec ironie le décret d’Albert de Cuyck qui marquerait le début des libertés individuelles à Liège : « bonhomme en sa maison est le roi ».
Tchantchès en bande dessinée
Le personnage de Tchantchès a fait l’objet de deux adaptations en bande dessinée.
La première fois en juillet 1940 par Al Peclers, sous la forme d’un strip quotidien dans les pages du journal La légia. Tchantchès y vivra 3 histoires (Les aventures de Tchantchès, Tchantchès au Far-West et Tchantchès et les conspirateurs) qui seront peu après éditées en album, par les éditions Gordinne.
Pour la seconde adaptation datant de 1988, les éditions Khani ont publié un premier album Tchantchès, contenant plusieurs courtes histoires, dessinées par François Walthéry. Un second album : Tchantchès gamin des rues, a été publié en 1995 par les éditions Noir Dessin Production.
Albums
- Tchantchès, ses 3 premières aventures, Noir Dessin Production, 2007
Scénario et dessin : Al Peclers - Tchantchès, Khani Éditions, 1988
Scénario : Michel Dusart, Jean Jour – Dessin : Francis, Laudec, François Walthéry – Couleurs : Vittorio Leonardo - Tchantchès, gamin des rues, Noir Dessin Production, 1995
Scénario : Michel Dusart, Jean Jour – Dessin : Didier Casten, François Walthéry
Représentations
- Petit Avion situé sur la place Saint-Lambert du centre-ville de Liège4
- Le monument Tchantchès situé rue Pont-Saint-Nicolas, au croisement des rues Puits-en-Sock et Surlet dans le quartier d’Outremeuse à Liège.
Honneurs

Envie d’une activité ressourçante, revenons à la simplicité et à l’essentiel. Je vous propose des balades, formations et activités nature en Wallonie. Mais aussi des balades historiques sur Liège. Et du sur mesure rien que pour vous et votre groupe…

La New SPACE
Depuis septembre 2020, la Space Collection déploie également ses activités dans un espace de 500 m² : la New Space. Ancien garage de la police judiciaire, ce lieu se transforme en espace atypique de “monstration” de l’art, offrant des possibilités nouvelles pour le travail d’expositions et de scénographie, en conservant un cachet brut. Ce lieu s’éloigne d’une approche muséologique « classique » tout en se prêtant à des pratiques pluridisciplinaires et monumentales. Comme la Space en Féronstrée mais à une autre échelle, cet espace accueille des événements, conférences et expositions individuelles ou collectives, liées ou non à la collection. Depuis 2021, l’asbl s’associe avec Jeunesse et Arts Plastiques dans le cadre d’une série de conférences et de projections de films d’art ayant majoritairement lieu à la New Space.
Située au numéro 234 de la rue Vivegnis, en face de l’Espace 251 Nord et près des RAVI, de La Comète, du Corridor, de L’Image Sans Nom et de L’Inventaire, la New Space vient renforcer le pôle Art contemporain de la Ville de Liège au sein du quartier Nord.


a No Name Gallery casse les frontières et crée la rencontre entre les artistes et leur public.

Venez découvrir nos dernières trouvailles vintage et rétro.
Meubles,déco,rétrogaming,luminaires


Observatoire de Cointe
L’observatoire astronomique de Cointe est un observatoire astronomique construit en 18811 par l’université de Liège selon les plans de l’architecte liégeois Lambert Noppius2.
Description
D’inspiration néo-médiévale, il est situé à l’écart de la ville sur la colline de Cointe dans un parc privé, créé à cette époque, sur un domaine de la famille Vanderheyden de Hauzeur, riches industriels de la région.
Historique
C’est le premier des huit Instituts Trasenster construit3. Il hébergea l’Institut d’Astrophysique (renommé plus tard Institut d’Astrophysique et de Géophysique) jusqu’à son déménagement vers le campus du Sart-Tilman en 2002.
En 2008, il est en cours de rénovation en vue de l’installation future du Service Régional des Fouilles Archéologiques. Il abrite actuellement la Société astronomique de Liège.
Instrumentation
Dès la construction de l’observatoire, le pouvoir subsidiant mit en doute l’utilité de faire des observations au milieu des fumées de l’industrie locale (sidérurgie). Il ne fut donc jamais vraiment bien équipé. En 1884, on l’équipa d’un cercle méridien de 18 centimètres d’ouverture et d’une lunette astronomique de 10 pouces sur monture équatoriale. On pouvait y adjoindre un petit spectroscope. En 1931, un nouveau cercle méridien, commandé à la société Gautier-Prin de Paris, fut installé4. Fin des années 1930, il fut décidé de l’installer dans un abri plus adapté et, en 1942, elle fut démontée et entreposée dans des caisses au Val-Benoît5.
On effectua également des mesures du champ magnétique terrestre dès le début. L’électrification des tramways rendirent ces mesures impossibles et un observatoire magnétique fut donc créé à Manhay à l’occasion de l’année polaire internationale de 1932 (et un autre observatoire fut créé au Katanga). L’observatoire de Manhay fut détruit pendant l’offensive des Ardennes et reconstruit après les hostilités.
La lunette fut réquisitionnée par l’occupant durant la Seconde Guerre mondiale et ne fut jamais retrouvée. La lunette méridienne, ne connut pas le même sort. Prétextant qu’elle avait été rendue inutilisable lors d’un bombardement, elle fut cachée dans une mine de la région. Le nouvel abri fut achevé en 1946, c’est le bâtiment actuel. La méridienne y prit place.
La coupole principale (Nord) ne retrouva un instrument qu’en 1957 (le 23 avril). Longtemps attendu, ce télescope de Schmidt conçu par Pol Swings (en 1952) fut baptisé Désiré. Il comporte un miroir sphérique de 62 cm et une lentille correctrice de 43 cm (sa focale de 1,20 mètre lui donne un champ large de 5° 40′). Il présente la particularité d’être ‘convertible’. En ajoutant deux miroirs, il devient un télescope de Schmidt-Newton qui permet les observations visuelles. Avec quatre miroirs, il permet de faire de la spectroscopie. Sur ce télescope est montée une lunette de 150 mm appelée Célestine (compagne céleste de Désiré), elle a 2,40 mètres de focale. Il y avait également un ‘chercheur’ de 62 mm de diamètre et de 800 mm de focale (~3° de champ).
Dans la seconde moitié des années 1960, la lunette méridienne ne fut démontée et envoyée à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales dans le cadre d’une collaboration avec l’observatoire de Bordeaux. À son retour, l’intérêt pour la mesure des positions avec ce genre d’instrument avait disparu et elle resta dans des caisses jusqu’en 1997. Son intérêt patrimonial ayant été reconnu, elle fut remontée par le technicien qui l’avait mis en caisse fin des années 1960 et qui allait partir à la retraite6. Son objectif a un diamètre de 19 cm, sa focale est de 2,35 mètres, l’optique est signée Couder, les cercles méridien ont un diamètre de l’ordre du mètre.
La tour sud comporte une table équatoriale sur laquelle on plaçait des instruments de spectroscopie1,7,8.
Parc et bâtiments
Le terrain de 144 ares fut acquis par l’État belge (représenté par François Folie) lors d’une vente aux enchères le 3 mai 1880 pour 6 780,90 francs. La construction débuta la 14 février 1881 et s’acheva le 14 novembre 1882. La construction initiale ne contenait que les bâtiments en briques rouges : trois tours dont deux avec coupoles, la troisième étant destinée aux observations météorologiques; la maison directoriale, celle de l’assistant (ce qui n’était pas courant à l’époque) et la conciergerie, plus deux constructions en bois : la salle méridienne (entre la tour du télescope et la conciergerie) et la dalle dite du ‘grand vertical’ (entre la tour octogonale et la tout équatoriale). Dans le fond du parc, un abri en bois sert aux mesures magnétiques.
Au fil du temps, les constructions subirent des modifications et des extensions. En 1927, la maison directoriale subit quelques transformations et l’on entoura le parc d’une grille.
En 1937, la construction en bois de la salle du grand vertical fut remplacée par une construction en brique de deux étages plus sous-sol. Les étages abritèrent des bureaux et un laboratoire de spectroscopie. Le sous-sol fut spécialement aménagé pour la spectrométrie infrarouge. La pièce, isolée par des murs épais composés de plusieurs couches (90cm-6cm air-12cm-5cm d’ardennite) et un plancher ventilé, pouvait être maintenue à 20 °C avec une précision d’un dixième de degré. On y pénétrait par un sas et les instruments étaient posés sur des blocs en béton indépendant de la structure du bâtiment. Les rayons du Soleil dont on étudiait le spectre étaient captés par un héliostat, placé initialement sur une terrasse du second étage, il fut transféré au sommet de la tour équatoriale afin d’augmenter la durée des observations.
La construction en bois de la salle méridienne fut remplacée par une construction en dur l’année suivante (1938).
Autour de 1960, trois nouveaux bâtiments furent construits pour accueillir le personnel (et les étudiants) de plus en plus nombreux (150 personnes) : le grand bâtiment jaune avec son grand auditoire Marcel Dehalu ainsi que deux bâtiments légers : le Stockhem (pour un département astronautique où l’on trouve un hangar à ballon-sonde) et le RTG9.
Astronomie à Liège
Avant Cointe
L’intérêt des Liégeois pour l’astronomie est ancien. Ainsi, en 1560, Joannes Stadius compose au palais les Tabulae Bergenses en l’honneur du prince-évêque Robert de Berghes. Plus tard, Ernest de Bavière y disposa d’un observatoire bien équipé. En 1610, lors d’un voyage à Prague, il prêtera même à Johannes Kepler une des deux lunettes de Galilée qu’il avait acquises 10.
Des cours d’astronomie furent donnés à l’université de Liège dès la première année académique (1817), mais il fallut attendre 1838 pour y trouver un premier observatoire astronomique. À l’époque, l’université était toujours concentrée du côté de la place du Vingt-Août. L’observatoire comporte notamment une lunette méridienne établie pour régler la marche du temps, réguler les départs des convois de chemin de fer et favoriser l’art de l’horlogerie. En 1860, les quelques instruments (prisme, microscope solaire, deux télescopes (Newton et Gregory), une grande lunette achromatique sont repris dans l’inventaire des instruments du cabinet de physique et sont probablement plus destinés à l’enseignement de l’optique que de l’astronomie. À cette époque, une grande partie de la charge de l’université revient à la ville et il n’y a pas lieu d’avoir plusieurs observatoires astronomiques en Belgique9.
Cointe
C’est François Folie, inspecteur-administrateur à l’Université qui obtient les fonds et crée l’observatoire. Il en sera directeur jusqu’en 1891, mais il cumula cette fonction avec celle de directeur de l’Observatoire royal de Belgique dès 1883. Si bien que l’observatoire connu une période difficile. Son successeur, Constantin Le Paige entreprit de redynamiser l’activité (1893) et y poursuivit des travaux en mathématique. Cependant, l’année suivante, il devient recteur. Il se fait seconder par Marcel Dehalu. (participation à l’expédition de Bigourdan, le 30 août 1905 à Sfax en Tunisie pour observer une éclipse totale de Soleil). En 1922, Dehalu succède à le Paige comme directeur11,12,13.
Au début, l’activité principale de l’observatoire se concentre sur l’astronomie de position et les observations magnétiques, mais en 1938, Pol Swings de retour de l’observatoire de Meudon va jeter les bases d’un laboratoire de spectroscopie. C’est le début d’une nouvelle ère pour Cointe. Pol Swings est rejoint par Boris Rosen puis Marcel Migeotte. Ils feront de Cointe un des laboratoires de spectroscopie moléculaire les mieux équipés d’Europe. Ils s’intéressent aux spectres solaires et stellaires, on cherche à expliquer le fonctionnement des étoiles et la Nucléosynthèse stellaire. On s’intéresse aussi à la composition des comètes et aux molécules interstellaires. Paul Ledoux s’intéresse à la stabilité dynamique des étoiles.
En 1950, Marcel Migeotte installa un spectrographe conçu à Liège à l’observatoire du Jungfraujoch. Ils réaliseront un atlas du spectre solaire à haute résolution.
Après Cointe
En 2002, l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique déménagea sur le campus du Sart-Tilman, dans le bâtiment B5c14.
Spatiopôle
L’histoire du Spatiopôle remonte à la participation de Pol Swings à la création du Conseil européen de recherches spatiales. En juillet 1962, H.E. Butler, astronome à l’observatoire d’Édimbourg y propose la création d’un satellite d’observation astronomique. L’idée enthousiasme Pol Swings et propose de collaborer à la réalisation d’un spectrographe pour étudier le spectre ultraviolet qui, filtré par l’atmosphère, ne peut être étudié au sol. Le 12 mars 1972, une fusée Thor-Delta emporte de la base californienne de Vandenberg le satellite TD-115, testé à Liège et comprenant l’expérience Liège-Edimbourg (S2/68). Bien que l’enregistreur à bande magnétique faillit après quelques semaines, l’expérience fut un succès total et 50 000 spectres d’étoiles furent obtenus durant les deux ans que durèrent les observations (à la suite d’une prolongation du programme initial de six mois). On obtient aussi des spectres planétaires16.
Les Liégeois tirèrent aussi des fusées sondes en Sardaigne (1964, 1967, 1969). Le but était de répandre des gaz (ammoniaque et propylène) dans la haute atmosphère pour créer une comète artificielle. Des fusées équipées de spectrographe furent aussi lancée de la base européenne de Kiruna dans les années 1970 pour étudier les aurores polaires.
Société astronomique de Liège
La Société astronomique de Liège (SAL) fut créée en février 1938 par cinq étudiants dans le but de promouvoir l’astronomie auprès d’un large public. Elle s’inspire du modèle de la Société astronomique de France où le président fondateur Armand Delsemme (encore étudiant à l’époque) venait de donner une importante série de conférences (630 !) à l’occasion de l’Exposition spécialisée de 1937. En 2008, la SAL compte environ 600 membres, ce qui en fait un des plus grands clubs d’astronomes amateurs de Belgique. Elle organise chaque mois une conférence, un cours d’astronomie, une réunion informelle ainsi que plusieurs séances d’observation et des séances de planétarium. Elle dispose également d’un observatoire à l’extérieur de la ville (à Nandrin), diffuse une revue mensuelle (Le Ciel) ainsi que plusieurs publications à l’usage du grand public. Plusieurs fois par an, elle organise des manifestations autour de l’astronomie et de l’observatoire. C’est une des associations actives du quartier de Cointe 17,18.
Côté « science populaire », on trouve également à Liège, des cercles historiques et l’Association des Géologues Amateurs de Belgique19.
Astronomes / Géophysiciens
- François Folie
- Constantin Le Paige
- Marcel Dehalu
- Léonard Pauwen
- Boris Rosen
- Marcel Migeotte
- Paul Ledoux
- Pol Swings
Photos


Suivez nous pour être tenu.e au courant de toutes les informations touristiques de Ferrières 👍ℹ️

Ce service a pour missions :
L’accueil des visiteurs et la mise à disposition d’informations culturelles et touristiques sur Flémalle, la Province de Liège et la Belgique.
La mise en valeur et la promotion des sites touristiques de la commune.
Le développement de partenariats avec la Fédération du Tourisme de la Province de Liège et la Maison du Tourisme du Pays de Liège, dont l’Office du Tourisme fait partie.
Le développement des atouts culturels et touristiques au service de l’activité locale.
Investir dans des projets spécifiques susceptibles d’éveiller l’intérêt des visiteurs potentiels.
Le soutien aux associations locales flémalloises pour l’organisation de manifestations touristiques.

Fléron vous présente son nouvel Office du Tourisme où vous pourrez retrouver toutes les infos concernant les activités, les balades et les événements culturels se déroulant à Fléron.
Il se trouve actuellement au bureau d’accueil de la bibliothèque, rue de Romsée 18 – 4620 Fléron (rez-de-chaussée).

L’Office du Tourisme de Hannut a été reconnu par la Région wallonne en 2017.
Il est situé Place Henri Hallet, 27/1

Bénéficiant d’une situation géographique exceptionnelle, au coeur du triangle Aachen-Liège-Maastricht et non loin de Spa-Francorchamps, des Hautes-Fagnes et des Fourons, Plombières est le point de départ idéal pour partir à la découverte de notre belle contrée.
Que vous soyez promeneurs, cyclistes, passionnés de nature, amoureux de calme et de tranquilité, friands de contes et légendes, amateurs de villes d’Histoire, amoureux de patrimoine et de sites remarquables, fanatiques de Formule 1 ou de golf, à la recherche d’un hébergement, amateurs de produits du terroir, fins gourmets,… tout est possible depuis Plombières.

~Tourisme – Promenades – Manifestations touristiques ~
Votre office du tourisme vous accueille les mercredi et jeudi, ainsi qu’un week-end sur deux et les jours fériés.

Au coeur du Pays de Herve, l’Office du Tourisme du Pays d’Aubel propose une documentation locale et régionale.
Des ouvrages, brochures et autres produits y sont également en vente.

Venez découvrir nos petits villages pittoresques et ruraux ancrés dans un paysage campagnard! Amateurs de balades et de grands espaces? Bienvenue chez nous

Espaces agréables et conviviaux à louer pour TRAVAILLER (bureaux et salle de réunion), FETER (sal

L’Opéra royal de Wallonie, ou l’Opéra royala, est une maison d’opéra située place de l’Opéra, en plein centre de Liège en Belgique. Elle est, avec La Monnaie et le Vlaamse Opera, l’une des trois grandes maisons d’opéra du royaume. Depuis l’origine, l’institution occupe le Théâtre royal à Liège, bâtiment prêté par la ville (inauguré le 4 novembre 1820).
Sa situation géographique, au cœur de l’Euregio, au carrefour entre l’Allemagne, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la France, attire un large public tant belge qu’international.
Le terme Opéra national de Wallonie peut aussi désigner l’institution qui est domiciliée dans le bâtiment en questionb.
Histoire
En 1816, le roi Guillaume d’Orange cède gracieusement à la ville de Liège le terrain et les matériaux de l’ancien couvent des dominicains, à condition d’y élever une salle de théâtre.
La première pierre est posée le 1er juillet 1818 par Mademoiselle Mars1. Construit selon le plan de l’architecte Auguste Dukers, le théâtre de style néoclassique est de forme parallélépipédique massive. Sa façade principale est décorée d’une colonnade de marbrec, limitée par une balustrade et surmontant les arcades du rez-de-chaussée.
Le théâtre royal de Liège est inauguré le 4 novembre 1820.
La ville en devient propriétaire en 1854. La statue située devant le bâtiment représente le compositeur liégeois André Grétry et est l’œuvre du sculpteur Guillaume Geefs. Le cœur du musicien a été déposé dans le socle de la statue en 1842. En 1861, l’architecte Julien-Étienne Rémont transforme profondément la salle et le bâtiment qui est allongé de plusieurs mètres à l’arrière et sur les côtés. La nouvelle salle, de style Second Empire, peut alors accueillir plus de 1 500 spectateurs.
La Première Guerre mondiale sera une période difficile : dès août 1914, le bâtiment est réquisitionné par l’armée allemande pour servir d’écurie et de dortoir, et il faudra attendre octobre 1919 pour sa réouverture. L’Exposition internationale de Liège, en 1930, est l’occasion de l’installation définitive d’un vaste fronton, sculpté en façade par Oscar Berchmans – décor de figures allégoriques. La même année, la ville procède au dérochage des façades qui perdent leur enduit blanc. L’édifice sera épargné lors de la Seconde Guerre mondiale.
C’est en 1967 que la troupe de l’Opéra royal de Wallonie est créée, sur la base de l’ancienne troupe lyrique du théâtre royal de Liège et de celle de Verviers. Il est constitué en association sans but lucratif regroupant, au début, les villes de Liège et de Verviers. Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture française de l’époque est impliqué financièrement peu de temps après. Lors de la communautarisation, l’Opéra royal de Wallonie passe dans le giron de la Communauté française de Belgique qui compense, dès 1990, l’impécuniosité de la ville, et en est, depuis, le principal bailleur de fonds. Quelques années plus tard[Quand ?], la Ville, la Région wallonne et la Province de Liège reprennent part progressivement à son financement.
Le bâtiment est classé comme monument par la Wallonie par arrêté du 18 mars 1999.
Rénovation
L’édifice subit une importante rénovation de mars 2009 à septembre 2012, tant extérieure qu’intérieure. Les parties historiques ont été restaurées à l’identique (grand foyer, escaliers d’honneur et salle). Sa salle de spectacle (capacité 1 041 places), à l’italienne et sa machinerie de scène en font un des théâtres les plus modernes au monded.
Le bâtiment se voit aussi agrandi. Une structure ultramoderne a été installée en hauteur dans le but d’augmenter la hauteur de la cage de scène, et est dotée d’une salle dite polyvalente (salle Raymond Rossius) pouvant accueillir tant des spectacles de plus petite forme, que des répétitions ou encore des colloques, des conférences, des stages…
Dès novembre 2009 et jusqu’à la fin des travaux, les représentations se donnèrent au « Palais Opéra » : un chapiteau dressé de manière provisoire sur l’espace Bavière2.
L’Opéra royal de Wallonie rénové est inauguré le 19 septembre 2012, avec une représentation de l’opéra Stradella (1841) de César Franck, monté ici pour la première fois, dans une mise en scène de Jaco Van Dormael, en présence du couple héritier de Belgique, Philippe et Mathilde3.
Structure
Gestion[modifier | modifier le code]
En 2006, la subvention de la Communauté française à l’Opéra est de 12 672 000 eurose, dont près des deux tiers passent en salaires, puisqu’il emploie plus de trois cents personnesf.
La capacité de la salle est de 1 044 places.
La troupe de l’Opéra royal de Wallonie a eu pour directeurs successifs :
- 1967-1992 : Raymond Rossius (1926-2005)
- 1992-1996 : Paul Danblon (né en 1931)
- 1996-2007 : Jean-Louis Grinda (né en 1960)
- 2007- : Stefano Mazzonis di Pralafera (né en 1948)
Depuis 2007, le directeur général de l’institution est Stefano Mazzonis di Pralafera. Il occupe également le poste de directeur artistique. C’est lui qui a nommé le directeur musical actuel, Speranza Scappucci4.
Au fil des années, l’Opéra royal de Wallonie a acquis une solide renommée5. Ruggero Raimondi, Juan Diego Florez, Deborah Voigt, José Cura, José van Dam, autant de grands artistes que l’on retrouve, régulièrement, à l’affiche. Mais la vocation de l’Opéra est aussi de faire découvrir des artistes locaux et/ou en devenir.
L’Opéra royal de Wallonie est membre de RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la danse) et d’Opera Europa.
Orchestre et Chœurs de l’Opéra royal de Wallonie
L’orchestre et les chœurs s’illustrent dans de nombreux répertoires. Ils se produisent d’ailleurs à l’étranger, comme au Festival international de Balbeeck ou encore au Festival de Santander.
Ballet de l’Opéra royal de Wallonie
Fondé en même temps que la troupe d’opéra, le ballet de l’Opéra royal de Wallonie voit le jour en 1967. Interprétant essentiellement les divertissements dans le répertoire lyrique classique, le ballet s’oriente progressivement vers plus d’autonomie et vers un style néoclassique. Des restrictions budgétaires drastiques obligent le conseil d’administration à dissoudre le ballet en 1997.
Le ballet a eu comme chorégraphes notamment André Leclair, Gigi Caciuleanu et Jacques Dombrowski. Parmi les danseuses étoiles, on peut citer Ambra Vallo, aujourd’hui Principal au Royal Ballet.
Ateliers
Depuis sa création en 1967, une des grandes forces de l’Opéra royal de Wallonie est la particularité de vouloir fonctionner en entité indépendante. C’est pourquoi, les années 1970 voient ainsi la maison se doter de ses propres ateliers de confection de décors et costumes. Les bâtiments qui abritent les différents corps de métiers sont, à cette époque, répartis à divers endroits de la ville.
C’est au cours de la saison 1996/97, lors de la réalisation des décors colossaux et des costumes de La Traviata que de nouveaux besoins se font sentir. Si les ateliers veulent rester à la hauteur de leur réputation, il faut trouver au plus vite une solution au manque de place et de fonctionnalité des locaux existants.
C’est ainsi que l’Opéra royal de Wallonie décide de centraliser ses départements de production en un seul site, à Ans, en juin 2002. Ce nouvel ensemble architectural s’étend sur 2 660 m2 et groupe alors en un seul lieu les ateliers : décors (menuiserie, ferronnerie, peinture et accessoires), costumes (couture, chaussure, décoration de costumes) et maquillage-perruquerie.
Studio Marcel Désiron
Jusqu’en 2003, l’orchestre répétait dans la sous-salle du Théâtre royal, un local inconfortable et exigu.
En 2002, le transfert des ateliers de fabrications de décors vers leurs nouvelles installations à Ans a libéré les bâtiments de la rue des Tawes à Liège. L’ancien hall de montage des décors présentait un espace idéal par son volume et par sa dissymétrie (murs non parallèles, toiture à pans multiples) caractéristique intéressante du point de vue acoustique.
Une étude acoustique fut commandée et démontra la faisabilité du projet. Après une répétition de l’orchestre organisée afin de « tester » le hall, l’Opéra royal de Wallonie décida d’y aménager une salle de répétition de 240 m2, d’une hauteur de 8 m. L’objectif était de réaliser les travaux afin que les musiciens puissent y répéter dès 2003.
C’est ainsi que depuis la saison 2003-2004, toutes les répétitions d’orchestre se déroulent dans cet espace pouvant accueillir près de cent vingt musiciens. Si ce lieu est prioritairement réservé à la musique, il peut être aussi transformé en studio de mise en scène, si nécessaire.
Foyer de l’Opéra
Depuis le début de la saison 2013-2014, le foyer Grétry accueille le Foyer de l’Opéra, un restaurant avant chaque représentation.
Productions
Saison 2013-2014
- Attila de Giuseppe Verdi, direction musicale : Renato Palumbo, mise en scène : Ruggero Raimondi, avec Michele Pertusi, Makvala Aspanidze, Giovanni Meoni, Giuseppe Gipali
- Die Entführung aus dem Serail de Wolfgang Amadeus Mozart, direction musicale : Christophe Rousset, mise en scène : Alfredo Arias, avec Maria Grazia Schiavo, Wesley Rogers, Franz Hawlata, Elizabeth Bailey, Jeff Martin, Markus Merz
- Roméo et Juliette de Charles Gounod, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Arnaud Bernard, avec Annick Massis, Aquiles Machado, Marie-Laure Coenjaerts, Patrick Bolleire
- La Grande-Duchesse de Gérolstein de Jacques Offenbach, direction musicale : Cyril Englebert, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Alexise Yerna, Patricia Fernandez, Sébastien Droy, Lionel Lhote, Sophie Junker
- Fidelio de Ludwig van Beethoven, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Mario Martone, avec Jennifer Wilson, Zoran Todorovich, Franz Hawlata, Cinzia Forte
- Aida de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Ivo Guerra, avec Kristin Lewis, Isabelle Kabatu, Massimiliano Pisapia, Rudy Park, Nino Surguladze, Anna-Maria Chiuri
- Maria Stuarda de Gaetano Donizetti, direction musicale : Aldo Sisillo, mise en scène : Fransesco Esposito, avec Martine Reyners, Elisa Barbero, Pietro Picone
- La Gazzetta de Gioacchino Rossini, direction musicale : Renato Palumbo, mise en scène : Ruggero Raimondi, avec Cinzia Forte, Enrico Marabelli, Laurent Kubla, Edgaro Rocha, Julie Bailly
Saison 2014-2015
- La Cenerentola de Gioachino Rossini, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Cécile Roussat, Julien Lubek, avec Marianna Pizzolato, Bruno De Simone, Dmitry Korchak, Enrico Marabelli, Laurent Kubla, Sarah Defrise, Julie Bailly
- Manon de Jules Massenet, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Annick Massis, Alessandro Liberatore, Roger Joakim, Papuna Tchuradze, Pierre Doyen, Sandra Pastrana, Sabine Conzen, Alexise Yerna
- Luisa Miller de Giuseppe Verdi, direction musicale : Massimo Zanetti, mise en scène : Jean-Claude Fall, avec Patrizia Ciofi, Gregory Kunde, Nicola Alaimo, Bálint Szabó, Luciano Montanaro, Alexise Yerna, Cristina Melis
- Tosca de Giacomo Puccini, direction musicale : Paolo Arrivabeni, Cyril Englebert, mise en scène : Claire Servais, avec Barbara Haveman, Isabelle Kabatu, Marc Laho, Calin Bratescu, Ruggero Raimondi, Pierre-Yves Pruvot, Roger Joakim, Laurent Kubla, Giovanni Iovino
- Die Lustigen Weiber Von Windsor (Les Joyeuses Commères de Windsor) de Otto Nicolaï, direction musicale : Christian Zacharias, mise en scène : David Hermann, avec Franz Hawlata, Anneke Luyten, Werner Van Mechelen, Sabina Willeit, Laurent Kubla, Davide Giusti, Sophie Junker, Stefan Cifolelli (de), Patrick Delcour, Sébastien Dutrieux
- L’Auberge du Cheval-Blanc de Ralph Benatzky, direction musicale : Jean-Pierre Haeck, mise en scène : Dominique Serron, avec Alexise Yerna, François Langlois, Nicolas Bauchau, Natacha Kowalski, David Serraz, Anne-Isabelle Justens, Marc Pistolesi
- Rigoletto de Giuseppe Verdi, direction musicale : Renato Palumbo, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Leo Nucci, Desirée Rancatore, Gianluca Terranova, Luciano Montanaro, Carla Dirlikov, Patrick Delcour, Alexise Yerna
- Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Yoshi Oïda, avec Anne-Catherine Gillet, Marc Laho, Lionel Lhote, Roger Joakim
- L’Elisir d’Amore de Gaetano Donizetti, direction musicale : Bruno Campanella, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Maria Grazia Schiavo, Davide Giusti, Adrian Sampetrean, Laurent Kubla, Julie Bailly
Saison 2015-2016
- Ernani de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Jean-Louis Grinda, avec Gustavo Porta, Elaine Alvarez, Orlin Anastassov, Lionel Lhote, Alexise Yerna
- Il Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, direction musicale : Guy Van Waas, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Lionel Lhote, Jodie Devos , Gustavo De Gennaro, Enrico Marabelli, Laurent Kubla, Alexise Yerna
- Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, direction musicale : Jesús López Cobos, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Annick Massis, Celso Albelo, Ivan Thirion, Roberto Tagliavini, Pietro Picone, Alexise Yerna, Denzil Delaere
- Die Zauberflöte de Wolfgang Amadeus Mozart, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Cécile Roussat, Julien Lubek, avec Anne-Catherine Gillet, Anicio Zorzi Giustiniani, Mario Cassi, Burcu Uyar, Gianluca Buratto, Inge Dreisig, Krystian Adam, Anneke Luyten, Sabina Willeit, Beatrix Krisztina Papp, Roger Joakim, Arnaud Rouillon, Papuna Tchuradze
- Il Segreto di Susanna / La Voix Humaine de Ermanno Wolf-Ferrari, Francis Poulenc, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Ludovic Lagarde, avec Anna Caterina Antonacci, Vittorio Prato, Bruno Danjoux
- La Scala di Seta de Gioachino Rossini, direction musicale : Christopher Franklin, mise en scène : Damiano Michieletto, avec Maria Mudryak, Ioan Hotea, Filippo Fontana, Federico Buttazzo, Laurent Kubla, Julie Bailly
- Manon Lescaut de Daniel-François-Esprit Auber, direction musicale : Cyril Englebert, mise en scène de Paul-Emile Fourny, avec Sumi Jo, Wiard Witholt, Enrico Casari, Roger Joakim, Sabine Conzen, Laura Balidemaj, Denzil Delaere, Patrick Delcour
- La Traviata de Giuseppe Verdi, direction musicale : Francesco Cilluffo, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Mirela Gradinaru, Maria Teresa Leva, Javier Tomé Fernández, Davide Giusti, Mario Cassi, Ionut Pascu, Alexise Yerna, Papuna Tchuradze, Roger Joakim, Patrick Delcour, Alexei Gorbatchev, Laura Balidemaj
- La Bohème de Giacomo Puccini, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène de : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Patrizia Ciofi, Ira Bertman, Gianluca Terranova, Marc Laho, Cinzia Forte, Lavinia Bini, Ionut Pascu, Alessandro Spina, Laurent Kubla, Patrick Delcour, Stefano De Rosa, Pierre Nypels, Marc Tissons
Saison 2016-2017
- Turandot de Giacomo Puccini, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : José Cura, avec Tiziana Caruso, José Cura, Heather Engebretson, Luca Dall’Amico, Patrick Delcour, Gianni Mongiardino, Papuna Tchuradze, Xavier Rouillon, Roger Joakim
- Nabucco de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Leo Nucci, Ionut Pascu, Virginia Tola, Tatiana Melnychenko, Orlin Anastassov, Enrico Iori, Giulio Pelligra, Cristian Mogosan, Na’ama Goldman, Roger Joakim, Anne Renouprez, Papuna Tchuradze
- Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, direction musicale : Rinaldo Alessandrini, mise en scène : Jaco Van Dormael, avec Mario Cassi, Laurent Kubla, Salome Jicia, Veronica Cangemi, Leonardo Cortellazzi, Céline Mellon, Roger Joakim, Luciano Montanaro
- Orphée aux enfers de Jacques Offenbach, direction musicale : Cyril Englebert, mise en scène : Claire Servais, avec Papuna Tchuradze, Jodie Devos , Alexise Yerna, Pierre Doyen, Thomas Morris, Natacha Kowalski, Julie Bailly, Sarah Defrise, Frédéric Longbois, André Gass, Laura Balidemaj, Alexia Saffery, Yvette Wéris, Sylviane Binamé, Chantal Glaude, Palmina Grottola, Marc Tissons
- La Damnation de Faust de Hector Berlioz, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Ruggero Raimondi, avec Paul Groves, Nino Surguladze, Ildebrando D’Arcangelo, Laurent Kubla
- Jérusalem de Giuseppe Verdi, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Marc Laho, Elaine Alvarez, Roberto Scandiuzzi, Ivan Thirion, Pietro Picone, Natacha Kowalski, Patrick Delcour
- Dido and Æneas d’Henry Purcell, direction musicale : Guy Van Waas, mise en scène : Cécile Roussat, Julien Lubek, avec Roberta Invernizzi, Benoit Arnould, Katherine Crompton, Carlo Allemano, Jenny Daviet, Caroline Meng, Benedetta Mazzucato
- Otello de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec José Cura, Cinzia Forte, Pierre-Yves Pruvot, Giulio Pelligra, Alexise Yerna, Roger Joakim, Papuna Tchuradze, Patrick Delcour, Marc Tissons
Saison 2017-2018
- Manon Lescaut de Giacomo Puccini, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Anna Pirozzi, Marcello Giordani, Ionut Pascu, Marcel Vanaud, Pietro Picone, Alexise Yerna, Patrick Delcour
- Norma de Vincenzo Bellini, direction musicale : Massimo Zanetti, mise en scène : Davide Garattini Raimondi, avec Patrizia Ciofi, Silvia Dalla Benetta, Gregory Kunde, Josè Maria Lo Monaco, Roberto Tagliavini, Papuna Tchuradze
- La Favorite de Gaetano Donizetti , direction musicale : Luciano Acocella, mise en scène : Rosetta Cucchi, avec Sonia Ganassi, Celso Albelo, Mario Cassi, Ugo Guagliardo, Alexise Yerna, Matteo Roma
- Rigoletto de Giuseppe Verdi, direction musicale : Giampaolo Bisanti, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec George Petean, Devid Cecconi, Jessica Nuccio, Lavinia Bini, Giuseppe Gipali, Davide Giusti, Alessandro Spina, Sarah Laulan, Roger Joakim, Patrick Delcour, Alexise Yerna, Giovanni Iovino
- Carmen de Georges Bizet, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Henning Brockhaus, avec Nino Surguladze, Gala El Hadidi, Marc Laho, Mickael Spadaccini, Silvia Dalla Benetta, Lionel Lhote, Laurent Kubla, Natacha Kowalski, Alexise Yerna, Patrick Delcour, Papuna Tchuradze, Roger Joakim, Alexandre Tireliers
- Le Domino noir de Daniel-François-Esprit Auber, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Christian Hecq, Valérie Lesort, avec Anne-Catherine Gillet, Cyrille Dubois, Antoinette Dennefeld, François Rougier, Marie Lenormand, Laurent Kubla, Sylvia Berger
- Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, direction musicale : Christophe Rousset, mise en scène : Emilio Sagi, avec Mario Cassi, Judith Van Wanroij, Leon Kosavic, Jodie Devos, Raffaella Milanesi, Julien Véronèse, Alexise Yerna, Julie Mossay, Enrico Casari, Patrick Delcour
- La Donna del lago de Gioachino Rossini, direction musicale : Michele Mariotti, mise en scène : Damiano Michieletto, avec Salome Jicia, Marianna Pizzolato, Maxim Mironov, Sergei Romanovsky, Simón Orfila, Denzil Delaere, Julie Bailly
- Macbeth de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Leo Nucci, Tatiana Serjan, Vincenzo Costanzo, Giacomo Prestia, Papuna Tchuradze, Alexise Yerna, Roger Joakim
Saison 2018-2019
- Il Trovatore de Giuseppe Verdi, direction musicale : Daniel Oren, mise en scène : Stefano Vizioli, avec Fabio Sartori, Yolanda Auyanet, Mario Cassi, Violeta Urmana, Luciano Montanaro, Julie Bailly
- Il Matrimonio segreto de Domenico Cimarosa, direction musicale : Ayrton Desimpelaere, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Céline Mellon, Matteo Falcier, Mario Cassi, Sophie Junker, Annunziata Vestri, Patrick Delcour
- Tosca de Giacomo Puccini, direction musicale : Gianluigi Gelmetti, mise en scène : Claire Servais, avec Virginia Tola, Tiziana Caruso, Aquiles Machado, Marcello Giordani, Marco Vratogna, Elia Fabbian, Roger Joakim, Laurent Kubla, Pierre Derhet
- Le Comte Ory de Gioachino Rossini, direction musicale : Jordi Bernàcer, mise en scène : Denis Podalydès, avec Antonino Siragusa, Jodie Devos, Josè Maria Lo Monaco, Enrico Marabelli, Laurent Kubla, Alexise Yerna, Julie Mossay
- Faust de Charles Gounod, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Stefano Poda, avec Marc Laho, Anne-Catherine Gillet, Ildebrando D’Arcangelo, Lionel Lhote, Na’ama Goldman, Angélique Noldus, Kamill Ben Hsaïn Lachiri
- Aida de Giuseppe Verdi, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Elaine Alvarez, Donata D’Annunzio Lombardi, Gianluca Terranova, Marcello Giordani, Nino Surguladze, Marianne Cornetti, Lionel Lhote, Luca Dall’Amico, Luciano Montanaro, Tineke Van Ingelgem, Maxime Melnik
- Anna Bolena de Gaetano Donizetti, direction musicale : Giampaolo Bisanti, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Olga Peretyatko, Elaine Alvarez, Sofia Soloviy, Celso Albelo, Marko Mimica, Francesca Ascioti, Luciano Montanaro, Maxime Melnik
- La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, direction musicale : Thomas Rösner, mise en scène : Cécile Roussat et Julien Lubek, avec Patrizia Ciofi, Anna Bonitatibus, Leonardo Cortellazzi, Veronica Cangemi, Cecilia Molinari, Markus Suihkonen
- I Puritani de Vincenzo Bellini, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Vincent Boussard, avec Lawrence Brownlee, Zuzana Marková, Mario Cassi, Marco Spotti, Alexise Yerna, Zeno Popescu
Saison 2019-2020
- Madama Butterfly de Giacomo Puccini, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Svetlana Aksenova, Yasko Sato, Alexey Dolgov, Dominick Chenes, Mario Cassi, Sabina Willeit, Saverio Fiore, Alexise Yerna, Luca Dall’Amico, Patrick Delcour
- Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck et Hector Berlioz, direction musicale : Guy Van Waas, mise en scène : Aurélien Bory, avec Varduhi Abrahamyan, Mélissa Petit, Julie Gebhart
- Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet, direction musicale : Michel Plasson, mise en scène : Yoshi Oïda, avec Annick Massis, Cyrille Dubois, Pierre Doyen, Patrick Delcour
- Candide de Leonard Bernstein (version semi-scénique), direction musicale : Patrick Leterme, avec Thomas Blondelle, Sarah Defrise, Shadi Torbey, Pati Helen-Kent, Samuel Namotte, Lotte Verstaen, Leandro Lopez Garcia, Gabriele Bonfanti
- La Cenerentola de Gioachino Rossini, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Cécile Roussat et Julien Lubek, avec Karine Deshayes, Levy Sekgapane, Enrico Marabelli, Bruno de Simone, Laurent Kubla, Sarah Defrise, Angélique Noldus
- Don Carlos de Giuseppe Verdi, direction musicale : Paolo Arrivabeni, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Gregory Kunde, Ildebrando D’Arcangelo, Yolanda Auyanet, Kate Aldrich, Lionel Lhote, Roberto Scandiuzzi, Patrick Bolleire, Caroline de Mahieu, Maxime Melnik, Louise Foor
- La Sonnambula de Vincenzo Bellini, direction musicale : Speranza Scappucci, mise en scène : Jaco van Dormael, avec Nino Machaidze, René Barbera, Marko Mimica, Shiri Hershkovitz, Kamil Ben Hsaïn Lachiri
- Alzira de Giuseppe Verdi, direction musicale : Gianluigi Gelmetti, mise en scène : Jean Pierre Gamarra, avec Hui He, Riccardo Massi, Giovanni Meoni, Luca Dall’Amico, Roger Joakim, Marie-Catherine Baclin, Zeno Popescu
- Lakmé de Léo Delibes, direction musicale : Patrick Davin, mise en scène : Davide Garattini Raimondi, avec Jodie Devos, Philippe Talbot, Lionel Lhote, Pierre Doyen, Alexise Yerna, Julie Mossay, Sarah Laulan, Caroline de Mahieu, Pierre Romainville
- Nabucco de Giuseppe Verdi, direction musicale : Massimo Zanetti, mise en scène : Stefano Mazzonis di Pralafera, avec Amartuvshin Enkhbat, Anna Pirozzi, Riccardo Zanellato, Mattia Denti, Rinat Shaham, Giulio Pelligra, Roger Joakim, Virginie Léonard, Maxime Melnik
Anecdotes
- Le théâtre a accueilli en 2013 le tournage du film Une promesse de Patrice Leconte.

Créé en 2007, l’asbl Oupeye en Fête organise chaque année la Fête au village, sur la Place Jean Hubin. 4 jours de fête, toujours le 1er week-end d’octobre.



Construit dans le contexte de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, le Palais des Congrès de Liège profite d’une architecture avant-gardiste et d’une infrastructure hors du commun
PERSONNE MORALE : CENTRE CULTUREL DE WAREMME ASBL (ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)
SIÈGE : PLACE DE L’ÉCOLE MOYENNE, 9 B-4300 WAREMME (PROVINCE DE LIÈGE)
NUMÉRO D’ENTREPRISE : BE 0475 430 454
TRIODOS BANQUE : BE36 5230 8023 9081
BELFIUS : BE92 0682 3712 5823
RPM TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE DE L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LIÈGE (PLACE ST LAMBERT 30/003, 4000 LIÈGE)

2 fréquences 📻 dans l’Ardenne belge 🎙 96.2 FM à Vielsalm/Gouvy et dans l’Eifel • 89.1 FM à Bastogne/Houffalize et sa région 🎵
– aider à valoriser toutes les initiatives locales, à promouvoir tous les talents qui ne demandent qu’à éclore et à mettre en lumière les multiples qualités de toute l’Ardenne.



Découvrez de nombreux objets relatifs à l’histoire de la commune au travers de l’histoire du Fort de Fléron, de la tragédie de Forêt et des véhicules de l’US Army.

Association d’Éducation Permanente et Populaire
– Promotion de l’Interculturalité et du Bien Commun
– Autosocioconstruction des savoirs pour une Autosocioconstruction des contre-pouvoirs
– Lutte contre le racisme et l’Extrême-Droite


Infor-Femmes Liège est un planning familial dont l’objectif est de promouvoir le développement culturel, social, affectif, sexuel et personnel de la femme, de l’homme, du couple et de la famille, dans un esprit de stricte neutralité et de pluralisme.


Le Préhistomuseum est un muséoparc axé sur la Préhistoire, situé en Belgique. Le musée et la grotte de Ramioul sont nichés dans une réserve Natura 2000, au bord de la Meuse, à Flémalle, dans la province de Liège, en région wallonne. Le site se trouve dans une forêt de 30 hectares aux portes des Ardennes belges.
La grotte de Ramioul et ses activités réparties dans le parc accueillent à la fois les familles, les écoles et tous types de groupe.
Historique
Grotte de Ramioul et Préhistosite
La grotte de Ramioul fut découverte en 1911 par des membres de l’association Les Chercheurs de la Wallonie. Différentes campagnes de fouilles y ont mis au jour plusieurs niveaux correspondant à des occupations successives entre il y a 70 000 ans (Homme de Néandertal et Moustérien) et 2300 av. J.-C. (fin du Néolithique), incluant des vestiges aurignaciens produits par Homo sapiens1.
À la suite de ces découvertes, un petit musée fut créé. Il fut remplacé par le Préhistosite en 1994, grâce à un financement du FEDER.
Préhistomuseum
Le musée fondé en 19942, sous le nom « Préhistosite de Ramioul », ferma ses portes en 2013 en vue d’un réaménagement complet3. Il accueillait alors environ 40 000 visiteurs par an et occupait une quarantaine de personnes3.
Après trois années de travaux3 et 9,6 millions d’euros d’investissement2, le site, rebaptisé Préhistomuseum, a rouvert ses portes au public le 7 février 2016.
Ligne directrice
Le Préhistomuseum est un muséoparc et un musée d’archéologie à la fois, qui met ses collections en perspective en s’alignant sur les questionnements de notre société. En affirmant que l’humanité est universelle mais qu’elle s’exprime différemment dans le temps et dans l’espace, le Musée est un musée de l’Homme qui cherche à comprendre et à faire comprendre la complexité du comportement humain. Pour ce faire, il repère dans la Préhistoire et l’archéologie des faits qui sont porteurs de sens pour nous aujourd’hui et qui peuvent stimuler une réflexion philosophique sur la destinée de l’humanité. Le Musée cherche à s’adresser au plus grand nombre en rendant accessible intellectuellement, socialement et physiquement le patrimoine dont il a la garde et la responsabilité. L’équipe du Musée qualifie son approche de « Pop Archéologie », c’est-à-dire, « essayer de faire un musée pour ceux qui n’aiment pas les musées comme pour ceux qui les aiment ! »
Le Préhistomuseum est constitué de 4 composantes indissociables et complémentaires, qui forment le socle du projet culturel, scientifique et touristique de l’institution.
Découvrir notre patrimoine et ses ressources
Le musée conserve d’importantes collections de Préhistoire comme d’autres périodes de notre histoire, un site archéologique, des ressources documentaires et un vaste patrimoine naturel.
Le(s) patrimoine(s) participe(nt) à la construction des identités liées aux spécificités des territoires et des époques. Mais au-delà du temps et de l’espace, le musée veille à souligner les universaux communs à toute l’humanité plutôt qu’à exacerber les particularismes. Il espère ainsi contribuer significativement à une éducation populaire où la diversité des expressions culturelles qu’il donne à voir et à comprendre développe un esprit critique qui nuance nos à priori et nos certitudes. Les mots progrès, évolution et civilisation sont ainsi mis en questionnements utiles face aux débats qui animent notre société sur le « vivre ensemble ».
Comprendre l’écosystème de l’humanité
Le musée cherche à comprendre et à faire comprendre le comportement humain dans toutes ses dimensions : sociales, culturelles, économiques et environnementales. Les faits archéologiques choisis comme sujets de recherche, pour être exposés ou animés, sont approchés de manière systémique afin d’expliciter l’interaction complexe et simultanée des éléments constitutifs de l’écosystème au sein duquel les sociétés humaines sont en constante mutation.
L’approche « écosystémique » convoque conjointement toutes les ressources patrimoniales du Musée et la diversité des préconceptions de ses différents usagers. Le Musée montre ce qu’il ne sait pas et pourquoi il est en recherche. Il coopère avec ses usagers pour enrichir, par l’expérience des patrimoines, leurs réflexions communes.
Se déconnecter, se ressourcer, se reconstruire en tant qu’individu ou/et groupe d’individus
Parce que la Préhistoire évoque dans l’imaginaire collectif le dénuement, la survie, la simplicité, le paradis perdu ou la primitivité, et parce que l’infrastructure du Musée offre des espaces contrastés (en pleine nature, dans le noir, pieds nus, au cœur des réserves…), le Préhistomuseum est un lieu propice à la découverte, au plaisir, au bien-être et à la méditation.
« L’esprit du lieu » assure des conditions favorables et variées à l’exploration de nos questions existentielles « d’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? », facilitée par une approche sensorielle et émotionnelle qui stimule la réflexion. Par exemple, l’expérience de « l’humanité primitive » par la reproduction de gestes simples invite au constat de l’immanence de la pensée complexe ; l’immersion dans la nature convoque la culture humaine en interrogeant l’inné et l’acquis. Le Musée invite naturellement la question du bonheur : « tout compte fait, sommes-nous plus heureux que nos ancêtres ? ».
C’est pourquoi le Préhistomuseum se définit comme un Musée, comme un « Musée de l’Homme » et comme « le parc d’aventures de la Préhistoire pour faire l’expérience de l’humanité ».
Solliciter des expertises professionnelles et des services professionnels et/ou professionnalisants
Le Préhistomuseum cherche à développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être pour réaliser au mieux sa raison d’être au service de ses publics. Cette entreprise nécessite d’améliorer constamment l’organisation, de poursuivre le développement de méthodologies spécifiques et appropriées à la meilleure exécution des fonctions muséales chargées de sens. L’approche économique via le prisme de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, l’amélioration de l’organisation par le management de la qualité et de l’intelligence collective, l’adoption d’un mode de gestion collaborative par l’usage de la technologie sociale de l’holacratie, sont des expériences entrepreneuriales qui, si elles sont concluantes, pourraient peut-être inspirer d’autres entreprises culturelles et touristiques de demain.
Le Préhistomuseum est en quelque sorte un laboratoire de gestion muséale.
Le Laboratoire d’archéologie expérimentale, le Centre de conservation, d’étude et de documentation et le Laboratoire de médiation développent quant à eux des services et des méthodes de travail et de formation qui ne demandent qu’à être partagés avec des collègues d’autres institutions ou des étudiants dans les domaines de la Préhistoire, de la muséologie, de la médiation, du tourisme et du patrimoine, de l’économie.
Le Préhistomuseum cherche, entreprend, expérimente avec modestie et ambition, avec comme objectif principal d’être utile à ses usagers et au patrimoine4.
Autres activités
En plus de ses expositions permanentes et de ses expériences, le musée accueille des expositions temporaires.
Outre le musée, on trouve sur le site des ateliers permettant de s’initier aux techniques préhistoriques, telles que la taille des pierres, l’allumage du feu, la chasse à l’arc ou au propulseur.
Un archéorestaurant permet de manger des repas compatibles avec les ressources disponibles durant la Préhistoire.
Grottes voisines
À quelques centaines de mètres de la grotte de Ramioul, sur le territoire d’Engis, se trouve la grotte Lyell, ainsi nommée parce que Charles Lyell la visita en 1860 pour vérifier les assertions de Philippe-Charles Schmerling, qui l’avait découverte en 1831.
La grotte de Rosée, également à Engis, doit son nom au patronyme d’un ancien propriétaire. Ces deux cavités hébergent une faune cavernicole unique en Belgique5.
Comme la grotte aux végétations toute proche, ces cavités sont aujourd’hui menacées par l’activité d’une carrière proche6.
En 2003 fut découverte la grotte de Nicole (nommée en l’honneur de Nicole Hubart, épouse de Jean-Marie Hubart). Cette grotte est une galerie qui constitue un important prolongement de l’étage inférieur de la grotte de Ramioul.
En face, sur la rive gauche de la Meuse, se trouvent les grottes Schmerling et celles de Chokier, sur le territoire communal de Flémalle.

La Bibliothèque Chiroux est la principale bibliothèque publique de Liège. Avec plus d’un million de documents, il s’agit de la plus grande bibliothèque publique belge francophone, tant au niveau de ses collections que de son personnel.
Étymologie
Historique
Une bibliothèque itinérante en province de Liège est créée en 1921 afin de fournir des lots de livres aux bibliothèques locales. Une bibliothèque pour adultes ouvre en 1936, rue Darchis à Liège avant de déménager boulevard Piercot en 1948. La bibliothèque propose alors une salle de lecture, une section pour les adultes et une autre pour les enfants. Une section pour les adolescents voit le jour en 1955.
À partir de 1972, la Province de Liège entame une collaboration avec la Ville de Liège pour cogérer la bibliothèque, installée depuis deux ans dans la rue des Croisiers. Dans les années 1980, la bibliothèque devient la première de la Communauté française de Belgique à être totalement informatisée.
En 2005, à la suite de problèmes financiers de la Ville de Liège, la Province de Liège reprend seule la gestion de la bibliothèque Chiroux. L’année suivante, un réseau informatique est créé autour d’un nouveau logiciel (Aleph). D’autres bibliothèques intègrent le réseau et un catalogue collectif des bibliothèques de la province de Liège est mis en ligne.
À partir de 2012, la bibliothèque propose à l’emprunt des liseuses électroniques ainsi que l’accès à une plateforme de livres en consultation en ligne. La section de prêt pour adultes est également avec équipée d’un nouveau système automatisé grâce à l’utilisation de la RFID. L’année suivante, la bibliothèque propose le téléchargement de livres numériques à partir d’une plateforme de prêt en ligne.
En novembre 2014, une section supplémentaire est ouverte : une artothèque qui prête gratuitement des œuvres d’art au grand public1.
En 2014, la Bibliothèque Chiroux est la plus grande bibliothèque publique reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’ensemble de ses sections rassemble environ un million de documents (livres, CD, DVD, revues, journaux, œuvres d’art, etc.)2.
Anciens fonds
De 1970 à 2005, la Bibliothèque des Croisiers-Chiroux abritait le fonds Ulysse Capitaine qui a déménagé en 2010 dans des nouveaux locaux en Féronstrée à Liège3. Elle abritait également le Fonds d’histoire du Mouvement wallon et la Bibliothèque des dialectes de Wallonie, aujourd’hui transférés au sein des collections du Musée de la vie wallonne de Liège.

Agir par la Culture est un magazine trimestriel qui traite de thèmes politiques et culturels. Il est édité par le mouvement Présence et Action Culturelles qui développe une action d’éducation permanente dans toute la Belgique francophone via un réseau d’animateurs de terrain répartis en 12 antennes régionales.
Créé en 2005, d’abord intitulé PACtualité, il tenait alors lieu de bulletin d’information sur la vie du mouvement. Devenu Agir par la Culture en 2008, il se transforme peu à peu en un magazine ouvert sur l’actualité sociale, politique, médiatique, artistique et culturelle et les initiatives qui tentent d’élaborer des alternatives au capitalisme culturel.
Diffusé à 10.000 exemplaires en Belgique francophone, Agir par la Culture est conçu par un comité de rédaction qui regroupe aussi bien des salarié·e·s de PAC, actif·ve·s sur le terrain de l’éducation populaire, que des journalistes et chroniqueur·euse·s bénévoles qui œuvrent dans leurs secteurs respectifs (théâtre, université, presse, enseignement…).
L’édition du magazine Agir par la Culture et de son site Internet reçoivent le soutien du Service Éducation permanente du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Loterie Nationale.

Quai4 galerie
Située au pied du pont Kennedy, cet espace accueillant se concentre sur l’art contemporain, sans barrières géographiques ou disciplinaires. Ce qui importe est l’émotion des créations de qualités.
La concentration du programme repose sur les formes d’expression plutôt contemplative. Il montre le côté sensible et vulnérable de l’art avec la légèreté sérieuse.


Les visites guidées en français, néerlandais, allemand, anglais et wallon ont lieu le 1er dimanche du mois de 9 à 18 heures. Excepté en Janvier, février et décembre.
Des visites pour les groupes de 10 personnes minimum peuvent être organisées sur demande.
Adresse : 4, Les Béolles, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Tél. 0032 87 44 61 81
Guided tours in French, Dutch, German, English and Walloon take place every 1st Sunday each month from 9 AM until 6 PM. Except in January, February and December.
Tours for groups of 10 people minimum can be arranged on request.
Address : 4, Les Béolles, 4890 Thimister-Clermont, Belgium
Phone : 0032 87 44 61 81
Americans are always welcome !

Le Rétromobile Club de SPA est une a.s.b.l. fondée en 1984, formée d’amoureux de véhicules d’un autre âge. Notre but : réunir les personnes qui aiment les belles mécaniques anciennes, organiser des manifestations et des balades dans cet esprit.

Le Rotary Club de Crisnée se consacre à des activités sociales afin d’aider différentes associations

Le but du RSI de Trois-Ponts est d’accueillir au mieux les visiteurs désireux de découvrir notre belle région et ses activités.

Trois-Ponts, c’est déjà la montagne…
Le but du RSI de Trois-Ponts est d’accueillir au mieux les visiteurs désireux de découvrir notre belle région et ses activités.
La commune de Trois-Ponts doit son essor à l’arrivée et l’expansion du chemin de fer dans nos régions. De cet héritage industriel, Trois-Ponts en a conservé sa gare lui permettant d’offrir un vaste choix de transports en commun. En effet, vous trouverez dans notre commune une gare de trains, de bus ainsi que le RAVeL pour nos amis cyclistes.
Mais Trois-Ponts a aussi su préserver son environnement verdoyant et propose de nombreuses promenades ; que ce soit la promenade jusqu’au célèbre Faix du Diable situé à Wanne ou la balade du castor, venez plonger dans les légendes anciennes et découvrir la faune et la flore de nos contrées.
Que ce soit pour vous loger, vous restaurer ou vous divertir, le RSI est le point de départ de votre visite!

Notre organisme est destiné à favoriser la promotion du tourisme dans notre commune de Welkenraedt/Henri-Chapelle, ainsi que la promotion et l’information des différentes associations, sociétés et clubs Welkenraedtois et Capellois.
Depuis la fusion des communes en 1977, le territoire couvert par notre S.I. est celui de Welkenraedt et Henri-Chapelle qui s’étend sur une superficie de 2.446 hectares avec une population de 9.897 habitants fin 2016.
Idéalement situé, on peut très facilement nous joindre par autoroute où par train.
Le Syndicat depuis 1963
Fondé le 28 août 1963 par Messieurs:
- Joseph WOLGARTEN;
- Jean DUMONT;
- Marcel SMEETS;
- Marcel WILLEMS
- et quelques conseillers techniques.
Ces premiers pionniers ne disposaient de rien, si ce n’est leur bonne volonté et la ferme intention de valoriser la notoriété de leur commune.
Parmi les manifestations ponctuelles:
- la Foire aux boudins inaugurée en mai 1964;
- le carnaval des enfants en février 1967;
- le Marché aux puces depuis Pâques 1984;
- le barbecue et les activités au Bosquet depuis 1987;
- la Chasse aux œufs de Pâques à partir de 1990;
- le Marché nocturne créé en 1997;
- la fête de Halloween et Noël aux Pyramides en l’an 2000.
Le Syndicat d’Initiative a collaboré dans un rôle essentiel aux festivités de Vil’Vacances en 1966 et 67 et des jumelages avec Nove en 1968 et Epfig en 1971.

Témoin majeur de l’architecture du XIXe siècle, la Salle Philharmonique de Liège est le siège

Le Saz Club est un lieu d’échanges artistiques, de concerts, de théâtre, d’expositions, de workshop

L’association a pour but de promouvoir les arts plastiques et la culture, de manière générale, et les rendre accessible à tous.


Dalhem (en wallon Dålem) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège, ainsi qu’une localité où siège son administration. Elles se trouvent plus précisément dans la zone géographique du Pays de Herve, en Basse-Meuse.
Géographie
La commune de Dalhem est composée de 8 villages : Berneau, Bombaye, Dalhem, Feneur, Mortroux, Neufchâteau, Saint-André et Warsage.
| № | Localités | Superficie | Nombre d’habitants (2005) |
|---|---|---|---|
| I | Dalhem | 2,25 km2 | 1 308 |
| II | Berneau | 3,19 km2 | 694 |
| III | Bombaye | 5,30 km2 | 635 |
| IV | Feneur | 1,38 km2 | 482 |
| V | Mortroux | 3,16 km2 | 553 |
| VI | Neufchâteau | 8,80 km2 | 854 |
| VII | Saint-André | 3,64 km2 | 448 |
| VIII | Warsage | 8,34 km2 | 1 419 |
Histoire
La localité est fondée en 1080 au confluent de la Berwinne et du Bolland. La « vieille ville » comprend divers monuments et habitations : ruines médiévales du château, maisons construites du xvie jusqu’au xixe siècle. Le site a été classé en 1978.
Sous l’Ancien Régime, la localité était le centre du Comté de Dalhem, sous contrôle du Duché du Brabant depuis 1239. Le Comté était contigu du Duché du Limbourg, appartenant également au Brabant. Le Duché de Limbourg et le Comté de Dalhem étaient dénommés alors le Pays d’Outremeuse.
Le territoire verra ses frontières à diverses reprises modifiées, à la suite des Guerres de religion du xvie siècle et du xviie siècle qui se manifestèrent surtout par la Guerre de Quatre-Vingts Ans dans ces contrées. Le territoire dalhemois sera en proie aux luttes entre calvinistes et catholiques. Le Comté passera ainsi entre les mains des Espagnols, des Provinces-Unies et des Autrichiens durant les temps modernes. Il est à noter qu’une minorité protestante persistera à Dalhem jusqu’au début du xixe siècle comme témoignage de ces périodes de troubles.
Après le Congrès de Vienne de 1814-1815 qui voulait mettre un terme à l’erreur révolutionnaire et napoléonienne, Dalhem sera rattachée au Royaume des Pays-Bas de Guillaume Ier. En effet, les Autrichiens ne revendiquèrent pas leur droit sur ces terres estimant celles-ci trop éloignées malgré la volonté du diplomate Metternich de rétablir l’Europe de l’Ancien Régime. Enfin, la Cité des Comtes passa sous l’égide de Bruxelles lorsqu’en 1830 éclata la Révolution belge.
Le Fort d’Aubin-Neufchâteau, ouvrage de la ceinture fortifiée de Liège en 1940, se trouve sur le territoire de la commune et rappelle que Dalhem a elle aussi payé son tribut de sang lors des guerres du début du xxe siècle.
En 1977, l’actuelle commune de Dalhem est créée, regroupant autour de Dalhem, sept villages environnants. Il était initialement prévu de fusionner ces huit villages avec la ville de Visé et de créer ainsi une ville de taille moyenne entre Liège et Maastricht, ce qui ne put se faire à cause du refus de plusieurs communes rurales de la région dalhemoise de se réunir avec la cité mosane.
Étymologie
Dalhem est un nom d’origine germanique, qui signifie habitation de la vallée. Il existe d’ailleurs des localités dénommée Dalheim dans les proches régions du Luxembourg et de l’Eifel, en Allemagne. Un des quartiers du sud-ouest Berlin, abritant notamment le musée d’ethnologie de la ville, porte également le nom de Dahlem. L’orthographe du village de « Dalhem » n’a pas été figée dès le début. Une carte géographique de l’époque napoléonienne indique d’ailleurs l’orthographe « Dalemm ».
Le village a aussi été nommé en néerlandais ‘s-Gravendal. Ce qui signifie littéralement Vallée du Comte. Ce nom est à mettre en parallèle avec Fouron-le-Comte (‘s-Gravenvoeren en néerlandais), autre entité faisant partie de l’ancien Comté de Dalhem et qui fut en son temps le lieu où le seigneur rendait la justice. Cette dénomination est désormais inemployée.
Démographie
La commune compte au 1er décembre 2019, 7 525 habitants, 3 714 hommes et 3 811 femmes1, pour une superficie de 36,06 km2, soit une densité de 208,68 habitants au km2.
Le graphique suivant reprend sa population résidente au 1er janvier de chaque année2.

Les chiffres des années 1846, 1900 et 1947 tiennent compte des chiffres des anciennes communes fusionnées.
- Source : DGS – Remarque: 1806 jusqu’à 1970=recensement; depuis 1971=nombre d’habitants chaque 1er janvier3
Personnalités
- Marie Gillain, actrice, domiciliée à Fêchereux (Neufchâteau) jusqu’en 1999.
- Albert Thys, figure du colonialisme belge au Congo et fondateur de Thysville (actuellement Mbanza-Ngungu en République démocratique du Congo).
- Odilon-Jean Périer, poète. Petit-fils du général Thys et inhumé à ses côtés à Dalhem.
- Henry Le Bœuf, mécène de Dalhem qui donna son nom à la grande salle de concert du Palais des beaux-arts de Bruxelles.
- Paul Henry, né à Bombaye le 30 juillet 1936, joueur professionnel de football à Saint-Trond en D1 belge.
- Francis Rion, ancien arbitre international de football (Coupe du Monde 1978).
Patrimoine
- Église Saint-Pancrace (tour de 1714, nef et chœur de 1829-1830).
- Ruines du château fort des Comtes de Dalhem.
- Anciens remparts.
- Poterne du Wichet de la Rose datant de 1520.
- Ancien hôtel de ville construit en 1665 par le régime des Provinces-Unies.
- Château [archive] du bourgmestre Henri Francotte (de) (1912), anciennement appelé Maison de la Charité, construit dans un style néo-mosan.
- Tunnel vicinal sur la ligne Liège-Fourons construit en 1904, le plus long de ce type en Belgique (135 m).
- Conciergerie du Château Albert Thys.
- Ensembles architecturaux remaniés par Henry Le Bœuf au xixe siècle dont une gentilhommière qui surplombe la vallée du Bolland.
Vie politique
Législature 2006-2012
Depuis les élections communales du 8 octobre 2006, le collège échevinal (MR + PS) est établi comme suit :
- Bourgmestre : Jean-Claude Dewez (MR) Compétences : Police, état civil, cultes, finances, personnel et cimetières.
- 1er échevin : Marie-Catherine Van Michel dit Valet-Janssen (PS) Compétences : Enseignement, jeunesse, petite enfance.
- 2e échevin : Grégoire Dobbelstein (MR) Compétences : Travaux, agriculture, urbanisme, environnement, coopération.
- 3e échevin : Jean-Pierre Teheux (PS) Compétences : Sports et tourisme.
- 4e échevin : Arianne Polmans (MR) Compétences : Culture, affaires sociales, patrimoine, loisirs, classes moyennes, maisons des jeunes.
L’opposition compte 8 sièges sur 17 et est composée des groupes politiques Cartel2006 et Renouveau Communal.
Législature 2012-2018
Bourgmestre : Arnaud Dewez (MR) Compétences : Police – Cultes – État civil – Communication – Personnel – Finances – Information – Site Internet – Informatique – Classes moyennes – Sécurité des personnes et des biens.
1er échevine : Marie-Catherine Janssen (PS) Compétences : Tourisme – Culture – Affaires sociales – Patrimoine – Logement – Commerce – Bâtiments communaux – Aînés – Loisirs.
2e échevine : Ariane Polmans (MR) Compétences : Enseignement – Petite enfance – Jeunesse – Bibliothèques – Artisans.
3e échevin : Léon Gijsens (MR) Compétences : Urbanisme – Agriculture – Cadre de vie – Environnement – Sports – Mobilité – Énergie – Distribution d’eau – Cours d’eau.
4e échevine : Josette Bolland (PS) Compétences : Travaux – Cimetières – Sécurité routière.
Président du CPAS: René Michiels
Législature 2018-20244
Bourgmestre : Arnaud Dewez (Maïeur-apparenté MR)
1er échevine : Ariane Polmans (Maïeur- apparenté MR)
2e échevin : Michel Voncken (Maïeur- non apparenté)
3e échevin : Fabian Vaessen (Maïeur- apparenté MR)
4e échevine : Daniela Crema-Wagmans (Maïeur- apparenté Cdh)
Président du CPAS: Léon Gijsens (Maïeur- apparenté MR)
Événements et folklore
Dalhem est renommée dans sa région pour son esprit festif. De nombreux événements sont ainsi organisés tout au long de l’année: des brocantes, des festivités villageoises, des soirées, des marches, des représentations théâtrales, des expositions, des cramignons…
Le village est également reconnu pour son opposition séculaire entre « Bleus » et « Rouges ». Ces deux sociétés fondées au xixe siècle animent le village par de nombreux événements dont la fête du village et la fête de leur société (Fête de la Saint-Louis pour les Rouges, Fête du Tunnel pour les Bleus).
La Royale Jeunesse Saint-Servais (la Jeunesse des Bleus) fut fondée en 1858. La Royale Jeunesse « les Enfants belges » (la Jeunesse des Rouges) est au départ une dissidence des Bleus ayant pour cause une sombre dispute concernant l’acquisition d’un orgue par le curé de la paroisse à la fin du xixe. De l’après-guerre jusque la fusion des communes de 1977, ces deux associations étaient également des partis politiques locaux.
Cette dichotomie (même si elle s’atténue progressivement) au sein de la population dalhemoise a favorisé une pilarisation du village: clubs de football distincts, salles des fêtes distinctes, quartiers de résidence distincts, cafés distincts, manifestations de violence lors de certaines activités (notamment lors de la fête du village), etc.
En 1986 et jusque 2006, avait lieu la feria « Bandas » pendant 3 jours le Vieux Dalhem reprenait vie. Les bandas sont des orchestres de musique de fête, des fanfares aux couleurs vives. Cette manifestation a fait bouger des dizaines de milliers de personnes de tout âge de la région, et recevaient des centaines de musiciens venant de partout (France, Pays-Bas mais aussi les Dom Tom, et bien d’autres). Le refus par l’administration de reconnaître la présence de nombreux bénévoles a causé une interruption, mais la feria a repris depuis 2013 et récupéré son lustre.
Héraldique
 |
La commune possède un blason, créé en 1977 lors de la fusion des communes ; le château symbolise la vieille ville de Dalhem et est inspiré par l’ancien sceau de la commune et son ancienne puissance comtale. Les 8 épis représentent tant les 8 villages qui composent l’actuelle commune qui l’agriculture qui caractérise la région5.
Blasonnement : D’azur à un château ouvert ajouré et maçonné du champ à trois tours crénelées, celle du milieu plus haute que les deux autres, et d’où hissent latéralement 2 bannières chargées d’un lion, accosté de huit épis du même, rangés en pal quatre et quatre, ceux à dextre posés en bande, ceux à senestre posés en barre, le tout d’or.
|


L’ASBL Société Astronomique de Liège (S.A.L.) est ouverte à toutes les personnes intéressées par le ciel étoilé, dans la pratique ou la théorie.

Mouvement féministe et laïque qui milite et porte des revendications politiques pour une société plus égalitaire. http://www.soralia.be

Actuellement au nombre de 140, les œuvres (peintures, installations, sculptures, gravures, dessins, vidéos, …) sont acquises grâce à des sculptures interactives placées dans l’espace public. A Liège, la SPAC (Sculpture Publique d’Aide Culturelle) est implantée en Féronstrée au pied de l’Echevinat de la Culture. Cette dernière, inactive depuis août 2021 à cause des travaux du tram, dispose du concept suivant : Quand un passant insère une pièce d’un euro dans la borne interactive connexe à la sculpture, il déclenche un flamme au sommet de son arc en acier et reçoit soit un ticket avec de la poésie contemporaine, soit une fois sur dix aléatoirement, un bon à échanger contre des activités culturelles à Liège. L’argent récolté, augmenté grâce à du mécénat, permet d’enrichir et de promouvoir la collection.transfrontalière. Elle met l′art contemporain à la portée de tous en impliquant dans sa construction la participation conjointe des citoyens, des pouvoirs publics, des entreprises et du réseau associatif.
En plus de sa collection, la SPACE Collection déploie de nombreuses expositions dans ses deux espaces aux caractéristiques bien distinctes : La Space et la New Space. Ces expositions sont liées ou non à la collection. L’asbl élabore également des événements en dehors de ses murs.
Réseau de villes européennes autour d’une collection transfrontalière d’art contemporain
En Féronstrée 116 à 4000 LIEGE

Live Music Club in Verviers (B)
Tickets : http://www.tickets66.be/
Agenda : https://www.facebook.com/spiritof66/events

Welcome to the official Facebook page of Standard de Liège.


Le Studio Créa est une école privée moderne qui propose aux enfants et aux adultes, une formation artistique unique en danse, musique, chant, comédie musicale et théâtre/expression scénique.
Le bâtiment comprends 3 salles de danse et 7 salles destinées à la musique, au chant, intégrant également un studio d’enregistrement.
De nombreux stages et évènements sont organisés tout au long de l’année ainsi que des masterclass et des workshop. L’école dispose également d’une cafétéria confortable avec Wi-fi et d’une spacieuse terrasse à l’étage.

Créé en 1969, le STL est une troupe de théâtre amateur qui vous propose 3 pièces par an.

Rendez-vous 25 au 28 mai à Liège pour l’édition 2023 du plus ardent des festivals brassicoles ! 🍻


Informations touristiques de la commune de Bassenge.

Le Syndicat d’Initiative de Trooz a pour mission principale la promotion touristique de la commune de Trooz.
Celui-ci existe depuis 2008 et est composé d’une vingtaine de bénévoles et de deux permanents engagés à temps partiel. Cette ASBL a pour objectif de promouvoir toutes les activités, que ce soit une activité propre au Syndicat d’Initiative, un événement organisé par une association de la commune ou une activité organisée par l’Administration communale, les lieux et patrimoines à potentiels touristiques…
Par exemple, le Syndicat d’Initiative organise, depuis 2008 déjà, une balade gourmande mêlant plaisir gustatif, rencontres et découverte de nos sentiers et paysages.

Dans la presse comme sur internet, le nom Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La Rawète est accolé à celui de la Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy et à ceux des musées « de la Gourmandise » et « Postes restantes ». Cette multiplicité des appellations mérite une explication :
Il était une fois… la ferme du château de Hermalle-sous-Huy, dite Ferme castrale. Cet imposant bâtiment fut laissé à l’abandon à partir des années 1975 et sa rénovation ne fut entreprise qu’à partir de 1991. Encore fallait-il lui trouver une nouvelle affectation. Culture et tourisme furent choisis et notre association sans but lucratif Al Rawète naquit le 17 juin 1993 avec un objet social précis :
- Soutenir la restauration architecturale et la promotion touristique de la Ferme, et
- Protéger le patrimoine gastronomique par la collecte, le classement, la restauration d’objets et documents originaux anciens et modernes concernant l’alimentation, le tabac, l’histoire de la cuisine et de la gastronomie (et tout particulièrement en Belgique).
Al rawète signifie donc en wallon : à la rawète (au p’tit bout, au p’tit dernier).
Mais les non-wallophones ne peuvent la comprendre… et certains vont aller jusqu’à supposer que l’association regroupe des allochtones – al pouvant être un article défini tant breton qu’arabe…
L’asbl va donc franciser son nom et devenir La Rawète – ce qui offre le désavantage de mélanger français et wallon, mais aussi l’avantage de devoir expliquer ce qu’est une rawète à ceux qui ne le savent pas !
Dès l’abord, La Rawète ouvre dans la ferme une infrastructure d’accueil pour offrir l’info et s’assurer un minimum de trésorerie avec une petite cafétéria.
Deux ans plus tard, elle crée le Musée de la Gourmandise qui traite de l’histoire de la Gastronomie.
Deux ans passent encore et l’asbl ouvre la Bibliothèque de la Gourmandise qui offre actuellement la plus importante collection de livres de gastronomie de Belgique : plus de 20 000 livres !
La Rawète est reconnue « association touristique » par le CGT en 1998.
Des groupes de visiteurs commencent à réserver des visites ; cela va peu à peu impliquer nos bénévoles dans l’accueil plus spécifique des personnes handicapées et ce travail de fond va être récompensé par l’attribution du Prix CAP48 de l’entreprise citoyenne 2009 pour une « politique très active d’accessibilité malgré des moyens limités ».
Un site internet, http://www.gastronomica.be, est mis en ligne en français le 19 janvier 2001 à 20 heures, en néerlandais le 9 mars 2001, en anglais le 19 avril 2001, en wallon le 29 juin 2001. Actualisé chaque mois, il connaitra aussi des changements graphiques.
En 2002, La Rawète, dans le cadre des activités du musée et de la bibliothèque, inaugure son cycle de balades gourmandes guidées pour la redécouverte des plantes sauvages comestibles. Elle ajoutera plus tard des journées de formation sur ce thème.
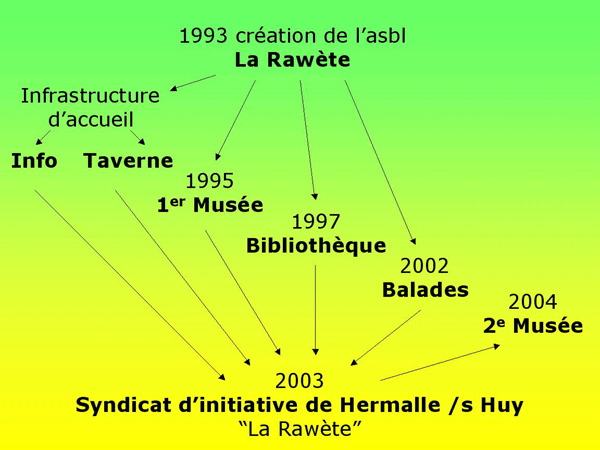
En 2003, la Rawète fête ses 10 ans ! Comme ses activités répondent aux critères du nouveau décret sur le tourisme, elle obtient du Commissariat Général au Tourisme sa reconnaissance comme Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy sous le numéro d’agréation Lg 36, et doit modifier son nom en conséquence.
L’objet social s’étend au développement et à la promotion du tourisme dans le territoire de l’ancienne commune de Hermalle-sous-Huy ; un second site internet – traitant de l’histoire, de la topographie, des activités du village – est créé : le présent www.hermalle-sous-huy.be mis en ligne le 1er décembre 2003 à 07 heures.
Il utilise le logo créé et offert par le graphiste d’origine hermallienne Dany Visentin :
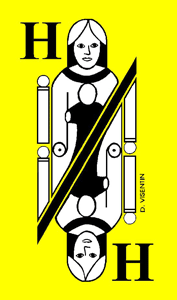
Il symbolise, sous forme de carte à jouer, la Vierge de Hermalle (Sedes sapientiae – au Musée du Cinquantenaire de Bruxelles), la lettre H et la barre oblique rappelant le nom du village en abrégé : Hermalle/s Huy.
Le choix de la couleur jaune permet à la fois de ne faire aucune référence à aucun parti politique francophone – l’asbl étant totalement indépendante sur ce plan – et d’attirer l’attention des néerlandophones sur l’aspect bilingue de la communication.
Le SI ouvre en 2004 le Musée Postes restantes pour conter l’histoire de la Poste et de l’écriture.
La Ferme a donc retrouvé vie… mais n’en est pas sauvée pour autant : la rénovation des ailes est et ouest n’est pas terminée et la toiture se dégrade fortement… Le SI La Rawète devient donc co-partenaire dans la demande de classement introduite en juin 2005 et à laquelle le Ministre en charge du Patrimoine, Monsieur Michel Daerden, ne donne pas de suite en décembre 2006.
Par sa rénovation, la ferme représente pourtant un encouragement à la sauvegarde du village ancien. Avec les Musées et la Bibliothèque de la Gourmandise, elle constitue aujourd’hui un centre d’échange de savoirs au niveau scientifique. Par ses marchés, foires, expositions temporaires, etc., elle attire un public régional et eurorégional, participant ainsi à l’essor touristique de la Wallonie.
Au début de l’été 2008, l’asbl redemande le classement du bâtiment et lance une pétition de soutien. Le dossier de classement est réouvert mais reste pendant jusqu’au 20 janvier 2012 où la procédure de classement est enfin ouverte – ce qui n’implique pas que le bien sera forcément classé…
Dans le cadre d’une bourse Win-win, les responsables de l’asbl rencontrent Maxime Vincken ; celui-ci est séduit par les activités de l’association et crée deux sites internet supplémentaires en 2012 : l’un pour le Musée de la Gourmandise, l’autre pour le musée Postes restantes.
Ces sites, quadrilingues fr-nl-en-wa, sont régulièrement actualisés par les soins d’une bénévole de l’asbl qui, en outre, se livre à des recherches incessantes sur l’histoire de Hermalle.
Une action citoyenne : la protection du patrimoine.
En vous rendant à la Ferme castrale, vous soutenez les volontaires (bénévoles) de notre asbl qui a été l’une des 16 associations choisies par la Fondation pour l’Architecture, l’Art et l’Artisanat Mosans pour représenter un exemple d’action citoyenne lors du Forum des associations du 1er septembre 2006 à l’Abbaye de La Paix-Dieu.
Notre asbl préserve en effet tant le patrimoine architectural (la Ferme castrale) que le patrimoine mobilier grâce à ses musées.
Bien que les thématiques de ceux-ci soient différentes, la philosophie qui soutend leur fonctionnement est identique : il s’agit d’offrir au public les meilleures conditions de découverte possibles, avec sérieux quant à l’aspect scientifique, avec humour quant à la présentation. Les visites sont guidées en français et néerlandais par des personnes compétentes, ce qui offre l’avantage d’une réelle convivialité et d’échanges personnalisés, et modulées en fonction du public (enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées, etc.).
Mais l’asbl préserve aussi un patrimoine immatériel :
En 2002, grâce aux documents de la Bibliothèque, en devenant éditeur et en publiant un CD-Rom, elle a affirmé haut et fort que les cuisines régionales ou anciennes font partie du Patrimoine au même titre que les monuments et les sites.
Depuis 2008, elle soutient une de ses bénévoles dans la rédaction d’articles sur Wikipédia.
Sur le terrain, la Rawète a organisé la redécouverte de plantes à usage culinaire et elle privilégie les recettes anciennes dans sa taverne. Goutez-y !
Une action autofinancée…
Bien que membre ou partenaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (car nos musées sont repris dans la liste des collections muséales), des Journées du Patrimoine auxquelles nous collaborons depuis 1991, de Musées et Société en Wallonie, du Commissariat général au Tourisme, de la Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse, des asbl Hesbaye-Meuse-Condroz-Tourisme et Article 27, nous sommes obligés de ne compter que sur nous en matière de trésorerie…
Les visiteurs qui s’informent de la situation financière de l’asbl ont peine à nous croire ! Et pourtant :
Depuis sa reconnaissance comme Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy, l’asbl La Rawète peut recevoir comme subvention de fonctionnement 380 €/an [sic] de la Fédération du Tourisme de la province de Liège et a droit à 1 500 €/an maximum du Commissariat général au Tourisme pour les frais de promotion du village et de ses activités. Point à la ligne.
Ah non ! En 2012, l’asbl a bénéficié pour la première fois d’un subside de 1000 euros de la commune d’Engis.
En avril 2011, l’asbl a donc ouvert dans la grange de la Ferme une brocante de livres et objets pour lui permettre de poursuivre son financement.
En clin d’œil avec les autres activités présentes sur le site, cette brocante a été nommée « Les Chineurs gourmands ».

Tous ceux qui œuvrent dans la Ferme castrale et au sein de notre asbl sont bénévoles ; nul n’est rémunéré. Vous pouvez bien entendu nous rejoindre, comme membre de l’asbl ou comme volontaire. Contactez-nous !
Une action partenaire…
Dès 1995, nous avons collaboré avec d’autres institutions culturelles ou scientifiques dans un esprit de partenariat et de coopération. Quelques exemples :
– Avec l’Agence Cyan de Berlin pour une exposition de photos de danse à la Ferme castrale
– Avec le Club Le Postillon de Amay pour une prévente de timbre dans la grange de la Ferme
– Avec l’Ensemble PassionataDanse de Bruxelles, pour des après-midis de ballet néo-classique
– Avec le Théâtre National de la Communauté française Wallonie-Bruxelles pour la présentation de Lettres de Belgique à la Ferme castrale
– Avec Ann Gaytan et Jo Deseure pour Poésie et chanson française, avec le Frietkotmuseum de Antwerpen, le CEC La Libellule de Hermalle-sous-Huy, la Ville de Liège, la Ville de Huy, le CAG de Leuven, Made in Belgium à Bruxelles, le Miat de Gent, le Musée de la Vie wallonne de Liège, ARTE, etc.
En 2011, le Musée et la Bibliothèque de la Gourmandise ont prêté des objets et des livres pour des expositions au Musée du Moulin et de l’Alimentation de Evere, à la bibliothèque Chiroux-Croisiers de Liège, à la sa Tempora pour le site de Tour & Taxi à Bruxelles, et au musée du Grand Curtius de Liège.
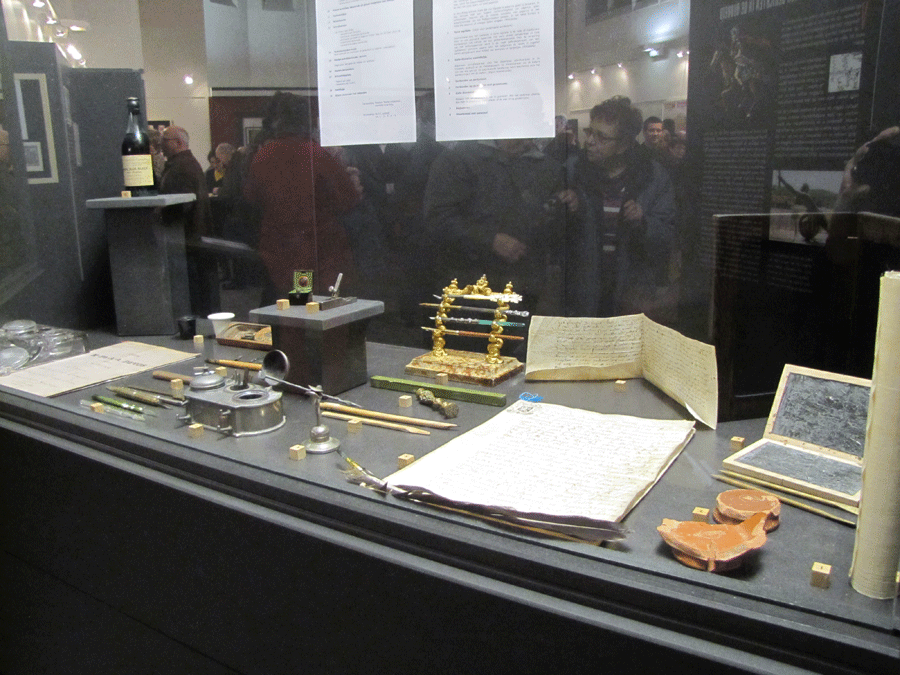
Détail d’une vitrine à Wervik, exposition Van messagier naar postbode, 2013.
En 2013, le Musée Postes restantes a prêté des objets au Muséobus et à la ville de Wervik.
Une action sociale…
La Rawète, en tant que syndicat d’initiative, est également devenue membre du Plan de cohésion sociale d’Engis au niveau des liens intergénérationnels et sociaux.

🎯 La vie est un jeu !
📍 Activités fun à Liège (Féronstrée 21)
🗓 Mercredi à dimanche
👥 Amis, familles, teams & événements
Troupe d’amateurs passionnés vous proposant des comédies 1 à 2 fois par an depuis près de 20 ans !

Historique
Fondé, sous ce nom, le 1er avril 1995 par Denis Fauconnier, il est en fait la continuité de l’ancien théâtre de marionnettes de la famille Engels. Cette famille commença à jouer des marionnettes vers 1880 au « biès molin » à Ougrée (hauteur de liège) avant de déménager pour « la troque » à Tilleur. Mais ce théâtre fut surtout célèbre lorsqu’il devint itinérant sous la direction de Gaston Engels car il fit la foire de Liège de 1927 à 1970. Ce théâtre tomba en suite en désuétude avant qu’une grosse partie du matériel (dont le castelet et une partie des marionnettes) soit repris par Denis Fauconnier et son Théâtre à Denis en 2001. Marionnettiste passionné et collectionneur Denis Fauconnier ne cesse d’agrandir le théâtre et sa « joue » (série de marionnette faisant partie de la troupe) et aujourd’hui ce sont plus de 1000 marionnettes liégeoises de 1850 à nos jours ainsi qu’une collection de plus de 200 marionnettes du monde que l’ont peut y admirer.
Théâtre
La saison va d’octobre à avril avec, toutefois, des spectacles prévus en juillet–août. Le plus souvent, ce sont des spectacles adaptés de romans, contes ou légendes mettant en scène des personnages historiques mais aussi la plus célèbre marionnette liégeoise, Tchantchès. Celui-ci incarne le bon sens populaire, celui qui met son grain de sel.
Musée
Un musée de la Marionnette situé à côté du théâtre dans l’ancienne maison remarquable du fontainier de la société des Fontaines Roland (qui abreuvaient la ville de liège en eau potable au xixe et au début du xxe siècle), vu le jour en 2006. On y montre des marionnettes liégeoises provenant de divers anciens théâtre liégeois comme celui de la famille Engels, de Pierre Wislet, de joseph Crits, de Robert Willé, de José Maquet où de Denis Fauconnier lui-même mais aussi d’autres du monde entier dont quelques beaux exemplaires de le théâtre Opera dei Pupi (Sicile) où des guignols de Lyon. Une bibliothèque est également à disposition.

L’activité de spectacle Al Botroûle est classé comme Associations théâtrales dans la rubrique theatres.
Il est situé Rue Hocheporte 3 dans la ville de Liège (code postal 4000) en Belgique.
Théâtre situé à Liège (Belgique), créé en 1972 par Françoise et Jacques Ancion. Après diverses pratiques d’animation avec quelques écrivains et plasticiens dès 1960, après des manipulations de toutes formes, Jacques Ancion dit Thorix, sculpteur né en 1942, renoua le lien avec les vieux montreurs à tringle (1964). Le matériel canonique liégeois permettait d’aborder presque tous les genres du répertoire avec une économie extrême des moyens. C’est aussi une forme théâtrale qui privilégie la connivence grâce au petit peuple exprimant toutes les vérités. Après une laborieuse acquisition de matériel ancien, pour la saison 1972-1973, Françoise (1947-1997) et Jacques Ancion aménagèrent leur petite salle Al Botroûle (Au Nombril) dans le vieux quartier Hocheporte et réussirent la gageüre de donner un second souffle au répertoire pour adultes. Dans le théâtre, agrandi en 1974, on donne Le Mort qui vit, La Tentation de saint Antoine, Li Naissance (voir Nativité), La Passion ; en épisodes, les grands cycles autour de Charlemagne, Tristan et Iseut, La Table ronde, La Quête du Graal ; on adapte aussi les vieux contes du terroir. En 1976, débuta la série des Ubu d’Alfred Jarry.
Jacques Ancion sculpte, construit, revivifie le jeu, fait éclater la scène ; il écrit, manipule et donne voix aux personnages tout de bois, sauf la langue. En 1978, l’entreprise familiale devint professionnelle et s’adjoignit des comédiens, musiciens (Julos Beaucarne), metteurs en scène (Jacques Delcuvellerie, Jan Dvořák), scénographes (Jacques D’Hondt, Pierre Kroll) et assistants (Étienne Pichault) pour des créations comme La Nonne sanglante de P. Delémarre, L’Opéra du Gueux de John Gay, La Mandragore de Machiavel, Victor de Pixérécourt, Tåtî l’pèriquî d’Édouard Remouchamps, Johannes Doctor Faust, L’Enfant prodigue, Ubu pape de Robert Florkin ; à partir de 1998, avec Tatiana Falaleew : La Patate inconnue, Les Miracles de la Fuite en Égypte, Charlemagne sacré Empereur, L’Enfance de Merlin.
Dans toute l’Europe, comme au Québec et au Japon, Tchantchès-Bonète, vieux complice paradoxal d’Al Botroûle, proclame : « Ma tringle, c’est ma liberté ! »

Théâtre Arlequin
Le théâtre Arlequin est une troupe de comédiens installée à Liège, rue Rutxhiel et dirigée par Delphine Dessambre. Fondé en 1956 par José Brouwers, le Théâtre Arlequin repose sur une compagnie de comédiens qui assurent plus de 150 représentations par saison dans son théâtre de poche ou en tournée.


Anciens noms : Théâtre du Gymnase, Théâtre du Nouveau Gymnase, Théâtre de la Place
Le théâtre de Liège, anciennement théâtre de la Place, est un théâtre belge situé à Liège. Auparavant établi place de l’Yser dans le quartier d’Outremeuse, il est depuis le 30 septembre 2013 installé dans les locaux de l’Émulation, place du XX août1.


Objectifs du théâtre :
Proposer aux spectateurs des pièces de théâtre dont l’écriture de qualité reste un des points essentiels. Qu’il s’agisse d’auteurs modernes encore inconnus ou d’auteurs aguerris qu’ils soient anciens ou non.

Le Pavillon de Flore, surnommé Bonbonnière de la rue Surlet, est un théâtre situé en plein cœur du quartier d’Outremeuse de Liège.
Depuis 1976, il accueille le Théâtre communal wallon du Trianon, autrefois situé sur le boulevard de la Sauvenière.

Théâtre Le Grandbousier

Le théâtre Proscenium de Liège vous propose depuis 1972 des spectacles théâtraux réalisés avec l’aide de leurs metteurs en scène, comédiens, régisseurs,…

e théâtre de l’Etuve, fondé en 1951, offre une programmation éclectique de qualité.

Le Théâtre universitaire royal de Liège (TURLg) est un groupe de création et d’animation fondé officiellement en 1941. Le théâtre est installé dans l’ancien institut de chimie de l’Université de Liège quai Roosevelt.

Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux ». Bienvenue dans les communes de Modave, Marchin, Clavier & Tinlot

Traces Galerie est l’atelier d’artiste de Véronique Martinelli mais est un espace ouvert à d’autres

Le Trésor de la cathédrale de Liège présente dans dix salles d’exposition thématique un parcours à travers l’art et l’histoire de l’ancienne principauté de Liège.
On peut notamment y découvrir des orfèvreries (buste-reliquaire de saint Lambert, reliquaire de Charles le Téméraire, et de la sainte Croix, des ivoires byzantins et mosans (Ivoire des Trois Résurrections), des manuscrits, des sculptures, ainsi qu’une collection de textiles de haute époque (les deux suaires de saint Lambert, viiie siècle et xie siècle) et des ornements liturgiques.
Le trésor de la cathédrale est géré par l’a.s.b.l. Trésor Saint-Lambert créée en 1992. Elle est présidée par l’évêque de Liège et le doyen du chapitre cathédral avec pour objectif de rassembler des énergies d’horizons divers dans le but de favoriser la préservation du patrimoine artistique de premier plan.
La plus grande partie du trésor provient de l’ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège détruite en 1794 lors de la révolution liégeoise.

Le Trinkhall Museum, (anciennement Madmusée pour « Musée d’art différencié ») est un musée liégeois fondé en 1998 qui est situé dans le parc d’Avroy à Liège. Le musée conserve et expose des œuvres réalisées par des artistes porteurs d’un handicap mental, de maladie mentale ou de fragilité psychique, en contexte d’atelier.

Le Trocadéro est un théâtre belge situé rue Lulay-des-Fèbvres à Liège. C’est le plus parisien des cabarets liégeois et le dernier théâtre qui présente le concept de revue (genre théâtral qui associe musique, danse et sketches qui font la satire de personnes contemporaines, de l’actualité ou de la littérature) en Wallonie.
C’est également un théâtre privé qui fonctionne sans le moindre subside public.
Le théâtre est connu pour ses nombreuses revues mais, il accueille également des comédiens, des humoristes et des concerts chaque année.


L’unité scoute de Vottem accueille des jeunes garçons de 5 à 18 ans depuis 1934. C’est un mouvement éducatif, fondé sur le volontariat.

Université du temps libre

Le Val-Benoît est un ensemble architectural de style moderniste situé en Belgique à Liège, sur les rives de la Meuse, construit entre 1930 et 1965 par l’université de Liège qui occupe le site jusqu’en 2005. Le site de 9 hectares, laissé à l’abandon de nombreuses années, est en cours de réhabilitation.
Pour plus d’infos supplémentaires sur le Val Benoît, vous pouvez consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-Beno%C3%AEt_(Li%C3%A8ge)

Mouvement éco-citoyen à Liège, composé de militants écologistes et de citoyens engagés, unis pour défendre une autre vision de la Ville !

a Villa Gallery, un lieu Vente d’œuvres d’art en ligne et de Talent management à Liège, elle fut créée en réponse à la demande des amoureux d’art à la recherche d’œuvres uniques pour leur collection personnelle ou décoration d’intérieur.

age officielle de l’administration communale de Herstal. Toutes l’actualité et les informations importantes pour la population.

L’hôtel de ville de Liège, surnommé La Violette, est un bâtiment de la place du Marché à Liège construit dès 1714.
Intégré dans un ensemble architectural homogène, l’hôtel de ville de Liège domine la place du Marché et ses anciennes maisons aux étroites façades.

L’Hôtel de ville de Verviers est un édifice de style néo-classique situé à Verviers, dans la province de Liège en Belgique.

Virtual Room est l’une des seules expériences de réalité virtuelle au monde basée sur la coopération en équipe.


Vivre Sawa est une ASBL sur Liège favorisant : rencontre, interculturalité, dialogue, bien-être.



Bibliothèque – Ludothèque – Presse – Espace d’étude – Espace d’animations – Espace Public numérique

Située au sein du Domaine provincial de Wégimont, à quelques kilomètres à l’est de Liège, la galerie de Wégimont a pour vocation de présenter les œuvres d’artistes vivants, de Liège ou d’ailleurs, et de servir par là la promotion des arts plastiques d’aujourd’hui, à travers toutes leurs formes d’expression, la peinture comme la sculpture, le dessin, la gravure ou la photographie.
Wégimont Culture asbl organise également des expositions des artistes qu’elle soutient au cinéma Churchill à Liège.
Lieu vivant d’échanges et de dialogues, la galerie de Wégimont a su développer une relation suivie avec les artistes dont elle défend le travail, et avec le public, qu’elle tente de mieux préparer à la réception de l’art en général, et de l’art d’aujourd’hui en particulier.
Galerie de Wégimont, Domaine provincial, chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne


Aldo Aprile vous invite à découvrir son nouveau concept à Liège : XPO253 By Aprile & Lounge Coiffure. Un lieu où l art et la culture se partagent !

![]()